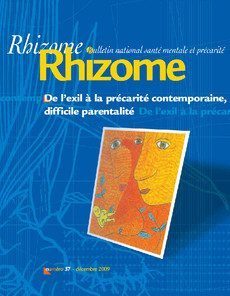Depuis que la santé mentale a droit de Cité dans le champ de l’asile, le recueil des vignettes cliniques mais aussi des récits directs des demandeurs met en lumière de façon récurrente une affectivité douloureuse des demandeurs en lien avec la manière dont ils sont considérés chez eux mais aussi chez nous.
Cette proposition d’orienter cette actualité de la souffrance subjective sur le terrain du droit à partir des matériaux de la clinique peut apparaître non pertinente.
Il nous faut prendre en considération le fait que cette clinique qui s‘annonçait citoyenne lors d’un précédent Cahiers de Rhizome est prise de plus en plus quotidiennement en étau entre deux régimes d’opportunité : celui de l’Etat et des ses lois, et celui des individus et de leurs parcours d’asile. Une mise en perspective de ce matériel clinique dans une réflexion plus large qui prendrait acte de la place particulière prise par le droit subjectif dans les sociétés modernes pourrait dessiner une perspective politique renouvelée dont les acteurs du front manquent parfois cruellement.
Après avoir rappelé que les droits subjectifs deviennent légitimes au moment où l’Etat souverain s’essouffle à garantir ce type de droits, nous voudrions montrer en quoi la santé mentale peut devenir, sous certaines conditions de pratique, une nouvelle référence en soutien à l’émergence de droits subjectifs. Les atteintes subjectives des demandeurs d’asile (où s’imbriquent des expériences d’iniquité et de santé mentale) posent doublement le problème des droits subjectifs : en tant que droit de recours contre les décisions du droit positif, mais surtout par le fait que l’attestation de ces expériences négatives pose une exigence de redéfinition du droit subjectif, lesdits Droits de l’Homme sont certainement à reconsidérer à l’aune de ces deux spécificités.
Droit subjectif et essoufflement de l’Etat souverain
Le droit subjectif naît dans le processus même d’individuation qui caractérise les sociétés modernes. Alors que le droit objectif s’occupe de considérations générales et vise un attributaire anonyme, le droit subjectif vise des personnes particulières. Alors que le premier vise à organiser des lois auxquelles les individus sont contraints, le second se fonde sur les prérogatives dont une personne peut se prévaloir (droit au respect, droit à la dignité). Deux points sont remarquables. Le premier consiste à pointer l’élargissement des droits subjectifs (sous la forme extensive des Droits de l’Homme) en correspondance avec l’effacement certes relatif des Etats souverains et l’émergence des acteurs globaux : instances publiques internationales, Union Européenne, ONG internationales). Pour ce qui nous préoccupe, il est patent que les Etats souverains sont mis en difficulté sérieuse dans la résolution des problèmes humains posés par les flux migratoires, qu’ils soient d’origine économiques ou politiques. Le second point est lié directement à ce nouveau contexte d’affaiblissement des états souverains. Dans le cadre de ladite mondialisation, les droits dits « de troisième génération »1 qui s’annoncent pour partie comme des droits subjectifs manquent encore de garant institutionnel. Par exemple, l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, signée en 2004 en intégrant les nouvelles préoccupations écologiques, affirme « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ». Autre exemple : en juin 2008, le pacte européen pour la santé mentale et le bien-être établit que la santé mentale est un droit de l’homme (« together for mental health and well being »).
Dans ces deux exemples, le droit subjectif se fonde sur une connexion, d’une part, entre santé et écologie et, d’autre part, entre santé (mentale) et bien-être. Mais qui est garant de ce droit ? Qui définit la santé de « chacun » ? Quelle instance peut calibrer des notions comme celles de bien-être, d’équilibre et de respect ? Quel type de pouvoir oblige au respect de la santé sinon des instances non étatiques défenseurs des droits de tel ou tel individu spolié?
Déjà au début du 20ème siècle, Max Weber précisait qu’il y a droit subjectif chaque fois qu’une personne donnée « détient, grâce au sens réel et reconnu de la règle de droit, une possibilité efficacement garantie d’exiger, pour ses intérêts (idéaux ou matériels) l’appui d’un ‘appareil de coercition’ constitué à cet effet »2. Mais Max Weber remarquait aussi que l’instance chargée de garantir cette possibilité n’est pas nécessairement l’Etat. Dans le contexte de dépassement de l’Etat souverain, les droits subjectifs, pour être garantis, cherchent d’autres instances qui puissent imposer des obligations à réparation lorsque tel ou tel est spolié dans sa vérité subjective. Dès lors, si on agrandit la focale à une conception plus large du droit, on ne peut avancer qu’en amont de sa forme juridique fixée ; le droit subjectif se construit comme un problème public chaque fois qu’une forme de pouvoir d’entrave, quelle que soit sa nature, est en mesure de garantir les prérogatives revendiquées par un individu ou par un porte-parole de poids qui le représente (droit pour tous à l’entrée des boîtes de nuit par exemple). Qu’observe-t-on à ce sujet ? D’une part, dans un contexte d’érosion de souveraineté de l’Etat, les moyens de la contrainte se sont diversifiés : ils peuvent être de nature morale, économique, médiatique, scientifique, médicale. D’autre part, ils sont plus diffus. L’obligation à se conformer aux droits subjectifs ne s’exerce pas toujours par la violence légitime de l’Etat. D’autant plus que dans le champ de la demande d’asile, la question du droit se pose dans une situation toujours particulière et concrète quasi structurellement paradoxale. Il s’agit de fabriquer du droit contre certains agissements de l’Etat dans un contexte où c’est le même Etat qui garantit ledit droit d’asile. Dans la foulée de cette « conception sociologique d’un droit élargi3 » où il s’agit de faire valoir des droits contre l’Etat, nous voudrions ici explorer le champ de la santé mentale comme une forme d’instance qui est totalement immergée dans une problématique des droits subjectifs. A quelles conditions peut-elle participer à soutenir l’émergence de ces droits ? Cette question ne va pas de soi. La santé mentale évoque prioritairement une pratique sociale qui oscille entre normal et pathologique, entre maladie et bien-être. De ce point de vue, elle relève bien d’une tutelle étatique. Un gouvernement est donc habilité à donner des orientations en la matière. Mais il est tout aussi vrai que la santé mentale, en tant qu’elle se construit comme une action publique qui mobilise de nombreux acteurs (dont les usagers) a tendance à s’autonomiser au moins partiellement de la tutelle étatique, surtout lorsqu’elle tente d’affronter des problèmes de respect, de dignité, de discrimination des personnes, toutes préoccupations qui appartiennent pleinement au champ élargi des droits subjectifs. Cette situation qui tend à se généraliser dans de nombreux pays appelle à une réflexion renouvelée sur le rapport entretenu entre la santé mentale et la manière dont les fondements, mais surtout dont les garants des droits subjectifs, sont en train de se renouveler aujourd’hui.
Droit subjectif, santé mentale et capacités d’agir
Pour aller plus avant, changeons de focale. Abordée du côté de la relation avec les demandeurs d’asile, la question revient à comprendre comment les professionnels du soin se positionnent dans cette construction des droits subjectifs. En fait, cette proximité avec des questions de droit n’est pas nouvelle pour eux. Elle est même indispensable dans les situations de soins sans consentement. Elle a d’ailleurs donné lieu à une abondante littérature. Mais en l’occurrence, les professionnels sont confrontés à une question un peu différente. Comment peut-on penser un type de lien à des étrangers en demande d’asile ? Dans ce cas de figure, la question du rapport entre droit des personnes et subjectivité via le concept de dignité humaine est centrale. Que ce soit dans les constructions de récits pour l’OFPRA4, ou bien encore dans la manière dont l’attente de décision peut donner lieu à des réorganisations pathologiques de liens intersubjectifs (dont certaines sont explicitées dans ces Cahiers), que ce soit dans la famille ou dans le rapport avec les communautés d’origine ou d’accueil, la procédure fait peser sur le demandeur (et par ricochet sur tout acteur qui l’accompagne) des exigences d’implication, de mise à nu, d’injonction biographique qui le soumettent à des épreuves psychologiques de capacité. Tout demandeur apprend – mais à quel prix – à traverser des situations requérant l’expression de soi en se cadrant dans des interactions invitant à la commisération, ou bien au contraire, en exposant plus ou moins bien des émotions et des faits intimes afin de se rendre plus « positif » à ceux qui ont le pouvoir de décision. Comme le précisent de nombreux thérapeutes, le prix à payer pour sortir et construire un récit d’asile est souvent psychiquement douloureux. Selon les mots de Nicolas Méryglod, certaines situations sont à l’origine d’un « écrasement de la subjectivité » : Une mère victime de viol peut se sentir incapable d’en parler à ses propres enfants alors qu’elle est sommée d’en faire la preuve et d’en raconter les détails pour obtenir l’asile. Dans un autre registre, l’inversion des rôles enfant-parent dans la phase d’attente est aussi psychologiquement lourde de conséquences concernant les valeurs transmises d’une génération à l’autre. Dans cette situation, la prise en compte de la subjectivité des personnes, mais aussi d’une forme de relation intersubjective entre aidant et aidé, nécessite une forme de renoncement d’un principe de juridicité qui, classiquement, cherche à mettre en tension des droits et des devoirs. A contrario, dans le cas de figure qui nous occupe, l’opposé du droit n’est pas le devoir, mais le non-droit. Une telle situation de non-droit est anthropologiquement inhumaine car elle exclut les demandeurs d’asile de l’échange social, du commerce des hommes. Comment réintroduire de l’humanité dans le principe de juridicité ? Méthodologiquement, les praticiens partent de la situation vécue subjectivement de non-droit afin d’aller vers plus de droit. Cette orientation inductive nécessite d’authentifier des situations d’écrasement (voir supra) de la subjectivité, qui peuvent légitimement être plus reconnues et authentifiées par des professionnels de santé mentale – au vu de leur champ d’expertise – que par des juristes. Selon son point de vue, face à l’obligation faite aux demandeurs d’asile de se raconter pour avoir des droits, le professionnel de santé mentale peut faire entendre que le premier des droits subjectifs pourrait être parfois celui du droit de se taire, du droit au silence… Ainsi entendu, le droit d’un sujet n’est plus seulement le reflet inversé du devoir d’asile garanti par le collectif. Au contraire, il redéfinit ce devoir au non des atteintes à la subjectivité attestées par des professionnels en souci de soin psychique.
Dans ce cheminement qui va du non-droit à la santé mentale et de la santé mentale aux droits, il resterait à ouvrir un questionnement essentiel sur le rapport entretenu entre droit subjectif et capacité d’agir. Le champ d’investigation est vertigineux. Nous devons nous contenter ici d’esquisser les creux et les pleins du paysage tel qu’il se déroule sous nos yeux. S’il ne désigne pas seulement une règle qui s’applique mais parfois l’exigence d’un gain de capacité à agir, alors nous devons penser les droits subjectifs comme un levier de pouvoir, un processus d’empowerment ou encore comme une capabilité5 (Amartya Sen). La reconnaissance de la subjectivité et de ces aléas mais aussi l’activation de celle-ci dans le but d’avoir un statut, donnent lieu à des modalités concrètes d’action publique au sein desquelles les professionnels de santé mentale sont engagés. Comment discerner différentes politiques de capacités telles qu’elles sont actées par les dispositifs psychosociaux ? Au-delà de la situation radicale des demandeurs d’asile, la question de fond est bien de comprendre quels sont les modèles d’autonomie ainsi promus pour le quidam moderne.
Esquissons quelques jalons.
Dans une première esquisse, l’intervention de santé mentale contribue à promouvoir une conception des droits subjectifs dont la finalité consiste avant tout à élargir le champ d’action de la volonté individuelle en tant qu’elle demeure une qualité essentiellement privée. Face à la société et à ces lois, chaque homme accède à la dignité en tant qu’humain et non pas en tant qu’il est un membre parmi d’autres d’une société qui l’inclut ou l’exclut. Dit autrement, il accède à des droits subjectifs6 en tant qu’il est un humain en capacité d’agir (sans trop d’entrave). Cette conception pose l’individu non pas à l’intérieur mais face à la société, surtout lorsque celle-ci ou certaines de ces composantes l’empêchent de mener « tel ou tel type de vie ». L’intervention de santé mentale – dont la technique mobilisée ici est plutôt une clinique des « cas » – se définit comme une pratique qui postule un espace irréductible de liberté subjective et d’autonomie comme valeur individuelle. Elle participe d’une vision politique où l’Etat est seulement garant des accords conclus entre les individus pris un par un.
A cette figure libérale qui s’appuie sur une conception éthique de la dignité humaine – chacun est digne d’avoir des droits en tant qu’humain – s’oppose ou le plus souvent s’articule dialectiquement une autre manière de faire de la santé mentale et donc de concevoir du droit subjectif. Le curseur est mis ici sur une reformulation tangible de l’autonomie des personnes et non pas sur la préservation de leur liberté formelle. L’intervention de santé mentale vise ici plutôt à renforcer ou à redonner la capacité à des sujets à participer à la vie sociale. L’accent est alors mis sur les compétences ou les expériences subjectives positives qui facilitent l’exercice des rôles sociaux. Les interventions vont consister à insister sur la capacité pour un demandeur d’asile à maintenir son rôle de parents par exemple dans un environnement des plus défavorables. La technique de santé mentale mobilisée est ici plutôt groupale et parfois communautaire et la perspective clinique toujours présente devient psychosociale.
Dans la situation française, le mouvement de psychothérapie institutionnelle par exemple renvoie à cette seconde figure où les droits subjectifs confèrent des capacités à un sujet ou à une communauté afin qu’il (ou elle) puisse en obliger d’autres à lui conférer un pouvoir d’agir dans le monde social. Mais les pratiques d’empowerment issues du monde anglo-saxon participent aussi de cette configuration. Si on les examine du point de vue du droit élargi, on peut distinguer au travers de ces pratiques, la distinction classique entre droit-liberté et droit-créance.
Cette distinction renvoie à deux conceptions du droit subjectif. Alors que le droit-liberté vise à défendre la liberté d’un individu et à respecter celle d’autrui (liberté d’opinion par exemple), le droit-créance vise à augmenter sa marge de liberté tangible afin que son exercice ne reste pas un droit formel. Seule cette seconde conception est associée à une réflexion sur les conditions du pouvoir d’agir et sur l’empowerment. En partant des situations concrètes de non-droits, l’accent est alors ordinairement porté sur les atteintes subjectives mais aussi sur les formes de libération des rapports sociaux de discrimination ou de domination qui les bornent. Dans cette dernière situation, les interventions de santé mentale, combinées avec d’autres formes d’interventions sociales ou juridiques, peuvent contribuer à fonder une exigence de redéfinition du droit subjectif associée à une réflexion sur l’augmentation du pouvoir d’agir des demandeurs d’asile7.
Questions pour demain
Depuis une décennie, dans un contexte politique inhospitalier, les acteurs de santé mentale ont su souvent, à contre-courant, témoigner des vulnérabilités psychiques (traumatismes et exil) caractéristiques du parcours des demandeurs d’asile. De nombreux praticiens, dont certains sont des professionnels du soin et du social et d’autres des bénévoles, des militants, des élus locaux, se sont impliqués dans la résolution des problèmes où s’imbriquent le soin mais aussi dans des logiques plus quotidiennes mais plus diffuses, du prendre soin. Lors de différents travaux effectués dans le cadre de l’ONSMP, nous avons contribué à faire connaître et reconnaître cette part de la santé mentale dans la problématique actuelle de la demande d’asile. Aujourd’hui, certaines situations problématiques présentées dans ces Cahiers de Rhizome par les accompagnateurs des demandeurs d’asile appellent à une réflexion renouvelée sur le sujet. De fait, explorer les instances collectives qui fondent du droit subjectif apparaît comme une priorité du moment. La santé mentale est-elle en train de devenir une des ces instances qui soutient ou garantit l’émergence de nouveaux droits subjectifs ? Ou bien, comme le disait déjà E. Goffman, contribue-t-elle seulement à calmer le jobard8 ? Cela donne des responsabilités individuelles mais aussi collectives aux praticiens de tout bord.
En santé mentale, les pratiques sont d’abord centrées sur des individus et sur leur souffrance. Mais faut-il en rester là ? Certainement pas. Partir des maux individuels pour aborder des considérations plus sociétales sur la façon dont se fonde aujourd’hui une nouvelle configuration politique de l’humain devrait nous aider à mieux discerner les mutations actuelles des formes de droit dans lesquelles la santé mentale est totalement immergée. Questions pour demain : restera-t-elle confinée à la clinique psychosociale du sujet désaffilié ? Ou saura-t-elle relier (selon des voies qui restent à inventer) souffrances subjectives et participation active des hommes au développement du droit ?
Notes de bas de page
1 Les droits de première génération sont les droits civils et politiques (droit-liberté). Les droits de seconde génération plus récents sont les droits de la famille, du travail, à l’éducation, les droits sociaux. Ceux de troisième génération s’originent d’une réflexion plus environnementale, voire écologique (droit à la paix et au développement).
2 Cité par Catherine Colliot-Thélène dont nous reprenons la thèse concernant l’essoufflement de l’Etat souverain et la recherche d’autres garants de droits subjectifs. Voir son article très éclairant sur ce sujet. http://www.juspoliticum.com/Apres-la-souverainete-que-reste-t,27.html.
3 Ibid
4 Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
5 L’empowerment, concept anglo-saxon, est considéré comme un processus individuel, mais également collectif et organisationnel. Il s’agit pour les individus et les groupes de s’approprier du pouvoir dans une situation où ils n’en ont pas ou peu. Il existe un lien entre empowerment et citoyenneté concrète à travers la notion de participation aux décisions. En santé mentale, l’empowerment est particulièrement utile pour aider les personnes à lutter contre les conséquences sociales de leur maladie.
Quant à la capabilité, Amartya Sen (prix Nobel d’économie en 1998) la définit comme « les diverses combinaisons de fonctionnements (états et actions) qu’une personne peut accomplir. La capabilité est, par conséquent, un ensemble de vecteurs de fonctionnements qui indiquent qu’un individu est libre de mener tel ou tel type de vie » (Cf. Repenser l’inégalité, Editions du Seuil). Ces deux notions, différentes à bien des égards, ont en commun de tenter de penser les processus de capacitation et d’appropriation du pouvoir des individus et des groupes vulnérables.
6 Nous reprenons ici la différenciation proposée par Christoph Menke in Droits subjectifs et dignité humaine. En guise d’introduction. http://trivium.revues.org/index3309.html.
7 On peut remarquer que ces deux fonctions classiques accordées aux droits subjectifs dans la modernité, s’inscrivent dans la tendance moderne à considérer que les droits objectifs doivent être fondés sur les droits subjectifs. Bref, les Droits de l’homme ne sont pas accordés par une instance supérieure, mais à revendiquer dans des situations historiques qui permettent de les concrétiser sous telle ou telle forme de droits (à la santé mentale par exemple).
8 Dans un article intitulé « Calmer le jobard », E. Goffman présente les mille et une manières d’apaiser les victimes d’un échec dans les différentes sphères de la vie sociale. Qu’il s’agisse d’aider quelqu’un à supporter une déconvenue professionnelle ou de lui permettre de surmonter une déception personnelle, il attire l’attention sur plusieurs données importantes de la vie collective, telle que la représentation de soi, la diversité des rôles sociaux ou les phénomènes d’exclusion et de mort sociale.