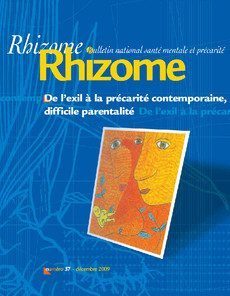La famille à l’épreuve de l’exil
Le départ vers l’exil de familles en butte à des risques de persécutions ou exposées aux dangers collatéraux des guerres civiles se fait rarement dans un ordre bien planifié, permettant de rassembler tous les proches et de reconstruire ensuite sereinement une nouvelle configuration familiale dans le pays d’accueil. Il manque souvent au départ l’un des deux parents, le père la plupart du temps, soit qu’il ait été déjà tué, soit qu’il soit en prison, soit qu’il ait pris la fuite pour échapper à des persécutions qui menacent ensuite sa famille et incitent celle-ci à partir pour anticiper sur des risques de violence.
Il manque aussi fréquemment quelques enfants de la fratrie, surtout parmi les familles originaires d’Afrique centrale qui, par tradition, confient certains d’entre eux à d’autres ménages membres du même groupe de parenté. Ainsi chez les membres du groupe ethno-linguistique Kongo, fortement représentés chez les demandeurs d’asile en provenance du Congo, de la RDC et du nord de l’Angola, il existe un système de parenté particulier qui associe une filiation matrilinéaire et un type de mariage virilocal1. Les enfants qui sont censés appartenir avant tout au lignage de leur mère sont élevés dans le lieu de résidence de la famille de leur père et doivent, pour équilibrer le jeu des appartenances, séjourner fréquemment auprès de leur oncle maternel. Les difficultés d’organisation des départs vers un pays tiers ne permettent pas de récupérer ceux qui sont loin et par ailleurs, les égards dus à ceux à qui on a confié les enfants pour respecter une tradition garante de l’équilibre des relations de parenté, empêchent de les leur retirer trop brutalement. On trouve donc des fratries incomplètes et des ménages devenus monoparentaux du fait de l’exil, ce qui accroît le malaise déjà provoqué par la disparition de la famille étendue et enferme le parent présent et les enfants qui se retrouvent avec lui dans une relation frontale qui n’est pas propice à l’évacuation des tensions qui résultent de ce que les uns et les autres ont subi en termes de menaces et de violences dans le pays de départ et de l’angoisse qu’ils continuent de subir dans leur situation incertaine de demandeurs d’asile. Ces formes de mutilation du groupe familial portent atteinte à ce que J.Barudy appelle le «tiers protecteur», cet ensemble de parents et de voisins bienveillants qui entourent la famille au pays et peuvent intervenir pour atténuer les tensions internes qui l’agitent.
Les effets de l’absence de la famille au sens large ne se font pas sentir seulement chez les demandeurs d’asile. Ils peuvent être une source de perturbation des rapports entre parents et enfants au sein de familles africaines qui ont immigré en France dans un contexte pacifique et qui ne peuvent plus recourir à l’aide des grands parents ou des collatéraux qui assument traditionnellement certaines fonctions éducatives auprès des enfants2. La perte de l’entourage que constitue la famille élargie, même si cette dernière garde une réalité plus forte dans certaines cultures que dans d’autres, touche tous les ménages de demandeurs d’asile, quelle que soit leur provenance. Domitille Blanco qui a réalisé de nombreuses enquêtes dans un CADA de Lyon, note la fréquence des références à la famille étendue, aussi bien chez les Européens originaires de Balkans et du Caucase que chez les Africains :
« Pendant quinze ans, Dragana a vécu au sein dela famille Rom de son mari, à Mitrovica, au milieu de la communauté Rom du Kosovo : « Ici, ce qui me manque, c’est la drustus ». La drustus, c’est le cercle social, la compagnie. Elle explique : « Là-bas, tout le monde participait à la vie de la maison, c’était la vie en communauté »3.
Il s’agit bien là d’un tiers manquant, perçu comme protecteur et potentiellement médiateur entre les membres de la famille, même si sa proximité entravait parfois le désir d’autonomie des parents dans leurs tâches éducatives et favorisait des formes d’intrusion de la communauté dans la vie du couple. Plus, les efforts accomplis pour maintenir un lien à distance avec cette parentèle restée au pays ou dispersée au fil des évènements sur des aires plus vastes témoignent bien du besoin de conserver des contacts et de garder en toile de fond une référence à un univers familial plus large que celui auquel on a pu être réduit par l’exil. Divers auteurs ont souligné cette importance de la perte de l’environnement familial et communautaire, aussi bien pour les parents que pour les enfants.
Cette absence du tiers protecteur entraîne la recherche d’un substitut qui puisse fournir un milieu de sociabilité et d’entraide permettant d’échapper à l’enfermement dans une structure familiale réduite et souvent déséquilibrée par l’absence de certains de ses membres. La vie en France et en particulier, la vie dans un milieu collectif comme le CADA permet la reconstruction d’un univers communautaire susceptible de palier plus ou moins l’absence de la famille élargie. Mais à ce jeu là, les enfants apparaissent comme très avantagés par rapport aux adultes, ce qui provoque d’autres types de dysfonctionnements dans les relations internes.
Un milieu peu favorable aux parents
Nous avions mené en 2003 une recherche interdisciplinaire auprès des familles de demandeurs d’asile vivant en Centres d’Accueil (CADA)4. C’est à partir de la relecture des enquêtes menées dans ce cadre qu’il nous apparaît que les relations intra familiales sont considérablement mises à l’épreuve chez les demandeurs d’asile, du fait même des conditions dans lesquelles ils vivent les premières phases de leur exil et ceci quelle que soit au départ la configuration familiale qui fait référence pour eux. Les conditions de vie en CADA, même si elles varient considérablement d’un établissement à un autre, sont plus favorables au développement d’une sociabilité enfantine qu’à celui d’une sociabilité d’adultes. Ces derniers parviennent plus difficilement à maîtriser le français qui est le principal moyen de communication avec les autres occupants du CADA. Ils se retrouvent à devoir voisiner avec des personnes d’une culture très différente de la leur, ce qui entraîne des nuisances et des conflits au niveau de l’occupation des espaces. Parfois, ils retrouvent dans le centre d’accueil des personnes appartenant au groupe ethnique avec lequel ils étaient en guerre dans le pays d’origine. C’est le cas des demandeurs d’asile en provenance du Kosovo qui peuvent aussi bien être Serbes, Albanais ou Roms et qui doivent cohabiter dans les mêmes établissements.
Les risques de conflits entre les adultes renforcent le pouvoir du personnel d’encadrement des centres qui interviennent pour apaiser les tensions, éventuellement déplacer les personnes qui créent des nuisances pour les autres, voire pour exclure certains perturbateurs. Les adultes ne parviennent pas à constituer un milieu assez uni et cohérent pour pouvoir dialoguer avec le personnel d’encadrement. Celui-ci peut apparaître comme le substitut du tiers protecteur mais il est en même temps en position de tutelle sur les familles, même s’il s’abstient de trop intervenir dans leurs problèmes intimes. Inévitablement, les conditions se trouvent réunies pour porter atteinte indirectement à la représentation que les parents peuvent avoir d’eux-mêmes vis-à-vis de leurs enfants. Le demandeur d’asile se met en quelque sorte sous tutelle pour tout ce qui concerne son avenir immédiat et celui de sa famille. En tant que parent, habilité à décider pour ses proches, il se rend impuissant. Le mode de prise en charge des familles de demandeurs d’asile, dans le cadre du dispositif d’accueil et des centres d’accueil renforce cet état d’impuissance. L’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, la proximité d’un personnel plus à même de répondre aux besoins éducatifs des enfants, l’ignorance du fonctionnement des structures dans lesquelles les enfants sont éduqués en dehors de la famille, école, centres de loisirs etc., tout cela forme un ensemble de facteurs qui portent atteinte à la fonction nourricière, directrice et protectrice qui constitue l’essentiel de la fonction parentale.
Les adultes sont suspendus dans l’attente d’une décision qui décidera de leur avenir et sur laquelle ils n’ont que peu de prise, du fait même que le récit qu’ils doivent faire de leur histoire leur échappe en partie. Ils l’élaborent sous les conseils des personnes qui connaissent bien la procédure et qui se réfèrent à ce qui peut convaincre l’OFPRA et pas toujours à ce que les gens ont ressenti de leur vécu. Tenus aussi à l’écart du monde du travail, ils ne parviennent pas à constituer un collectif dans lequel ils pourraient retrouver la conscience de leur existence sociale. Malgré la communauté de destin qu’ils partagent avec les autres occupants des centres d’accueil il y a trop de dissemblances dans les modes de vie et trop de changements dans le voisinage pour qu’ils puissent développer une sociabilité positive et durable. Touchés par cette conscience de leur inexistence sociale, de leur inutilité économique et de leur impuissance en matière décisionnelle, ils se tournent vers leurs enfants pour avoir des raisons d’espérer.
Ces derniers trouvent dans les centres d’accueil un milieu dans lequel ils peuvent se socialiser plus facilement. Leur aptitude à apprendre le français beaucoup plus rapidement leur permet de développer des liens avec d’autres enfants. Ils n’ont pas non plus les a priori négatifs des adultes par rapport aux gens d’origine différente et les amitiés qu’ils développent transcendent souvent les oppositions ethniques et religieuses. Le fait d’être scolarisés et de se voir proposer des loisirs encadrés par le personnel des centres leur évite l’ennui qui mine leurs parents et leur apporte une ouverture sur l’extérieur que ces derniers n’ont pas. Une petite communauté enfantine se crée ainsi dans les CADA. A la faveur de la rencontre avec les enfants qu’ils fréquentent à l’école, les petits demandeurs d’asile prennent conscience de leur destin commun et cela renforce les liens de solidarité à l’intérieur de leur groupe. Ils construisent ainsi un collectif qui les protège et les stimule. Ils offrent à leurs parents des images rassurantes qui évitent à ces derniers de trop se remettre en question et leur permet de prendre de la distance vis-à-vis de leur propre souffrance.
Ambiguïté et culpabilité des parents vis-à-vis des enfants
Les enfants jouent manifestement un rôle très important pour aider les parents à garder espoir et à poursuivre leurs démarches. Leur bien-être apparent, leur vitalité et parfois aussi leur réussite scolaire sont des facteurs positifs aux yeux des parents, des sources de réconfort ou même de fierté. Mais il y a aussi chez ces derniers une certaine ambiguïté à leur égard. Comme l’a observé J.Barudy, il y a une certaine tendance des parents au déni de la souffrance des enfants, ce qui correspond à un besoin d’éviter de sombrer dans une mauvaise conscience vis-à-vis d’enfants auxquels on a imposé un départ en exil sans s’interroger sur la manière dont ils le vivraient :
« Le déni de la souffrance de l’enfant est une façon pour les parents de se protéger en imaginant que l’enfant a été protégé de la souffrance par son jeune âge…ce déni de la souffrance de l’enfant s’accompagne du fait que celle-ci est souvent invisible : il mange, il joue ».
Au cours des enquêtes menées en 2003, nous avons pu recueillir de nombreux propos de parents qui témoignaient de la volonté d’épargner aux enfants le souvenir des drames vécus au pays et la conscience des incertitudes quant à l’avenir, comme dans le cas de cette maman congolaise qui voulait préserver la relative quiétude qu’elle constatait chez ses enfants qui étaient trop jeunes pour se souvenir des circonstances tragiques dans lesquelles elles étaient parties.
« …On est déjà loin de tout ça… Je ne parle pas de ça, je trouve qu’il n’y a pas d’intérêt. Quand on rencontre des compatriotes, on se dit des choses entre adultes mais pas avec les enfants, je ne vois pas l’intérêt de parler de ça. Pour l’instant, elles ne présentent pas de signes de pathologie. J’ai le sentiment qu’elles vont bien… Je ne sais pas si elles ont oublié ».
L’apparente insouciance des enfants représente pour les parents un bien précieux qu’ils s’efforcent de préserver dans la mesure où c’est le bonheur de leurs enfants qui justifie le bien fondé de leur choix de départ et leur donne la force de poursuivre leurs efforts en vue de l’obtention d’un statut qui sécurisera tout le monde.
Quelquefois, cette volonté de ne pas parler aux enfants pour ne pas les traumatiser peut dissimuler un certain sentiment de culpabilité vis-à-vis des enfants, comme l’exprimait une mère albanaise à propos de sa fille de neuf ans :
« C’est à cause de nous, les enfants souffrent, payent…On vivait bien là-bas. On regarde souvent la carte avec le bord de mer, la lumière, le soleil, la famille, tout très bien. A Paris, catastrophe ! Le climat toujours gris ! Beaucoup de différences. Olta, quand elle s’énerve, elle dit « Pourquoi, on est venus ? Pourquoi ? » On n’a pas tout expliqué. Trop petits. Olta a compris quelque chose, mais pas tout. Elle sait que c’est politique.
Quand les parents mettent eux-mêmes en doute le bien-fondé de leur choix de départ, ils expriment une culpabilité encore plus forte envers les enfants. C’est le cas de cette femme venue de Mongolie à la suite de problèmes quelque peu obscurs, mais dont elle pensait en fin de compte qu’ils auraient peut être pu se régler sur place.
« Ils étaient très joyeux quand on est venu, très contents, parce qu’un enfant sait quand on n’a plus de problèmes. On a pensé que maintenant on va pouvoir vivre tranquillement. Non la vie n’est pas celle qu’on attendait. Plus on avait de problèmes, plus de nouvelles difficultés apparaissaient. Jusqu’au moment où je me suis demandé pourquoi j’étais venue ici. Vraiment, je ne sais pas si j’ai bien pensé à leur avenir. J’ai regretté ma décision, même si je ne sais pas ce qui aurait pu arriver là-bas. »
Elle se souvient dans ces circonstances que ses enfants étaient réticents à partir.
« Mon fils n’était pas du tout d’accord. Il m’a dit : maman, je ne peux pas partir, j’ai beaucoup d’amis. Il a dit : je ne comprends pas. Comment je vais laisser mon école, les amis ? ».
Depuis, ses enfants ne lui reprochent plus son choix, mais elle n’est pas dupe et met cet acquiescement apparent sur le compte de la culture dans laquelle ils ont été élevés.
« Les enfants, chez nous, sont très attachés aux parents… ils respectent beaucoup le choix des parents…C’est pour ça qu’il n’a jamais dit : maman tu as bien fait ou pourquoi on est venu. Par rapport au choix, il n’a pas encore donné son avis. Dans la culture, on ne fait pas ça… ».
Cela ne l’empêche pas de se culpabiliser étant persuadée qu’en quittant son pays pour la France elle a gâché l’avenir de ses enfants qui ont pris du retard au niveau de leurs études et qui auront beaucoup de mal à se réinstaller en Mongolie.
D’autres parents se culpabilisent non par rapport à l’avenir mais par rapport au présent, constatant que leurs enfants semblent malheureux. Ceux qui ont des adolescents ayant dépassé les dix-huit ans se désolent de voir qu’il n’est pas possible de les scolariser et qu’ils sont souvent condamnés à l’ennui et à l’échec professionnel, comme cette famille albanaise le fait à propos de sa fille aînée, âgée de dix-neuf ans.
« On est très préoccupés par l’avenir de nos enfants et surtout Myriam, maintenant. Une fille de son âge, rester enfermée à la maison, sans aller à l’école, c’est dur ! Je suis triste pour elle. Les deux autres vont à l’école et elle reste comme moi, égale à une femme au foyer… Les soucis qu’on a pour elle, on peut les compter en double. A cause de notre activité politique, elle a subi ça : rupture, coupure, exil …Oui, on se sent coupables, on lui a coupé la vie là-bas et ici, on n’est pas capables de lui offrir la même chose car c’est à cause de nous qu’elle est ici ».
Dévalorisation de soi et perte d’autorité
La perte de tout rôle économique actif fragilise les parents qui craignent de se voir dévalorisés aux yeux de leurs enfants. C’est surtout le cas des pères qui prennent conscience que leur situation actuelle modifie l’image qu’ils offraient auparavant à leurs enfants. Un Congolais, père de quatre enfants, exprimait bien ce sentiment de dévalorisation de soi dans le regard des siens.
« Ils ont eu un père actif, un père qui sortait tous les matins et qui revenait le soir, un père qui n’était pas tout le temps avec eux à la maison. C’est vrai que les enfants sentent une certaine différence parce que, depuis que nous sommes en France, partout où nous sommes passés pour arriver en France, ils ont un papa qui est presque inactif, qui ne sort presque plus et les enfants doivent s’accommoder de cette vie là et à certaines situations, mais c’est mon devoir de père d’équilibrer ma famille ».
Pour beaucoup, la survalorisation des enfants qu’ils observent dans la société française et les protections dont ceux-ci sont entourés apparaissent comme un risque de perte d’autorité parentale. Beaucoup de rumeurs se colportent sur la permissivité excessive dont jouiraient les enfants en France et sur la propension des institutions à intervenir dans les affaires familiales dès que les enfants s’estimeraient en risque de subir des maltraitances.
« Là-bas, en Tchétchénie, les parents ont de l’autorité par rapport à leurs enfants, comme à l’armée, la discipline ! Ici, si on donne la fessée aux enfants, on nous menace. Les enfants disent : on va le dire à l’école et on nous emprisonne », dit un père tchétchène mi-souriant, mi-sérieux, approuvé par son épouse qui hoche la tête de manière entendue.
Pour les familles de culture africaine où les enfants sont traditionnellement tenus d’exprimer un grand respect pour les adultes, les allusions au renversement de pouvoirs entre parents et enfants reviennent dans presque tous les entretiens. Dans le cas de cette famille angolaise, la référence à la religion est aussi invoquée pour montrer les risques d’une telle dérive.
« Chez nous aussi, les enfants sont têtus parfois. Mais ici les enfants ont le pouvoir. L’enfant s’il veut quelque chose, si tu lui donnes la fessée, l’enfant peut appeler la police. Chez nous, ça n’existe pas ! Nous, ici, on n’a pas le pouvoir. Si les enfants ne respectent plus les parents, cela ne durera pas. La Bible le dit !… Mon fils, parce qu’il n’arrêtait pas de monter sur la table, je voulais le frapper. J’ai eu peur parce qu’à l’école, il va dire : mon père me frappe. Cette liberté affaiblit les parents. N’importe qui peut appeler la police ».
Ce type de propos se retrouve chez de nombreux parents immigrés et pas seulement chez les demandeurs d’asile vivant en CADA. Le décalage entre une conception de l’éducation familiale encore traditionnelle, telle qu’elle existe dans de nombreux pays et une conception occidentale plus ouverte et plus influencée par l’idée que l’enfant est un être qui a des droits induit toujours une incompréhension chez de nombreux parents étrangers. De plus, l’existence de nombreuses institutions à vocation éducative intervenant de façon assez active auprès des enfants avec une pédagogie différente de celle qui est pratiquée dans les pays d’origine donne aux parents l’impression d’une concurrence qui sape leur autorité. Mais l’accusation systématique de permissivité formulée à l’égard de la société française cache aussi un désarroi devant une évolution des enfants que l’on n’arrive pas à maîtriser quoiqu’on fasse.
Dans le cas des familles vivant en centre d’accueil, la présence d’animateurs intervenant quotidiennement au niveau des enfants renforce le sentiment de perte de pouvoir des parents, même si le travail de ces animateurs est en général apprécié. Inquiets de voir les enfants subir d’éventuels mauvais traitements dans des familles qu’ils savent perturbées et parfois en proie à des conflits internes s’exprimant par des violences, les intervenants sociaux manifestent une grande attention à tout ce que les enfants peuvent leur dire et interviennent parfois auprès des parents pour leur faire savoir qu’il faut agir différemment. Il y a inévitablement une propension à s’insérer dans la vie des familles, ne serait-ce qu’en raison du désarroi que celles-ci connaissent souvent et qui les rend moins aptes à assumer leur rôle auprès des enfants.
La difficulté est d’établir des limites au-delà desquelles l’action des intervenants sociaux n’est plus un appui mais une substitution. Plusieurs professionnels des CADA sont conscients des décalages que les parents perçoivent entre leurs références en matière d’éducation et celles qui existent ici. Malgré tous les efforts pour ne pas se substituer aux parents, ils ne peuvent éviter certains transferts des enfants sur leurs personnes ni annihiler les effets de leur pédagogie sur les relations à l’intérieur des familles, ce qu’exprimait bien une animatrice rencontrée au cours de l’enquête.
« Les enfants se sentent quelque part dans une nouvelle famille… Il y a des liens qui se créent avec les membres de l’équipe du CADA. Il y a une identification de ceux-ci à des membres de la famille… Dans l’équipe, deux femmes sont très maternantes. Les enfants font des transferts sur elles. Les femmes aussi s’appuient sur l’équipe du CADA pour se renforcer face à leur mari. Celui-ci n’est pas toujours d’accord… Dans les activités que j’organise, j’interdis que les enfants se moquent les uns des autres, s’insultent et se tapent. Il y a un gamin qui a joué sur le fait que j’ai dit qu’il est interdit de taper pour accuser son père ».
Le jeu sur les contradictions entre les principes éducatifs familiaux et ceux en usage dans la société d’accueil n’est pas propre aux enfants de demandeurs d’asile. Il a pu être observé chez de nombreux enfants d’immigrés qui cherchent à se construire une marge de liberté en opposant l’autorité « archaïque » censée être celle que leurs parents exercent sur eux et l’éducation faite de dialogue et de compréhension qui serait celle des institutions. Dans le cas des enfants de demandeurs d’asile, même s’il y a une conscience claire de ce décalage en termes d’éducation, il n’y a pas de volonté de dévaloriser les parents pour mieux s’en rendre indépendants. La situation défavorable dans laquelle les enfants voient leurs parents les amène au contraire à manifester vis-à-vis d’eux de la solidarité, de la compassion, voire même parfois à renverser les rôles et à se « parentiser » pour mieux protéger des adultes en plein désarroi, doutant de leurs choix et ne parvenant plus à assumer leur fonction parentale de décision et de protection.
Compassion et « parentisation » des enfants vis-à-vis de leurs parents
Malgré les tensions qu’ils peuvent connaître dans les relations avec leurs parents, les enfants voient surtout en face d’eux des personnes aux prises avec de nombreuses difficultés administratives et qui subissent les effets de l’attente et de l’inactivité forcée. Même quand le statut de réfugié a été obtenu, ils constatent que leurs parents continuent de rencontrer des difficultés au niveau du logement et surtout de l’emploi. Ils ont dans l’ensemble une attitude de solidarité par rapport à eux. Quand les parents semblent aller très mal, les enfants les plus jeunes manifestent de l’inquiétude et les plus grands dela compassion. Sensibles à l’injustice en raison de tout ce qu’ils ont vécu, les enfants ressentent eux-mêmes très douloureusement tous les rejets dont leurs parents sont victimes que ce soit par rapport à leur demande d’asile ou par rapport à leur recherche d’un travail correspondant à leur niveau de compétence quand ils ont pu obtenir le statut.
Les plus jeunes ne comprennent pas de façon précise les raisons qui perturbent leurs parents mais ils s’en inquiètent peut-être d’autant plus qu’ils perçoivent dans l’attitude de ces derniers des signes qui traduisent justement un malaise qui leur demeure peu intelligible.
Les plus petits expriment très spontanément leur inquiétude vis-à-vis de leurs parents à travers un désir de les aider comme cette petite fille algérienne de cinq ans dont les parents attendaient depuis plusieurs années une réponse à leur demande d’asile territorial après s’être vu refuser l’asile conventionnel.
« Je voudrais devenir médecin plus tard pour soigner papa et maman. Maman pleure, Papa est triste ».
Chez les plus grands on a déjà les moyens de comprendre la souffrance des parents et certains enfants analysent la situation de façon nuancée, établissant un lien entre les évènements vécus au pays et le mal-être présent de leurs parents, comme cet adolescent angolais qui tente de soutenir sa mère dans la phase dépressive qu’elle subit en associant cet état pathologique à la souffrance due à l’absence d’une soeur laissée au pays chez son oncle.
« Ma mère est triste. Elle est malade. Elle ne sait pas ce que sont devenus ma sœur, mes cousins et mon grand-oncle ».
Mais, c’est surtout le père qui fait l’objet des inquiétudes des enfants en raison d’un comportement qui révèle plus ses difficultés à supporter l’ennui que lui impose sa situation. Les mères inquiètent moins, en raison de leur capacité à s’investir dans le travail domestique que requiert la vie en CADA et à s’occuper étroitement de leurs enfants. Les pères, touchés par l’oisiveté forcée quand ils sont en situation de demandeurs d’asile et aux difficultés à trouver un emploi quand ils ont obtenu le statut de réfugié, apparaissent aux yeux de leurs enfants comme les principales victimes d’un exil par rapport auquel ils ont pourtant la principale responsabilité, qu’ils y aient été contraints en raison de leurs activités politiques ou qu’ils aient fait le choix de partir pour anticiper des difficultés à venir en entraînant avec eux une famille qui ne comprenait souvent pas ce choix. Ainsi une jeune arménienne de treize ans s’inquiète du comportement de son père qui contraste avec celui qu’il manifestait dans le pays d’origine.
« Je les trouve plus tristes. Ils regardent beaucoupla télé. Ils n’ont pas changé avec moi mais je les vois plus souvent. En Arménie, ils travaillaient beaucoup. Ma mère, elle s’occupe bien de moi ici mais elle a beaucoup de soucis, je vois. Mon père, il tourne dans la chambre comme on dit, comme en cage. C’est petit. Il ne fait rien, il boit beaucoup de café et fume. Il s’ennuie beaucoup et attend la réponse après recours parce que OFPRA a dit : négatif ».
Au sein de la même famille, l’aînée qui est âgée de vingt-trois ans analyse la souffrance de son père, comme on ferait un diagnostic psychologique.
« Papa, toute sa vie, il a travaillé. Ici, il sait pas ce qu’il faut faire. Il dort, il regarde la télé, il s’ennuie. Il est comme ça (elle affaisse la tête et laisse tomber ses bras ballants.). Il se sent… je dis « comme une loque ». Je sais pas comment on dit : fatigué alors qu’il n’a rien fait. Je dis « abattu », oui c’est ça, c’est ça : abattu et puis comme nul, aucun goût à rien. Les Cada, ils aident mais ce serait mieux qu’ils laissent travailler les gens. »
La compassion qu’elle éprouve pour son père lui interdit bien sûr tout reproche sur le choix d’un exil qui l’a séparée d’un pays qu’elle aimait et vers lequel elle espère repartir un jour.
« Ils n’ont pas choisi. Ils ne voulaient pas que ça arrive. Ce n’est pas de leur faute. C’est politique. Je ne leur dis pas : pourquoi ? Ils ont déjà trop de problèmes comme ça… J’espère retourner mais quand ? Je pense dans longtemps parce qu’à cause du problème de mon père, c’est un problème pour moi aussi, pour mes sœurs aussi… je regarde la télé arménienne, j’écoute la radio. Si je trouve les journaux, je lis tout sur l’Arménie. »
Chez certains adolescents, on trouve un désir de se substituer au père quand il est absent, afin assurer à sa place la protection de la famille. Un jeune Congolais qui vit seul avec sa mère et ses sœurs souffre de difficultés à l’école et compense son échec et les déceptions qu’il a ainsi occasionnées à sa mère par un fort investissement dans un rôle protecteur.
« Ça fait longtemps que je n’ai pas vu mon père… il dit qu’il faut que je fasse des efforts pour réussir dans mes études. Il me dit aussi qu’il faut que je m’occupe de mes sœurs, que je les aide car je suis l’homme de la famille maintenant. »
La substitution au père peut se faire en présence de celui-ci, quand il est trop affaibli pour jouer son rôle et que sa situation tend à le rendre pitoyable aux yeux de ses enfants. On trouve cette compassion ambiguë dans une famille iranienne disposant du statut de réfugié, mais qui vivait de façon très précaire, hébergée dans un centre d’urgence avec des ressources allocatives, les parents n’ayant jamais pu trouver un emploi. La mère et les filles étaient restées très attachées à un pays d’origine qu’elles avaient dû quitter en raison d’un acte politique du père. La fille cadette, âgée alors de dix-neuf ans et encore lycéenne, portait un jugement critique et teinté d’animosité envers son père, lui reprochant d’être la cause d’un exil qui tournait plutôt mal. Mais elle disait éprouver par rapport à lui un sentiment de pitié qui la conduisait à le prendre en charge dans ses démarches pour trouver un emploi.
« Quand on est énervées, ma mère et moi, on dit, c’est à cause de lui (le père). On lui en veut. Mais pour mon père, c’est encore plus dur. Il a 44 ans. Il est imprimeur depuis toujours mais comme il ne parle pas bien français, il ne trouve pas de travail. Il prend des cours mais c’est trop dur pour lui. Il dit qu’il n’arrive pas. Alors, il n’a pas le moral parce qu’avec le RMI, c’est dur, dur. Il ne demande pas à être chef d’une imprimerie, juste ouvrier. On peut voir qu’il connaît son métier. »
Elle comprend très bien ce que peut ressentir son père à ne pas se voir reconnu dans ses compétences ni dans son désir de travailler. Elle tente de lui apporter de l’aide jusque-là sans succès.
« Moi, j’ai écrit plusieurs lettres pour mon père dans les intérims. Rien ! Ça, ça m’énerve beaucoup. Quand on travaille, on ne déprime pas, on voit la vie en rose. Mon père a travaillé depuis l’âge de douze ans. Il n’a pas le moral. Il faut voir, ça nous fait de la peine ! ».
Cette quasi pitié qu’inspire la situation du père à sa fille, à peine majeure et déjà presque promue soutien de famille tout au moins au niveau symbolique, marque l’achèvement de ce processus par lequel les demandeurs d’asile vivent un renversement des positions au sein de la famille. Les enfants bénéficient de beaucoup d’appuis pour s’intégrer à la société locale grâce au suivi qui leur est offert dans les centres d’accueil mais aussi à l’école et dans les autres activités auxquelles ils peuvent participer. Les parents sont souvent réduits à l’isolement et à l’inactivité. Leurs efforts de formation, en particulier au niveau linguistique, sont souvent perturbés par les difficultés d’apprentissage dues à l’âge et surtout par le principal souci qui les accapare, celui d’obtenir un statut de réfugié. Ils ont tendance à tout sacrifier aux démarches administratives et à ne pas profiter assez de l’offre de formation en français qui leur est proposée dans les foyers.
Une fois devenus statutaires, il faut se préoccuper de trouver un logement, de l’aménager et de trouver un travail. Là encore, la formation linguistique est remise au second plan des préoccupations alors qu’elle conditionne étroitement l’accès au travail.
Dans les deux derniers cas cités, les enfants sont assez grands et assez mûrs pour prendre leur part de responsabilité et jouer un rôle positif pour l’ensemble de la famille. Quand les enfants sont encore jeunes, l’effondrement des parents risque de les conduire à assumer des charges trop lourdes pour eux. L’aisance avec laquelle ils semblent se sortir de telles situations n’est sans doute qu’illusoire et il est probable qu’à un horizon indéterminé, ils subiront un retour de tout ce qu’ils ont dû refouler pour être à la hauteur de responsabilités qu’ils n’auraient pas eu à exercer s’ils ne s’étaient pas trouvés dans cette situation particulière de demandeurs d’asile. Il serait instructif à ce sujet de mener une investigation plusieurs années après le passage en CADA auprès d’enfants de demandeurs d’asile devenus adultes à leur tour afin de tenter de comprendre comment, la distance une fois prise avec cette époque, ils considèrent cette période de leur vie, marquée par des responsabilités parfois étouffantes. Les initiatives d’appui à la parentalité qui peuvent être prises dans les CADA, comme celle décrite dans ce numéro par Séverine Masson répondent à un besoin des adultes dont ils n’ont pas forcément conscience aussi bien qu’à un besoin de leurs enfants qui ne se « parentisent » jamais sans conséquences plus ou moins critiques pour le développement de leur personnalité à venir.
Notes de bas de page
1 N.D.L.R. : Se dit du type de résidence des couples lorsqu’elle est déterminée par la résidence du groupe du mari.
2 Barou J., (1991) Familles africaines: de la parenté mutilée à la parenté reconstituée. In Jeux de familles, sous la dir. de Martine Segalen. Paris, Presses du centre National de la Recherche Scientifique.
3 Blanco D., (2009) Reconfigurations dans l’exil des familles de demandeurs d’asile, Structures et relations familiales de demandeurs d’asile au sein d’un CADA de la région lyonnaise et à travers un espace transnational, Mémoire de master professionnel en anthropologie, Université de Lyon II, année 2008-2009, p 71.
4 Barou J., Moro M-R, (sous la direction de), 2003, Les enfants de l’exil, Etude auprès des familles en demande d’asile dans les centres d’accueil, préface de Boris Cyrulnik, 330 p. Rapport réalisé pour la SONACOTRA et le Comité Français pour l’UNICEF.