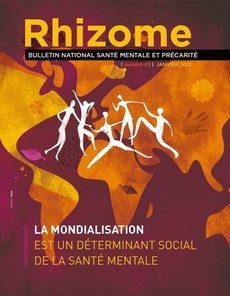Pour étudier l’attachement de la mère à son nouveau-né, dans l’extrême limite de sa défaillance, le chercheur est confronté à une difficulté majeure: comment aborder l’impact de la socialisation sur le lien le plus privé, développé dans l’intimité de la famille, voire l’intimité du corps à corps, presque anomique qui est cependant le laboratoire originaire de la socialisation de l’être humain ? Dans l’antiquité, nombre de civilisations ont fait peu de cas des nouveau-nés.
Le groupe social engendre des processus spécifiques conscients et inconscients qui relient la mère au groupe, à la parentèle, au voisinage et à l’ensemble du groupe social dans lequel elle est incluse, quand elle accouche. Elle est incluse dans un système de réseaux où sa place est en quelque sorte attendue ou acquise. Ceux-ci déterminent ou facilitent des actions qui l’aident à accueillir le bébé. En leur absence il lui est difficile de faire naître un enfant dans le groupe social, a fortiori, il est parfois exigé d’elle qu’il y renonce. Cet avis n’a pas toujours à être formulé explicitement, de nombreux signes l’attestent. A la croisée de plusieurs ordres de détermination, il est difficile de tracer des règles générales de l’attachement sans simplification excessive, sans réduire excessivement la complexité des situations aussi bien individuelles que sociales et les figer à travers le temps, comme s’il pouvait exister une fin de l’histoire. Toutefois nous pouvons essayer de dégager des tendances concernant les processus d’attachement de la mère à son enfant.
Dans un sens restreint l’attachement a été décrit comme une modalité du lien pulsionnel qui relie le bébé à sa mère, la modalité inverse sous le terme de bonding a d’abord été décrite par les éthologues. Du style d’attachement du bébé il a été retenu plusieurs modalités dont les deux principales sont secure et insecure, fiable ou non fiable. Ces modalités ont pu être mises en relation avec les modalités d’attachement de la mère à sa propre mère et avec les styles d’éducation parentale. Les facteurs de variabilité de la reproduction du mode d’attachement ont été étudiés surtout en terme psychologique, peu en termes sociaux ou économiques. Ils sont appliqués surtout à des modalités stables de lien, pour un public consentant à l’enquête. Ce type d’enquête, bien que ne l’ignorant pas, aborde toujours insuffisamment la face cachée de l’attachement : l’ambivalence maternelle, l’absence ou la régression du processus d’attachement, le déni, le foeticide et l’infanticide. Elle se place rarement dans une perspective structurelle hiérarchisée qui permettrait de dégager des mécanismes de régulation affectant des structures d’importance et de nature différente : macro régulations de type économique et démographique (mortalité infantile notamment) dont l’influence est souvent déterminante mais peu prise en compte (régulation de l’infanticide chez les Inuit, régulations culturelles de type idéologique et religieux ou mythologique, structures sociales intermédiaires dont la famille nucléaire n’est si nettement la forme prévalent qu’en Occident). Dans ce processus la mère est aussi reliée, par l’accumulation historique des propres événements de sa vie à son enfance et comment elle fut considérée et traitée en tant que fille, nourrisson ou adolescent. Ceux-ci sont profondément réactivés vers la fin de la grossesse. Le processus psychique qui permet de développer en sécurité l’attachement à l’enfant peut venir faire défaut, parfois contraint violemment par des facteurs externes ou au contraire insuffisamment soutenu par le socius.
Notations sur la complexité du processus
L’étude des modifications des processus d’attachement par le fait de la mondialisation conduit à une série d’approches complémentaires que ce texte ne fait qu’esquisser. Les processus décrits selon les disciplines concernent des échelles de temps différentes, des secteurs différents d’analyse, économique ou anthropologique par exemple, des analyses individuelles comme de groupe. En dehors des catastrophes, au sens topologique et social, soit des révolutions, les modifications structurelles opérées par les changements sociaux et économiques, sur les représentations psychosociales des rôles familiaux sont lents, s’étalant sur plusieurs siècles. L’attachement maternel dont la représentation populaire correspond à l’instinct maternel est systématiquement reporté dans les considerata sociaux et dans la plupart des organisations sociales comme évident, inexorable, systématique, inné et naturel. Il existe toutefois un certains nombre d’études anthropologiques qui nuancent ces attentes. L’analyse historique et psychologique, de très nombreux cas cliniques ou historiques, contredisent aussi cette assertion. Les cultures font « naître » l’être « humain » (c’est à dire un corps animé d’une humanité totale) à des périodes variées de son développement : depuis la conception jusqu’à l’âge de la marche. Elles le font aussi naître progressivement ou par un processus de tout ou rien. Dans toutes les cultures la responsabilité maternelle est diminuée ou absente avant l’humanisation. Les pressions sociales sur la femme dans son rôle maternel sont universelles, toutefois dans certaines sociétés, les écarts sont régulièrement sanctionnés de l’opprobre voire de violence ou même de la mort. Les défauts d’attachement (terme probablement inadéquat), à l’échelle du monde, se manifestent plus fréquemment envers les filles. Le statut social de la femme est une condition souvent négligée, bien que déterminante dans la qualité de la relation d’attachement que la mère va développer avec son enfant. Les relations entre statut social et psychologie individuelle ne sont pas univoques, toutefois un ressort essentiel du lien entre ces deux perspectives semble être la position narcissique. S’il est juste que la source de « l’amour d’objet », pour le nouveau-né, est le narcissisme maternel, il est aisé d’interpréter les relations entre statut social et qualité de la relation. Le statut social, en ce sens, ne se réduit pas aux seuls termes économiques mais plutôt à l’espace des prérogatives et de l’autonomie laissée à la femme, la qualité de l’estime et de la reconnaissance que lui procurent son entourage et la stabilité de son soutien. En toute logique dans les sociétés où l’épanouissement social de la femme dépend essentiellement de sa qualité à engendrer des garçons les taux de foeticide féminin, d’infanticide féminin, de mortalité infantile féminine, de maltraitance et de négligence des filles sont les plus élevés. Mais aussi de violence contre les femmes. C’est du fait de cette logique que certains auteurs ont voulu créer un statut particulier de crime contre les femmes.
Des obstacles réduisant les possibilités d’une étude objective
De telles études se heurtent aux préjugés qui assignent à toute mère « normale » un amour sans ambivalence pour son enfant. Ces études se heurtent aussi aux limites des sentiments intolérables que peuvent susciter l’impossibilité, l’échec ou l’absence de l’amour maternel dans sa fonction première : établir la possibilité de vivre. Elles se heurtent aussi à la difficulté de reconnaître qu’élever et faire vivre l’enfant dépend aussi d’un consensus social alors même que dans des mondes culturels qui ont largement contribué à façonner notre civilisation, telle la Rome antique, cette possibilité d’aimer et de prendre soin a longtemps reposé non sur la mère mais sur la primauté de l’autorisation paternelle.
Ces obstacles ne sont pas totalement rédhibitoires : des études ont été menées dans de nombreux pays chez des mères ordinaires ou bien déprimées, carencées, agressées ou abandonnées. Mais elles ont pour limites celles des transgressions admissibles, des non-dits, des tabous. Le premier obstacle est lié au déni. En effet, ni les individus ni les sociétés n’acceptent en général de reconnaître là où elles vont faire gravement défaut. Ceci est particulièrement vrai quand il s’agit d’une transgression majeure dans toutes les cultures (foeticide sélectif et infanticide, violence sélective envers les filles et les femmes). Toutefois, il faut souligner que les mensonges les plus flagrants cohabitent avec le secret partagé : beaucoup savent mais le savent souvent pour leurs proches seulement, leur « réseau social » disons. Par ailleurs la pratique du foeticide et de l’infanticide est attestée par la démographie avec une très importante élimination des filles avant la naissance mais les Etats ne le reconnaissent qu’à moitié, c’est à dire ni constamment ni en tout lieu, comme donc les individus. Le second obstacle est lié à l’entretien libre : la gêne, la honte comme les menaces personnelles ou juridiques sélectionnent les femmes ou les familles qui acceptent de participer. Un autre obstacle est lié aux impératifs moraux, culturels ou religieux : reconnaître sa propre agressivité ou son ambivalence, son rejet de l’enfant ou plus généralement son action agressive nécessite une liberté de pensée et une sécurité psychique et physique rarement acquise. De fait nous aurons une sélection des populations étudiées ; de leur origine géographique ou culturelle et pour chaque population particulière, seuls certains aspects seront facilement abordables. De ce fait, les généralisations sont difficiles et toujours en partie spéculatives.
La lutte des mères pour aimer et pour enfanter
Les mères sont elles activement partie prenante du rejet voire de l’empêchement à naître ou plus encore de l’infanticide actif ? Y sont-elles contraintes?
Cette question est quasiment sans réponse sur le plan quantitatif tant les enquêtes libres sont difficiles. Nous avons par contre des réponses sur le plan qualitatif : cas cliniques, recherches de type narratif, documents sociaux, anthropologiques, documents historiques, etc.
Dans les sociétés où la pression pour que naissent des filles est extrême, il est très fréquent que le foeticide cesse après la naissance d’un ou de deux garçons. L’urgence d’avoir un garçon qui continuera la lignée, portera le nom et protégera ses parents dans leur vieillesse et assurera leurs funérailles, est essentiel. Celui-ci une fois né, les mères seront libres d’enfanter des filles sans réprobation. Cet argument laisse supposer une capacité d’aimer leurs filles à l’égal des garçons. Toutefois la conclusion n’est pas sans incertitude : globalement dans ces pays, l’Inde notamment et certains pays musulmans, les filles restent moins bien traitées dans tous les domaines de la vie sociale. Le cas de la Chine est particulier : le statut de la femme semble moins déséquilibré que dans d’autres cultures pratiquant massivement le foeticide des filles ou l’infanticide. Jusqu’aux années 80 et avant la politique de l’enfant unique, malgré un long passé privilégiant la naissance d’un enfant mâle, le déséquilibre dans le ratio filles garçons avait été assez spectaculairement réduit.
La mère est partagée dans son devoir entre l’identification à l’enfant ou au discours dominant, schématiquement entre idéal du Moi et Moi idéal. Certaines mères assurent leur part dans le foeticide signalant en toute conscience ne pas vouloir donner à leurs filles la vie de misère que fut et que demeure encore la leur. Le processus d’identification, dans une vision dépréciée et résignée de Soi, participe alors de la volonté d’empêcher la naissance. Par contre il est plausible qu’il soit aussi un facteur d’opposition au geste infanticide. Dans les sociétés occidentales où aucun déséquilibre de ratio des naissances ne peut être mis en évidence, nous retrouverons souvent dans les gestes infanticides et dans les avortements à répétition (mais non dans les avortements uniques ou espacés) une image de Soi dévalorisée des mères ou des défauts d’empathie associés à des liens précoces peu chaleureux ou franchement carencés. Mais nous retrouvons plus souvent encore un défaut de soutien social, une famille peu soutenante ou compréhensive et un défaut d’éducation. L’amour pour l’enfant nouveau-né et le nourrisson a essentiellement pour base le narcissisme : aimer « ce que l’on est soi-même », « ce que l’on a été soi-même », « ce que l’on voudrait être soi-même », ou encore « la personne qui a été une partie du propre soi »1. C’est sur la base de la capacité de s’aimer soi-même et de se considérer comme être de valeur que la mère peut détourner cet amour pour soi vers l’être qu’elle vient mettre au monde. Pour reprendre un fameux psychiatre lyonnais, Jean Guyotat, la filiation psychique est à la fois métonymique, « la chair de ma chair » et métonymique « l’enfant de l’autre, des autres, de l’institution et du langage » et dans ces deux instances se profile le passage de la considération pour Soi vers la considération pour un autre de Soi.
L’absence d’investissement et sa part socio-culturelle
Un projet de déclaration2 par l’OHCHR, l’UNFPA, l’UNICEF, ONU-Femmes et l’OMS examine les conséquences de la sélection prénatale qui favorise les garçons en de nombreuses parties de l’Asie du Sud, de l’Est et de l’Asie centrale, où l’on a observé des ratios allant jusqu’à 130 garçons pour 100 filles. Il met en avant « un préjugé sexiste en faveur des garçons […] symptôme d’injustices sociales, culturelles, politiques et économiques fort répandues contre les femmes, et une violation manifeste de leurs droits humains ». Selon la déclaration, “une forte pression s’exerce sur les femmes pour qu’elles mettent au jour des fils … ce qui non seulement influe directement sur leurs décisions en matière de procréation, […] mais aussi les met dans une position où elles sont contraintes de perpétuer le statut inférieur des filles du fait de la préférence pour les fils ». De plus, « ce sont aussi les femmes qui ont à supporter les conséquences de donner naissance à une fille non désirée [dont] la violence, l’abandon, le divorce ou même la mort”. Les auteurs citent dans leur enquête une mère qui semblait totalement indifférente à l’infanticide signalant benoîtement que l’amniocentèse et l’échographie étaient devenues très préférables pour l’élimination des filles à l’ingestion à la naissance de la sève du laurier rose.
Bien que nous n’ayons pas le temps ici de convoquer l’anthropologie et sa démonstration des variations dans l’attitude culturelle vis-à-vis de l’humanisation de l’enfant, il semble que chaque civilisation construise une vision du monde que nous pourrions qualifier de religieuse ou de mythique qui réponde à la question à laquelle aucune réponse objective ne peut être donnée : « Quand l’être dans son développement devient-il suffisamment humain pour être protégé et aimé ? ». Dans une perspective plus psychologique, à quel moment du développement et sur l’invocation de quels motifs une société permet-elle ou promeut-elle l’identification du fœtus ou de l’enfant à un être doué d’un libre arbitre, d’une conscience, et éventuellement de l’accord des dieux pour vivre ? Ces prescriptions culturelles sont fluctuantes à travers l’histoire sauf peut-être pour les sociétés justement appelées traditionnelles. Leur impact souvent majeur n’est pas total sur les choix humains : la liberté se faufile dans la fraude, le mensonge, mais aussi dans des montages ingénieux de filiation ou de langage pour que naisse l’enfant et qu’il puisse vivre.
Les mythes, les religions, la culpabilité et l’échographie
L’indifférence maternelle à l’infanticide n’est pas le phénomène le plus général semble-t-il, bien au contraire. Le spectacle de la destruction de son enfant est le plus généralement insupportable. Les sociétés qui tolèrent ou même promeuvent l’infanticide s’en sont plus ou moins arrangées soit en le permettant à l’écart du regard social dans un lieu spécifiquement protégé (sociétés traditionnelles), soit en l’exposant au regard de tous mais dans l’espoir presque toujours vain qu’il sera sauvé (voir les mythes Romulus ou Moise), ou enfin en mettant en place des rites de pacification avec intervention de prêtres qui prennent sur eux une partie de la faute ou bien offrent une réparation aux dieux ou à l’âme de l’enfant.
L’échographie et l’amniocentèse qui se sont répandues parmi les pays le plus démunis jusqu’au fond des campagnes malgré une régulation judiciaire très modérément efficace, ont résolu au moins un problème : elles ont permis une régression très importante de l’infanticide. La globalisation a apporté ce progrès mais elle a engendré un problème nouveau : la relative facilité du geste abortif a conduit à l’amplification du déséquilibre des naissances avec l’ensemble des incroyables conséquences qui semblent se dessiner concernant les statuts individuels (aggravation du statut des femmes des régions déshéritées vendues et soumises, amplification de la prostitution, militarisation accrue de la société). Les poids respectifs de la religion, de l’économie et de l’éducation sont difficiles à estimer. Les études menées par exemple en Inde montrent que lorsque des régions ou des ethnies, ou des sujets sont fortement engagés dans les religions étudiées (hindouisme, islamisme, christianisme), les taux d’infanticide ou de foeticide sélectifs décroissent significativement mais les ratios demeurent déséquilibrés. Dans certains pays musulmans où l’infanticide (ou le foeticide) sélectif reste encore pratiqué (toujours bien moins qu’en Inde ou en Chine), la plupart des auteurs attribuent ce déséquilibre plus aux reliquats de la structure préislamique de la société qu’à la religion elle-même : les croyances et les valeurs, l’économie familiale, et plus encore le statut de la femme, semblent jouer le rôle principal.
Concernant l’économie, des arguments cohérents sont apportés selon lesquels la lutte contre la misère va permettre de réduire le déséquilibre dans le statut des genres, les femmes étant les premières à souffrir de la pauvreté. De toute façon, l’enrichissement d’une nation ou d’un (sous) continent ne peut s’établir que sur de longues décennies et ne paraît pas un levier d’action suffisant à court terme. Des programmes spécifiques d’aide aux mères ont été mis en place mais leur pérennité n’est pas assurée et les résultats sont encore en cours d’évaluation. L’impact de l’éducation est moins étudié car souvent confondue dans les études épidémiologiques avec le revenu des familles, les familles riches étant généralement plus cultivées. Il est aussi postulé que le partage de l’éducation, au minimum lecture, écriture et savoir techniques, permettrait une amélioration du statut et une plus grande autonomie des femmes. Il serait toutefois important de distinguer le quid de l’éducation et non seulement le niveau général : qu’enseigne-t-on sur les femmes et les mères notamment ? Sur la liberté humaine et les structures sociales ? Sur l’histoire ? Les enseignements techniques tendent-ils à une promotion sociale ou une nouvelle forme d’asservissement ? L’ouverture aux savoirs universitaires est-elle aussi promue ?
Socius, droit des femmes et mondialisation
Bien que révélateur, et peut être parce que révélateur d’une intolérable ambivalence maternelle, l’infanticide est un thème peu présent de l’historiographie, marginal en sociologie, atypique en psychologie, à peine plus fréquent en anthropologie, mieux étudié en biologie animale et en éthologie. Il est un symptôme à la fois individuel et culturel, révélant un « malaise » dans la parentalité et dans la relation entre les sexes, aggravé encore par les facteurs économiques. Bien qu’exceptionnel, il interroge les fondements du droit et de la définition de la personne humaine. Il nous place devant l’énigme de la maternité, de l’attachement et de l’amour maternel. Les explications psychologiques les plus consensuelles quant au geste infanticide paraissent aujourd’hui fondamentalement limitées par la non intégration des facteurs sociaux dans l’étude des processus de filiation et d’affiliation « psychiques », mais aussi dans la définition de Soi, le sens de Soi et la possibilité de l’attachement maternel. Elles font souvent abstraction de l’ambivalence de l’amour maternel et des forces mises en jeu permettant de vaincre cette ambivalence. L’étude de l’infanticide, lorsqu’elle est portée à travers les âges ou à travers les civilisations, montre combien les facteurs culturels organisent les processus d’affiliation et les rôles sociaux dévolus à la mère. Ils s’intriquent étroitement avec les facteurs économiques.
L’infanticide, surtout féminin, est aujourd’hui bien plus répandu dans les pays où le statut de la femme est peu valorisé (voire discrédité) hors des domaines de la procréation et plus généralement de l’ensemble des aspects liés à la maternité. Il n’est pourtant pas également présent dans toutes les sociétés inégalitaires quant aux genres, montrant qu’aucun facteur univoque ne peut expliquer les taux très élevés rencontrés parfois. Dans les sociétés inégalitaires quant aux genres, la grossesse et les relations sexuelles en dehors du mariage sont souvent fortement réprimées ; la femme et son enfant se voient en ce cas rejetés ou blâmés au sein de leur propre famille, exclus du socius, voire en certains lieux gravement condamnés. Pour certains auteurs, dans ces conditions, l’infanticide est un crime contre les femmes, l’élimination des filles nouveau-nées prolongeant l’opprobre dont les femmes sont victimes, une forme de violence se surajoutant à d’autres.
La diffusion rapide des techniques diagnostiques échographiques par le fait de la mondialisation a conduit à une importante réduction du taux d’infanticides dans les pays connaissant une forte industrialisation, mais à la multiplication des avortements sélectifs. Ce phénomène reproduit, un siècle après celui constaté en Occident, la réduction drastique des infanticides et la progression des avortements devenant moins dangereux et surtout légaux. Toutefois le progrès des droits des femmes, les nouveaux statuts de l’enfant illégitime et l’autonomie du travail salarié féminin ont semblent-ils aussi joué un rôle important.
Le droit : des peines sévères rarement appliquées
Selon les époques et les cultures, les crimes commis contre les nouveau-nés, presque exclusivement du fait des mères3, ont donné lieu à une attitude clémente ou à une sévérité parfois impitoyable. Dans l’antiquité, nombre de civilisations ont fait peu de cas des nouveau-nés, au moins avant l’attribution d’un nom. En France, au Moyen Age l’infanticide était souvent puni avec une extrême sévérité quand il était jugé, mais il l’était assez rarement ou bien ne pouvait être qualifié. Durant l’Ancien Régime, dans de multiples aires culturelles européennes, l’infanticide et l’avortement furent longtemps tolérés, voire perçus comme nécessaires en cas de surcharge démographique. A partir du 16 e siècle, le baptême placé au centre du débat religieux a grandement contribué à rejeter l’infanticide du côté de l’intolérable (D Tikova) : les enfants morts sans baptême étaient, selon la doctrine catholique, privés de salut. Nous retrouverons un point clé où apparaît sinon la culpabilité, au moins la notion de crime : après le début ritualisé du processus d’humanisation4, il est total. Les peines terribles étaient surtout érigées en repoussoir (les moins graves étaient la pendaison ou la décapitation). Les juges eux-mêmes tendaient à ne pas les appliquer invoquant surtout le doute et les femmes étaient rapidement libérées.
Au 19 e siècle, la mortalité décroît progressivement mais la misère sociale et l’exploitation économique de l’enfant se sont largement développées. Le compte général de la justice criminelle édité depuis 1825 renseigne sur tous les infanticides connus ou suspectés. Ils sont environ 1000 par an au début du 19e siècle et représentent environ un tiers des crimes de sang. En 1810, la préméditation est exclue de la définition, l’assassinat n’est donc plus retenu comme qualificatif de la peine. Tout au long du 19 e et 20e siècle, malgré la sévérité du code Napoléon, persiste une grande clémence des jugements. Les fondements en droit de l’indulgence sont liés aux trois conditions nécessaires pour qu’il y ait infanticide : que la victime soit un nouveau né, quelle soit née vivante et qu’il y a eu l’intention de donner la mort ; sur chacun de ces thèmes, les tribunaux vont arguer d’incertitude pour réduire la peine ou prononcer l’acquittement. En 1810, la préméditation est exclue de la définition, l’assassinat n’est donc plus retenu comme qualificatif de la peine. Un siècle plus tard, le qualificatif est rétabli mais la peine est réduite, chez la mère seule. En 1941, le gouvernement de Vichy qui rappelons-le, pouvait condamner l’avortement de façon extrêmement sévère, ôte à l’infanticide son statut de crime. L’objectif était de le faire juger par des magistrats professionnels réputés plus sévères et non par des jurys populaires souvent indulgents et compatissants. En 1954, l’infanticide fut recriminalisé, mais la peine était alors réduite. Il est défini comme le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né, commis avant l’expiration du délai de trois jours imparti pour déclarer l’enfant nouveau-né à l’état civil. La relative clémence des législateurs, et celle encore plus effective, des jurés allaient de pair avec une conception selon laquelle l’infanticide était commis par une mère qui, « dans le désordre de ses facultés physiques et morales […], [avait] agi presque à son insu », « ces jeunes filles [étant] […] plus malheureuses que coupables ».
Aujourd’hui le code pénal français n’accorde plus d’intérêt à la spécificité du crime : il s’agit d’un homicide comme tout autre homicide mais aggravé par la vulnérabilité de la victime. De fait, il ne bénéficie plus de l’atténuation de peine de principe qui était présente non seulement dans la loi française jusqu’en 1994 mais aussi dans « l’Infanticide Act » qui depuis 1938 inspire de nombreuses législations de droit anglo-saxon telles le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Danemark ou la Suède : la préméditation n’est pas retenue. Les crimes maternels commis avant la fin de la première année connaissent dans ces pays une atténuation de peine de principe et la plupart des femmes bénéficient d’une probation et d’un suivi psychologique.
Les classifications psychiatriques et la symbolique de l’humanisation
Ce n’est qu’au 19 e siècle que l’infanticide entre de plain pied dans le domaine de ce qui sera la psychiatrie à travers notamment les avis d’experts judiciaires. D’emblée, les concepts que la psychanalyse nommera un siècle plus tard « ambivalence maternelle » et « folie maternelle ordinaire » seront des points importants du débat. La question essentielle étant de savoir si « l’accouchement, bien que naturel, peut modifier l’état général de la femme de manière à développer en elle le penchant au meurtre » (Michu, 1826 ; Briand, 1821). Marcé, quant à lui, remarquera le sentiment d’aversion que peut éprouver une femme envers son nouveau-né, éclatant parfois en un véritable délire, soulignant qu’ordinairement les sentiments tendres s’éveillent un peu plus tard.
Il existe une multitude de classifications des crimes sur enfants selon leur moment de survenue et le lien de filiation : néonaticide avant un jour, filicide meurtre dans la lignée paternelle, libericide sans lien de filiation nécessaire. Infanticide est le terme le plus générique et le plus polysémique : meurtre d’un enfant quel que soit l’âge, seulement avant un an, d’un nouveau-né, etc. Nous désignerons ici par infanticide ce que désignait la loi française avant 1995 : l’homicide commis sur un nouveau-né avant qu’un nom lui soit attribué et déclaré à l’état civil dans la limite des 72 heures après la naissance. Toutefois hors de France, l’aspect de la dation du nom reste peu connu. Les infanticides cachés semblent toujours avoir été commis sur des enfants sans nom.
Un consensus psychiatrique, établi sur la proposition de Resnik, a permis de conserver une dénomination spéciale aux crimes commis sur les enfants avant 24 heures de vie : le neonaticide. L’essentiel des infanticides précoces sont bien commis durant les 24 premières heures, souvent immédiatement après la naissance. Néonaticide et infanticide précoce sont donc, dans ce texte, à peu prés synonymes.
La loi française jusque 1994 introduisait l’opération symbolique de la dation du nom pour qualifier l’infanticide. La socialisation de l’être naissant, semble un point clé qui distingue, non seulement du côté du droit mais aussi du psychisme, l’infanticide de tout autre crime. La nomination du nouveau-né et le « dépôt » de son nom à l’état civil s’apparentent à un rite, ils en ont tous les caractères, rite « fondateur », en ce sens « qu’universel » (relativement à une société donnée) et incontesté. Culturel, il a sinon l’apparence, du moins l’« évidence », d’un fait de nature. Il est une condition sociale de l’humanité du sujet.
Cette distinction, a priori étrange, de la déclaration à l’état civil révèle aussi un point clé du droit en général : le crime est la qualification d’un acte commis à l’encontre d’un être (la « victime ») à qui la société reconnaît suffisamment d’humanité. Il s’agit de déterminer quand et dans quelles conditions ce caractère d’être humain peut être attribué ; dans le droit français actuel : être né vivant. Toutefois avant 1995, avant d’être nommé, l’homicide du nouveau-né engageait moins sévèrement la responsabilité de la mère.
Un crime sans pathologie psychiatrique ?
En dehors des situations de délire avéré, nos connaissances ont peu avancé. En 1874, pour Tardieu, « ce n’est pas la folie, ce n’est même pas la perversion transitoire des facultés ». En 1897, Bouton, magistrat, avance l’idée que le geste infanticide est un équivalent suicidaire qui résulte du manque d’individuation du nouveau-né avec la mère : « Pour la fille […] qui souffre et se débat règne en maîtresse la pensée que l’enfant [sorti de son sein] est un prolongement de son corps […]. Si le suicide lui semble permis, pourquoi ne pourrait-elle alors tuer une partie de son être »? D’autres encore plaideront pour la psychose transitoire, en l’absence même de délire. Ce pourquoi répond à la question : comment est-ce possible psychologiquement ?
L’isolement social ou familial, voire l’hostilité de l’environnement, la précarité, un faible niveau culturel, une pensée « magique », ou l’un de ces facteurs, caractérisent encore la majorité des mères infanticides. L’enfant ne peut être assumé, tout semble s’y opposer. La naissance apparaît comme une catastrophe sidérant la pensée et l’action, conduisant à une sorte de préoccupation négative récurrente. Etrangement, ni l’avortement, ni l’abandon ne sont des solutions envisagées ou alors vite écartées. Après une grossesse cachée, la mère met fin à la vie de l’enfant soit activement soit en l’abandonnant, parfois dans un lieu qui lui laisse la possibilité d’être retrouvé vivant. La culpabilité est souvent présente, quelquefois intense, mais sans que ces femmes replongées dans le souvenir de la naissance aient pu envisager une autre issue à cette grossesse, même rétrospectivement. Elles semblent s’être trouvées dans une véritable impasse psychique. Des troubles psychiatriques sont présents dans seulement 20 à 30% des cas : syndromes dépressifs, personnalité borderline, déni de grossesse, bien rarement épisodes délirants, etc. S’ils favorisent le geste, ils ne l’expliquent pas toujours. Environ 60 à 80 infanticides (parfois jusqu’à 100) seraient commis régulièrement chaque année en France et une dizaine d’affaires jugées par an. En général, les affaires ne concernent qu’un seul enfant, la répétition connue du geste infanticide semblait rare jusqu’aux affaires retentissantes de ces dernières années. Les statistiques restent très difficiles à établir : des infanticides réels à ceux supposés et ceux jugés, le nombre diffère. Dans certains pays émergents, le développement exponentiel de la pratique de l’échographie s’est accompagné de la multiplication massive des avortements sélectifs, diminuant d’autant le taux d’infanticides. En France, l’introduction de moyens contraceptifs a probablement joué un rôle mais celui-ci semble étrangement secondaire. La possibilité d’accoucher « sous X » contribue aussi probablement à réduire le taux d’infanticides.
L’absence d’investissement : une passion en négatif ?
L’infanticide est souvent précédé par l’absence d’investissement de l’enfant, plus rarement par un investissement pathologique (délire, déni de grossesse). Le défaut d’investissement, quand il est massif, s’associe souvent à une grossesse cachée et à un accouchement secret. L’enfant a échappé aux rituels qui l’instituent dans la filiation symbolique : reconnaissance paternelle et sociale avec la dation du nom. En pratique commune, un enfant est sans nom tant que le père ne s’était pas déplacé vers l’institution pour le déposer. Le défaut du travail d’humanisation semble prendre racine dans l’absence de déploiement de l’activité fantasmatique maternelle durant la grossesse. L’investissement du ventre comme lieu d’un être en devenir, être du langage et du socius, n’a pu s’établir. Cette configuration se retrouve dans de nombreux infanticides, que ceux-ci aient été précédés d’une grossesse cachée, cas le plus fréquent, ou bien plus rarement d’un déni de grossesse, voire plus étrangement encore d’une grossesse montrée.
Les hypothèses sur le travail psychique contemporain de la grossesse que nous proposons ici s’appuient essentiellement sur deux sources : la connaissance des troubles présentés pendant – et surtout « autour » – de la grossesse : psychoses puerpérales, perturbations des relations précoces mère-enfant, qui s’instaurent dès la vie fœtale et psychothérapies psychodynamiques de femmes enceintes. Plusieurs auteurs, proches en cela des premières contributions de la psychiatrie à l’étude des désordres puerpéraux, font état de phases de « déstructuration » ou s’accordent à attribuer une qualité pseudo psychotique à certaines moments du travail psychique ordinaire de la grossesse. Selon Racamier (1979), à certaines étapes, le sens de l’identité personnelle devient fluctuant et fragile et la relation d’objet s’établit sur le mode de la confusion de soi et d’autrui. Winnicott (1969) a également décrit chez la mère, après l’accouchement, un état psychique particulier, « proche d’une modalité psychotique », et qu’il qualifie de « maladie normale », la préoccupation maternelle primaire : « cet état organisé (qui serait une maladie, n’était la grossesse) pourrait être comparé à un état de repli ou à un état de dissociation ou à une fugue, ou même encore à un état plus profond tel qu’un épisode schizoïde au cours duquel un des aspects de la personnalité prend temporairement le dessus ». L’auteur ajoute « Je ne pense pas qu’il soit possible de comprendre l’attitude de la mère au début de la vie du nourrisson si l’on n’admet pas qu’il faut qu’elle soit capable d’atteindre ce stade d’hypersensibilité – presqu’une maladie – pour s’en remettre ensuite ». Surtout, la plupart des auteurs insistent sur l’aspect régressif de la maternité, qui va permettre à la femme d’investir son fœtus en s’identifiant à lui. Le désir de dépendance (à la mère, au mari) manifesté par la femme aurait pour Bowlby une fonction d’activation de l’attachement. Ammaniti et Ballou montrent que la grossesse suit un schéma de « réconciliation » à la mère, centré sur les problèmes de dépendance et d’individuation. La grossesse, ou plus largement l’accès à la « parentalité », ne « saurait se réduire au seul niveau du « fonctionnement mental individuel ». Elle est également le lieu de « passage », ou d’inscription, de multiples significations et projections inconscientes, issues de l’histoire individuelle, conjugale, familiale, et « transgénérationnelle » des deux parents, et toute problématique transgénérationnelle tendra à être ravivée par la grossesse et l’accès à la parentalité.
Ce travail n’est pas achevé à la naissance. L’étonnement des parturientes devant leur enfant, ce « côté toujours un peu médusé de la jeune femme qui vient d’accoucher » est le signe, selon Colette Soler, de sa nature hors symbolique. Anne Henry cite le « travail de jaugeage » qui consiste à le comparer aux individus qui forment sa famille en attribuant chacun de ses traits à telle ou telle personne et qui « ne peut structurellement pas s’achever car la singularité est irréductible». Dans les tous premiers moments suivant la naissance, l’accordage entre l’enfant conçu comme métaphore d’un désir et l’enfant conçu comme produit du corps, enfant métonymique s’établit progressivement. Cette condition est essentielle à l’humanisation. Il est remarquable que la loi française accordait trois jours au dépôt du nom, ces trois jours marquant aussi l’acmé du blues débutant, interprétée par Parker comme le terme de la période schizoparanoide maternelle, moment où l’enfant s’établit comme définitivement réel, et le début de la phase « dépressive » maternelle où l’altérité de l’enfant est définitivement reconnue. C’est l’enfant lui-même, mais aussi la parentèle et les autres femmes présentes, qui vont activer chez la mère la possibilité de se refléter à travers l’enfant et donc de l’humaniser. Il est le premier à la stimuler avec sa propre activité encore réduite mais significative comme le montrent ses mouvements d’imitation et d’orientation présents dès la naissance. Mais parfois chez la mère quelque chose résiste, d’inqualifiable, qui rend l’enfant trop réel, une chose. Il reste d’une étrangeté trop radicale.
Toutefois cette absence d’humanisation ne peut pas toujours être imputée à la seule femme, car même si c’est bien la mère qui commet généralement l’infanticide précoce (ou néonaticide), c’est une femme prise dans un réseau social dans lequel elle se sent, à tort ou à raison, réellement ou fantasmatiquement exclue en tant que mère, qui commet le crime. Par ce rejet, sa famille, en premier sa mère et le père de l’enfant sont souvent amenés à jouer un rôle de premier plan.
Prévention des infanticides ?
Après l’accouchement peut s’établir la relation entre la mère et son nouveau-né qui va conforter en général ce dernier comme objet d’investissement pérenne. Le caractère d’étrangeté va s’effacer avec l’établissement progressif d’une intimité et d’une familiarité. Dans l’imaginaire populaire l’accueil de l’enfant par sa mère est immédiat. Pourtant cette immédiateté apparente masque les étapes successives d’un travail d’adoption de la chose étrange comme familière. De « ça » dans « mon ventre » à « mon enfant », « mon bébé ». Ce travail a débuté durant la grossesse. C’est à cette étape que la mère a commencé à penser son bébé comme étant accueilli, c’est-à-dire désiré par quelqu’un d’autre qu’elle-même, dont la valeur est reconnue à la fois par elle-même et le socius. C’est à cette étape que le socius a développé des marques de respect et de considération pour la femme enceinte. Ces marques sont attendues par la future mère, d’autrui en général, de ses parents et de son conjoint en particulier.
Des données historiques, il semblerait que les politiques de prévention des infanticides les plus efficaces semblent avoir été des politiques modifiant le droit des femmes enceintes. Dans la Chine ou l’Inde contemporaine, la répression seule semble peu efficace tant être parent d’un garçon (ou de plusieurs) semble culturellement primordial. De nombreux auteurs ont souligné qu’en Europe, la possibilité de confier son enfant anonymement à l’adoption a aussi joué un rôle important. Dans d’autres lieux, le « confiage » peut jouer un rôle équivalent. Néanmoins en Europe, ce type d’action s’est aussi associé dès lors que l’abandon était massif (Roumanie au XXe siècle, France au XVIIe et XVIIIe siècle) à une importante morbidité et mortalité. Toutefois, enseignement possible pour le présent, certaines politiques sociales auraient dans le passé donné l’exemple de progrès importants. Par exemple D Tikova cite sous la monarchie des Habsbourg une moindre répression de la sexualité (féminine), notamment des grossesses illicites. Parallèlement il était délivré des certificats de « bonne conduite » qui permettaient aux filles-mères de retrouver plus facilement un travail ou un mari. Les autorités devaient aussi veiller au statut des filles-mères, réduire l’opprobre dont elles étaient victimes et inciter les parents à ne pas les traiter trop sévèrement. Il était associé à l’ensemble de ces directives la promesse du secret plutôt que la publicité.
La situation actuelle de la femme dans certains pays en voie de développement, notamment la restriction de ses droits sociaux et la punition (presque) exclusivement féminine de la sexualité adultère et de ses conséquences, n’est pas sans évoquer quelques similitudes, notamment dans les classes défavorisées avec le statut de la femme en Europe au 17e siècle. Or, il reste remarquable que c’est par la modification du statut de la femme, promouvant son autonomie au travail et son statut social, s’opposant à la répression judiciaire et familiale que les autorités de l’époque, sous la domination des Habsbourg, ont tenté et semble-t-il réussi à diminuer le taux d’infanticide. Aujourd’hui, le crime d’infanticide, résiduel mais avec l’impression d’une part incompressible dans la plupart des pays économiquement développés, reste « assez » répandu dans certaines sociétés économiquement défavorisées dans lesquelles le statut social féminin est lui-même très abaissé. Dans tous les cas, il est commis le plus souvent peu après la naissance : le nouveau-né est alors dénié comme humain, présenté comme chose, innommé, en deçà de la reconnaissance paternelle.
C’est donc dans de nombreux cas le sentiment de faire naître l’enfant dans un environnement hostile, l’impression de fermeture du destin et le sentiment qu’il n’y a personne pour l’accueillir lui et sa mère que la réprobation, qui pourrait contribuer de façon prééminente au geste infanticide. Dans la plupart des cas d’infanticide la mère ne pouvait pas envisager un avenir possible à l’enfant du fait de l’association d’une vulnérabilité personnelle et sociale et des conditions hostiles de l’environnement: réprobation réelle de l’entourage, absence de protection ou rejet des parents ou du mari chez une femme peu éduquée, dépendante psychologiquement, socialement et parfois misère économique. Dans certaines sociétés, l’hostilité de l’entourage est manifeste : garder l’enfant conduirait au rejet, à l’éloignement ou à la menace de rétorsions. L’infanticide alors se produit par la conjonction de facteurs sociaux, macro et micro sociaux, qui dans certains pays sont si écrasants qu’ils réduisent à presque rien la résistance psychique possible et à des facteurs psychologiques individuels. Si l’image de l’investissement délirant de l’enfant prédomine dans l’imaginaire médical de la femme infanticide, c’est bien plus souvent l’opposé qui se produit : un enfant qui n’a pu être investi (plus souvent que désinvesti) et qui se réduit à n’être qu’une chose.
Conclusion
L’infanticide commis dans les pays économiquement développés est un crime « résiduel ». Il affecte environ une femme pour 5000 naissances et autant les filles que les garçons. Les causes « pleinement » psychiatriques affectent au maximum 30% des cas : mère délirante ou présentant un passé « traumatique », personnalité borderline, « psychose blanche », épisode mélancolique ou dans les suites d’un déni de grossesse. En dehors de ces cas la psychologie maternelle demeure une énigme et renvoie aux débats du XIXe siècle. Plus qu’un état de folie autour de la naissance il semblerait que ce puisse être plutôt l’absence de « folie maternelle ordinaire », cet amour passionnel pour l’enfant nouveau-né qui rend possible le geste infanticide. L’étude de l’infanticide dans les pays tels que l’Inde, la Chine, le Pakistan, Bangladesh, Taïwan et certains pays du Caucase démontre l’impact exceptionnel des facteurs sociaux-économiques et culturels sur la possibilité d’attachement maternel. Si l’on suppose que l’amour porté par la (future) mère à son enfant prend sa source dans l’estime et l’amour qu’elle se porte elle-même, il est alors possible d’avancer l’hypothèse que toute société où le statut féminin est profondément dévalorisé hors de son rôle procréateur favorise l’infanticide féminin. Il résulte à la fois de la pression directe exercée pour que naisse (au moins) un garçon et de la vulnérabilité des femmes qui leur rend difficile d’accorder une valeur suffisante à leur fille contre la pression (y compris économique) de l’entourage. Le taux d’infanticide n’est pas connu car caché. Il ne peut être qu’estimé. L’apport des techniques par la mondialisation a toutefois entraîné sa diminution massive au profit des avortements sélectifs. Ceux-ci peuvent moins échapper au contrôle d’Etat. Les organismes nationaux et surtout internationaux réagissent par une incitation politique et culturelle d’information et de lutte contre cette violence qui n’est pas faite qu’aux enfants mais indiscutablement aux femmes elles-mêmes.
Les regards croisés de l’épidémiologie, de l’anthropologie et de la sociologie portés sur l’infanticide interrogent la différence socialisée des sexes et leur impact sur l’attachement maternel. Devant la diffusion croissante de ces études, la montée des neurosciences et de la biologie des comportements, l’exigence de la statistique, les études psychanalytiques modernes ont avec beaucoup de modestie renoncé à intégrer la question sociale à l’étude de l’infanticide, alors même qu’elles semblent capables d’offrir une contribution significative à une réflexion à laquelle aucun corpus n’apporte à lui seul de réponse satisfaisante.
Notes de bas de page
1 Freud. (1914). La vie sexuelle, Paris : PUF. 1969, p. 96.
2 Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (OHCHR), Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et Organisation Mondiale de la Santé (OMS). http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/FDOC12715.pdf
3 Exceptionnellement du fait direct du père ou de la grand-mère maternelle, bien que ceux-ci puissent jouer selon les époques et les civilisations un rôle déterminant dans la décision de l’acte.
4 Processus d’inclusion dans le monde des « humains ». Les meurtres coutumiers et les génocides ont été souvent précédés de rites ou d’équivalents rituels d’exclusion du monde des humains (retrait du nom ou qualifications animales notamment).