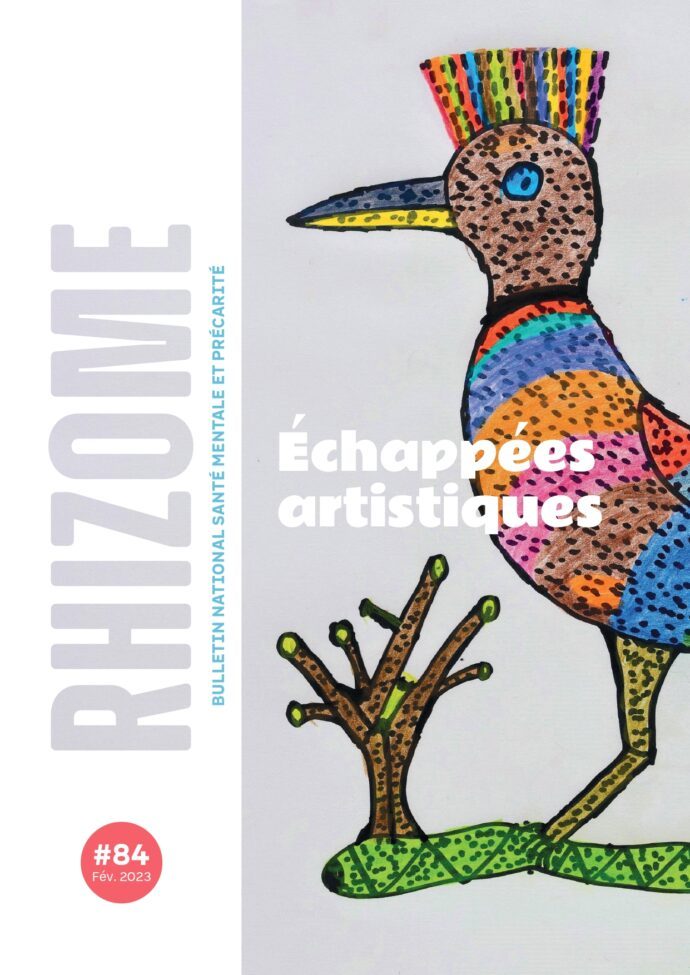Les expressions artistiques nous invitent à porter une attention particulière à ce qui nous entoure, à nos expériences sensibles et à leurs pouvoirs.
Penser l’environnement pour prendre soin
La création artistique trouve aujourd’hui sa place dans les interstices du soin, sur les murs des unités de l’hôpital et dans la conception architecturale même des lieux. Ouvrir des institutions auparavant fermées et intentionnellement coupées de la cité transforme et mêle les espaces ainsi que leurs usages : on peut se rendre dans un hôpital psychiatrique pour assis- ter à un échange avec une metteuse en scène en amont d’une représentation théâtrale, à une exposition ou encore à un parcours d’installations interactives, comme pour (se) soigner. L’hospitalité du lieu s’incarne ainsi dans son ouverture, une continuité entre l’extérieur des enceintes et ce qui se passe en son sein. L’architecture et l’organisation même de ces espaces, la couleur des murs, la luminosité d’une pièce, le mobilier, la présence ou non d’éléments naturels, décoratifs ou artistiques peuvent être questionnés : participent-ils d’un prendre soin? Présumer que le design, l’esthétique et l’art ont une place légitime dans ces lieux participe à modifier la perception de ces espaces et des personnes qui s’y trouvent.
Se rétablir par l’expression artistique
Que disent nos créations de nous ? Que laissons-nous transparaître à travers elles ? La création artistique peut-elle nous relier à notre intériorité et, par conséquent, l’exprimer ? Quand il s’agit d’art-thérapie ou d’ateliers thérapeutiques à vocation artistique, la finalité est annoncée et la considération esthétique n’est pas centrale. Certains ateliers s’invitent dans les services comme objets de médiation, à travers des supports d’écriture, de musique, de danse, de peinture ou même de street-art. D’autres peuvent être animés par des artistes ou des intervenants divers, sans que la finalité soit a priori thérapeutique. Il importe alors de favoriser l’expression et la créativité des personnes qui y participent, de donner de la résonance à des voix tues, invisibilisées ou dominées. Les personnes valorisent ainsi leur pouvoir d’agir, souvent mis à mal, notamment dans des situations de vulnérabilité ou de précarité. Les productions sont alors générale- ment diffusées et exposées. L’écho social et politique participe d’une reconnaissance du travail accompli. Ce qui participe au rétablissement ne se détermine pas a priori, mais bien plutôt en situation, par les personnes directement concernées plus que par les intervenants au regard de leur cadre d’exercice.
Combattre les assignations
Si, pour certaines personnes, atteindre le statut d’artiste est l’œuvre de toute une vie, pour d’autres, bénéficier de cette reconnaissance arrive de manière fortuite. Ainsi, certaines œuvres dévoilent l’uni- vers particulier de leurs créateurs sans pour autant avoir une valeur artistique à leurs yeux. Construire des cabanes en bois qui mesurent plusieurs mètres de hauteur uniquement avec de la corde, installer plus d’une centaine de moulins à vent et de carillons sur un vélo, habiller et recouvrir totalement des objets avec des bouts de tissus noués et des pelotes de laine, créer des fusils et des Spoutniks à partir de matériaux de récupération… Bienvenue dans le monde de l’art brut.
Les travaux artistiques inscrits dans ce courant nous invitent à prolonger la réflexion sur la reconnaissance de l’art. Si l’histoire de l’art brut est liée à celle de l’institution asilaire, la reconnaissance de ces œuvres va bien au-delà des murs de l’hôpital. Celui-ci se définit plus aisément par ce qu’il n’est pas – ni un mouvement, ni une école, ni même un style –, il représente l’art de l’exclusion, de l’enfermement, de la précarité ou encore des marges. L’art brut a indéniablement participé à dépasser des modes de hiérarchisation entre ce qui serait légitime et ce qui ne le serait pas dans le domaine de l’art. Il ne serait plus question de se conformer à une modalité de production d’œuvres quelles qu’elles soient, mais plutôt de faire advenir sa singularité, d’exprimer une sensorialité ou sensibilité particulière ou encore de sublimer une expérience douloureuse.
À titre individuel, la création représente un moyen de s’émanciper, de libérer sa parole, elle permet de sortir des assignations et d’accéder à un autre statut, d’être lu, vu ou entendu. L’expression artistique peut aider les personnes à tenir lorsqu’elles sont confrontées à des épreuves de vie. Elle est aussi une manière de donner à voir et faire entendre d’autres sensibilités, d’autres voix, des expériences singulières au détour d’une page tournée, d’une bande dessinée, d’un mur graffé ou d’un podcast murmuré…