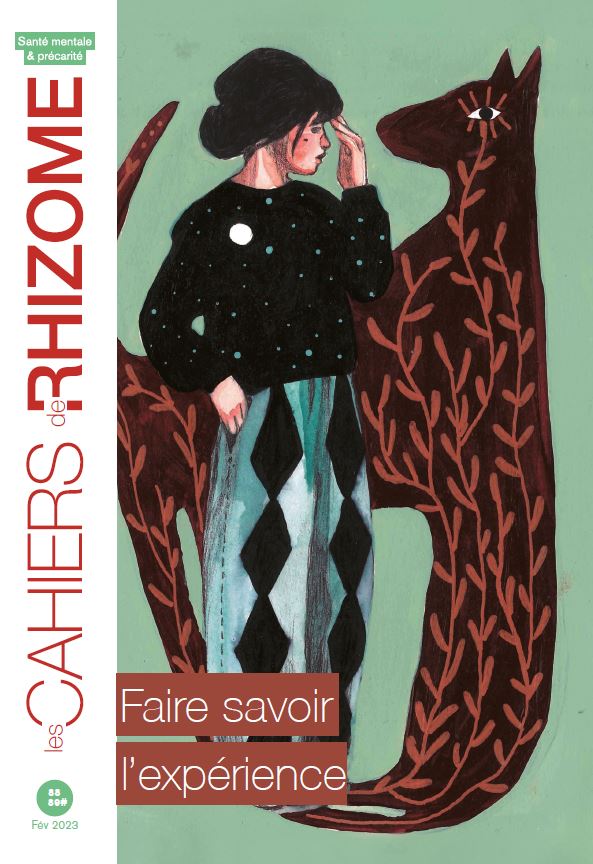À Yves, Anne et Maurice.
La mise en valeur actuelle du savoir expérientiel dans la maladie mentale implique, à mon sens, de ne pas s’effacer devant le patient ou la personne qui présente des troubles mentaux comme si nous lui donnions la parole et que nous lui tendions un micro. Il ne s’agit pas de croire qu’en étant en prise directe avec le dire du patient, voire en espérant toucher le « vécu » authentique par la répétition in extenso de ses paroles, nous atteindrons une vérité qui élimine le filtre du soignant par rapport au discours du soigné.
Inversement, il s’agit aussi de ne pas dénaturer les expériences que nous pouvons avoir avec la personne ayant connu des troubles mentaux, et de faire le travail de conceptualisation, ne clivant pas avec l’expert d’un côté et le patient de l’autre. Il incombe au chercheur de ne pas reproduire la démarcation traditionnelle du travail scientifique entre le sachant et l’ignorant, ici, le soignant et le patient. Par rapport à la pratique clinique, la mention de « savoir » comprise dans le savoir expérientiel incite à mettre en lumière la question de la connaissance et de la recherche au-delà de celle du soin (Simon et al., 2019). C’est en chercheur que j’aborde ici la schizophrénie à partir d’une expérience d’entretiens menés avec des patients en voie de réhabilitation, en ayant le souci de prendre toute l’ampleur des « savoirs » produits. Pour synthétiser ma posture, concernant la quête du savoir, je dirai qu’il ne s’agit pas de faire comme s’il suffisait au patient d’accéder à la sphère d’échange entre spécialistes pour faire valoir la « vérité » de la schizophrénie. Inversement, il ne s’agit pas non plus de devenir le « porte-parole » du patient, le coupant de toute capacité d’expression directe1. C’est la tenue inconfortable de cette double injonction que je nomme : « bien parler de la schizophrénie ».Dans un premier temps, j’aborderai cet embarras tenant aussi à mon parcours existentiel. Ensuite, je décrirai quelques éléments relatifs à l’étude que nous menons à plusieurs sur la schizophrénie avant d’aborder quelques chausse-trappes de la mise en public du vécu psychotique. Je terminerai par quelques hypothèses per- mettant de restaurer la schizophrénie dans le flux ordinaire de la vie en société.
L’embarras du sociologue/psychotique
Je voudrais ici, en tant que sociologue et personne concernée par la schizophrénie, faire état de l’embarras que cela représente de faire correspondre une expérience vécue – surtout la mémoire de crises anciennes survenues – avec le vocabulaire et l’axiomatique de mes collègues qui me paraissent très intellectuels. Ayant vécu des crises psychotiques par le passé et étant attaché professionnellement à une compréhension rationnelle de moi-même, d’autrui et de mon environnement, je suis dans le même cas que David Abram (2013), dans sa tentative de rapatrier une expérience animiste au sein des écrits sociaux et philosophiques. Cela fait référence à l’expérience du retour et de l’inadaptation du mode de saisie intellectuel d’une expérience corporelle, énergétique et relationnelle. Il s’agit de trouver des dérivatifs dans les concepts et les tournures académiques qui intellectualisent d’habitude le monde et les semblables pour faire droit à une brèche dans le rapport à autrui ainsi qu’à l’environnement. Cette brèche rend la personne tout d’un coup étrangère au cours des choses telles qu’il est imprimé par la raison et l’a priori d’intelligibilité de l’action de chacun pour ses semblables. Témoin de cette rupture d’intelligibilité et du travail psychiatrique consistant à essayer de la colmater, la question traditionnelle en consultation qui est posée au schizophrène est : « Entendez-vous des voix ? » Plutôt que de poser cette question clivante et renforçant d’autant plus, chez la personne qui déclare les entendre, le sentiment d’être inadéquate, nous pouvons parler de symptôme de désaccordement de la réalité avec ses résonances (James, 2003[1890]) et d’une façon de « vibrer à l’unisson avec l’ambiance » (Minkowski, 2002 [1927], p. 58). J’adopte alors la même disposition que celle de David Abram, consistant à ruser avec le vocabulaire, la syntaxe et les dispositifs d’intelligibilité afin de ne pas réduire cette vibration à des « voix » ou de l’intellect. David Abram va chercher une explication autre dans l’animisme, mais mon propos est de multiplier les ruses avec nos modes de pensées pour faire droit à la multimodalité de l’expérience de désaccordement psychotique. Je me suis donné comme mission de contribuer modestement à faire ce que je sais faire, c’est-à-dire de la sociologie, pour être fidèle à ce que j’ai vécu et à ce que d’autres me confient en entretien. Cette démarche est en filiation avec des auteurs qui ont manifesté l’embarras de devoir « retourner » auprès des autres après ce voyage en terre étrangère, et traduire cette expérience en savoir. L’engagement existentiel est alors de ne pas désespérer les personnes qui ont fait un voyage similaire en gauchissant l’expérience rapportée, puisqu’on en produit un savoir dit « rationnel ». Cependant, ce n’est pas non plus de paraître ésotérique aux yeux de celles qui n’ont pas vécu l’expérience et qui cherchent à la comprendre. Bien d’autres ont été confrontés à cette épreuve de traduction à double contrainte, que je nomme « bien parler ». Isabelle Stengers (2006) se demande en tant que constructiviste, et en pleine guerre des sciences, « comment bien parler de la recherche scientifique ». Pour elle, il s’agit de ne pas minorer le caractère immergé des sciences dans la société tout en n’écornant pas la vérité des savoirs produits. C’est aussi le cas de Vinciane Despret qui tente, au sein de ses travaux, de trouver les voies pour restituer l’intelligence de cet autre qu’est l’animal contre une vision éthologique étroite cantonnant son comportement à une réponse aux stimulus (Despret et Porcher, 2007). Vinciane Despret et Jocelyne Porcher s’aperçoivent qu’interroger l’animal revient souvent à questionner avant tout la différence entre humain et animal et donc à renforcer l’exceptionnalité de l’homme sans se risquer à manifester des continuités, plus particulièrement celle du partage de l’intelligence avec les bêtes. Enfin, Bruno Latour (2002) explique qu’il a un bœuf sur la langue lorsqu’il s’agit de parler de religion à ses collègues sans offusquer ceux qui croient ni aliéner ceux qui ne croient pas. Bien parler de religion serait alors rapporter à cet autre qui n’existe pas – Dieu – la même ambiguïté que celle que j’ai devant moi-même comme être de langage, dont l’existence est bien loin d’être celle d’un propriétaire de ses facultés de pensée (Latour, 2002, p. 15). Comment ne pas voir, dans ces exemples de philosophes, la désolidarisation du logosgrec, à la fois siège de la raison et du langage, de ses prétentions à démarquer systématiquement l’humain de l’animal, la science de l’ignorance ou le terrestre du céleste ? L’embarras dont témoignent les philosophes cités est une source d’inspiration pour faire sortir la schizophrénie du seul rapport d’entorse dans le champ du logos et, comme telle, rapport pathologique. Comment donc trouver dans le langage rationnel une manière d’évoquer un autre expérientiel sans lui intimer de n’exister que comme ce qui échappe à la raison ? Comment enrayer l’identification de l’être de langage à l’être rationnel, attelage improbable qui empêche de bien parler de la schizophrénie ?
Une enquête sur la schizophrénie : les accrocs au sens commun
Nous avons élaboré, avec un autre sociologue et deux psychiatres2, une enquête en réalisant des entretiens auprès de personnes diagnostiquées comme souffrant d’un trouble dans le spectre de la schizophrénie et étant suffisamment rétablies. Notre hypothèse est que les crises psychotiques sont des épisodes où nous perdons pied avec le sens commun et dans la relation à l’autre. Cela s’exprime par des discussions incohérentes pour les interlocuteurs ou bien des difficultés dans les tâches quotidiennes, comme se préparer à manger, se laver ou tout simplement habiter. Sans recourir à une explication mentale ni à un vocabulaire technique, notre hypo- thèse était minimale : disons simplement qu’il s’agissait de recueillir des varié- tés de situations remémorées par la personne durant lesquelles « elle a perdu le fil », se souvient d’un « accroc » par rapport à la situation vécue ou dans laquelle « elle s’est sentie à côté de ses pompes ». De ce point de vue, la notion de « flux de conscience » (James, 2003 [1890]) est importante pour saisir l’aisance avec laquelle nous nous comportons traditionnellement et combien la schizophrénie met à mal cette attitude de fluidité. Je préfère parler de « flux » et de « fluidité » pour désigner une attitude qui nous paraît naturelle et de sens commun tant elle passe inaperçue, et que le psychotique va ressentir comme étrange, voire étrangère. Il ne s’agit donc pas de rapporter l’accroc avec le sens commun à la non-observation d’une norme, d’un cadre ou d’une mise en scène saisie sur le vif, au sein de la relation, comme le signale Erving Goffman (1973).
Notre approche sociologique se place au moment de se remémorer des saynètes de sa vie passée avec comme parti-pris que des situations de non-fluidité sont plus faciles à se remémorer car elles cristallisent un malaise, un ressenti, sous la forme, par exemple, d’un effondrement ou d’une colère qui marque la personne. L’accroc est un élément que l’on se remémore comme un symptôme du fait que l’épisode prend une place à part dans le fil biographique du schizophrène, comme tout un chacun tisse sa vie. Il peut être abusif de parler de « crise », mais on peut dire que ces accrocs sont des nœuds mémoriels qui rappellent des périodes de vie mises entre parenthèses rétrospectivement par le schizophrène.
Il ne s’agit donc pas d’évaluer la définition « sociale » de la maladie comme une suite de situations handicapantes au vu de l’absence d’égard de la société pour des comportements spécifiques. Autrement dit, en insistant sur les accrocs au sens commun, on ne considère pas le comportement des schizophrènes comme déviants et réductibles à sa labellisation par le collectif comme tels (Becker, 2020). On en voudra pour preuve des souvenirs récoltés en entretien rappelant des situations où la personne était toute seule – par exemple, chez elle — et où des réactions critiques sont apparues – du type réflexe boulimique ou dérangement par le bruit. Ces comportements sont moins bien décrits comme la marque par autrui d’une déviance que du défaut de la vibration à l’unisson avec l’ambiance. Il s’agit moins d’une place que le collectif aurait labellisée et qui collerait à l’identité de la personne, que d’une aspérité soudaine de ce qui allait de soi. Nous avons à ce jour réalisé neuf entretiens, d’une durée d’une heure à une heure trente, menés avec des personnes en voie de rétablissement qui acceptaient de se replonger dans leur passé plus ou moins récent. Notre enquête est en cours et nous pouvons déjà voir que l’hypothèse d’isoler des situations d’accrocs est largement écartée par des personnes qui veulent d’abord se raconter, ainsi que remettre en perspective leur histoire, souvent dans la confusion des étapes. En revanche, il semble que l’attention – y compris phonétique – au phrasé des per- sonnes interviewées, et le fait de les convier à s’attarder sur des signes extérieurs qu’elles décodent rétrospectivement comme parasite de la relation permet de sortir du cadre de l’entretien biographique auquel est habitué le schizophrène lors de ses rendez-vous avec les psychiatres ou les psychanalystes. Il faut noter chez l’interlocuteur, comme dans tout entretien, la production d’un discours convenu et l’anticipation des « bonnes » réponses. Toutefois, pour toutes les personnes rencontrées, désireuses de sortir du cadre psychiatrique et de parler autrement de leur maladie, l’entretien a été une occasion reconnue. Il a tout particulièrement bien été ressenti que l’objet dont il était question n’était pas tant de dresser un tableau clinique pour vérifier une hypothèse, mais plutôt de réaliser un florilège de phrases formulées par des patients qui évoquent, souvent avec quelques années de recul et donc avec une certaine forme de normalisation rétrospective, ce qui leur est arrivé.
Le bon sauvage, le cas et la multitude
Notre démarche se situe à l’opposé de plusieurs tics de certains milieux de la santé mentale au sein desquels le recours à ces mises en mot de l’accroc est converti en « anecdotes » et en témoignages vécus. Comme les expositions universelles du début du XXe siècle présentaient le bon sauvage, il m’est arrivé d’être sollicité pour présenter mon « expérience » devant un parterre de professionnels de la réhabilitation. Cette attribution de la qualité de « témoignage » à ces formes langagières de réminiscence s’établit sur le parti pris que nous atteignons une plus grande véracité en associant le discours à son incarnation dans la personne parlante. Le témoignage est soi-disant le discours « en réel », puisque dit par son auteur. Cependant, penser ainsi, c’est d’abord oublier que la réminiscence et l’explication ne sont qu’un exercice déformant de ce qui s’est passé et que le témoignage vaut aussi comme une trace vive, laissée dans la conscience de la personne. Les schizophrènes interviewés se souviennent d’événements parce qu’ils ont été marquants et qu’ils ont voyagé jusqu’à maintenant en étant des éléments constitutifs de l’être qu’ils sont désormais. Considérer les mises en mot comme des témoignages, c’est également oublier que nous ne sommes pas témoin en dehors de la scène où nous avons été convoqués comme tel. Être témoin est une figure issue de la scène au sein de laquelle nous sommes convoqués comme « déclarant avoir vu ou ressenti, etc. » (Dulong, 1998). De ce point de vue, le florilège de propos que nous recueillons en entretien échappe à l’incarnation, puisqu’il est enregistré, puis analysé. La personne n’est pas sommée de « témoigner », mais de raconter, de se remémorer et de réajuster rétrospectivement ce qu’elle a senti et ce qu’elle sent maintenant. L’idée n’est pas d’aller directement au vécu intime des personnes, mais de multiplier les occasions d’interprétation. C’est ainsi que nous avons demandé aux interviewés de noter dans un carnet, et comme cela leur revenait, des bribes de souvenirs liés à des moments où ils se sont sentis comment étant « à côté de leur pompe », ou décalés par rapport au cours de l’action.
Un des écueils de la profession, y compris sociologique, est de rapporter les discours de patient à des « cas ». On m’a également rétorqué, lors de mes interventions, que j’étais un cas à part. Cette logique casuistique vaut si on se place dans le cadre d’un modèle, d’un patron, ou d’un idéal type de la symptomatologie de la maladie. La schizophrénie vit d’abord au regard des définitions et des tableaux cliniques qui ont été rencontrés par les personnes interviewées puisque c’est par le biais d’un psychiatre qu’elles nous ont été recommandées. Autrement dit, dans notre étude, nous n’échappons pas au diagnostic psychiatrique. Néanmoins, notre perspective diffère de celle d’une formation en médecine. Bien des médecins s’instruisent à la clinique en apprenant le décalage entre le savoir transmis dans les livres et la situation de chaque patient. Soigner confinerait à adapter la théorie ou les axiomes à des cas et à convertir une connaissance des corps en attention relationnelle (Mol, 2009). Nous pouvons raccrocher notre étude à du savoir expérientiel dans la mesure où nous ne cherchons pas à soigner et donc à adapter des cas et des cadres explicatifs, mais à faire proliférer les mises en mots.
Aussi, de manière approximative, nous pouvons parler de multitude, de multiplicités ou de variétés (Despret, 1999, reprenant Deleuze et Guattari) pour décrire les phrases recueillies en entretien. Nous ne pouvons au plus que devenir les curateurs de ces musées mémoriels d’épisodes passés et faire de la science en rajoutant systématiquement des « et aussi » plutôt que de chercher à réduire la diversité. S’il est impossible au soignant de ranger le « cas » qu’il a en face de lui dans une symptomatologie unifiée, car des écarts insoupçonnés se présentent toujours, il est impossible pour nous de trouver « l’intégrale » des différences et nous sommes donc dans l’incapacité de totaliser, sinon tendanciellement.
Quelques hypothèses pour décaler la vision de la schizophrénie
Faire droit aux phrases, aux intonations, aux silences, aux hexis corporels recueillis en entretien, suppose de rapprocher ces étrangetés que sont les épisodes psychotiques avec d’autres étrangetés. À titre d’hypothèse, j’en avancerai trois. Chacune cherche à ruser avec nos rationalités intellectuelles pour ouvrir ces épisodes d’accroc avec le sens commun et, au premier chef, de sentiment d’étrangeté avec les mots, leur musicalité et leur double sens, pour restaurer le schizophrène dans une place que le savoir savant lui dérobe.
Tout d’abord, les licences prises entre le sens convié par les phrases et leur phonétique, qui fait buter certains schizophrènes sur les assonances incluses comme des « doubles sens », pourraient être rapprochées de la poésie. À plusieurs reprises, les crises remémorées portaient sur des significations secondes, éprouvées par le schizophrène dans la conversation ordinaire. Leur attention était attirée par des sons, une phonétique. Par exemple, le son « père » dans le mot « personne » diffracte le sens littéral, ordinaire et manifeste du terme pour tout un chacun. Ainsi, sur un autre plan, le psychotique relève une autre sorte de signification cryptée sans vouloir rompre le flux conversationnel et, donc, ses répliques sont sciemment dotées de double sens, de métaphores… Une place légitime dans la société a été aménagée aux poètes. Ces derniers gèrent cette licence généralisée prise avec l’articulation, la phonétique et la sémantique des phrases, mais aussi les allitérations, les métaplasmes… La place des phrases sur la page d’un livre de poésie, et bien d’autres techniques, révèlent une accointance avec l’art de l’articulation des mots du schizophrène.
Ensuite, nous pouvons avoir recours à l’anthropologie pour décrire l’expérience de l’autre, mais ici, au cœur de nos sociétés modernes et en particulier en évoquant la figure du chamane sur laquelle reviennent David Abram et Baptiste Morizot (2016). D’après ma propre expérience et celle des personnes interviewées, lors des crises psychotiques, se passe la possibilité de la « délocation » comme l’éprouve le chamane lorsqu’il rentre dans le corps du vivant ou de l’objet extérieur les requalifiant ainsi en « vivant-personne » ou « chose-personne » (Abram, 2013 ; Morizot, 2016). Il a été montré que cette capacité avait des conséquences dans la société traditionnelle et supposait une connaissance particulière. Le chamane reçoit une place valorisée dans le clan ou la culture qui le porte. Dans nos sociétés, le schizophrène peut avoisiner des pratiques que nous jugeons ésotériques d’un point de vue rationnel, mais que d’autres cultures considèrent comme essentielles dans le rapport de l’homme avec le vivant, les choses et les énergies.
Enfin le dernier terme qui me vient à l’esprit pour qualifier ces réminiscences de crises psychotiques fait référence à une certaine forme de cannibalisme décrit par l’anthropologie. La photographie a pu être perçue comme étant une manière de s’approprier l’esprit de la personne, de capturer son aura et son individualité. Cela est flagrant en ce qui concerne les premiers anthropologues ayant photographié et réalisé des portraits des personnes qu’ils ont rencontrées. Cette réaction me semble similaire à la manière dont certains psychotiques décrivent les crises schizophréniques, comme cette sensation d’être cannibalisé par la parole de l’autre, comme si l’autre s’appropriait vos pensées avant même que vous ayez pu les exprimer, ou comme si l’autre décodait vos gestes et vous subtilisait la manière d’en être possesseur. Il y a là une hypothèse relative à la paranoïa que de nombreux schizophrènes interviewés ont ressentie à un moment ou à un autre.
Conclusion
Notre approche de la trace d’épisodes psychotiques, tels que remémorés par des personnes en réhabilitation, dénote un choix de ne pas mettre le dire du patient en situation de prise directe dans la communication avec un autrui inconnu. Ce choix, et les règles éthiques adoptées, prend acte de la nécessaire édification d’un espace protégé afin que la parole se libère du côté des personnes, habituées à porter un discours convenu lorsqu’elles se racontent dans le cadre des rendez-vous avec leurs psychiatres. La présence d’un membre concerné dans notre équipe est aussi une garantie que cet espace assure une suspension du jugement sur la normalité – ou pas – du comportement, mais pas de la pathologie dont toutes les personnes interviewées reconnaissent qu’elles ont été affectées.
Il s’ensuit un souci de ménager cet espace de protection au sein duquel nous ne considérons pas la personne comme un cas ou un témoin, conviée comme exemple vivant de la maladie pour des instances expertes et que l’on pourrait convoquer à l’envi. Nous avons conscience d’une certaine intimité au détour de certaines tournures de phrase, qui montrent le caractère affecté de la personne qui parle, mais aussi de celui qui écoute. Il s’y joue de l’information, mais aussi un jeu d’influences réciproques aux résonances émotionnelles, cognitives et de pouvoir, qui sont rendues possibles par la protection garantie de l’espace de discussion ainsi aménagé.
Cette expérience inédite que nous avons vécue, sociologues et psychotiques, réclame un mode d’exposition singulier ; il pourrait être formateur de convier tous les participants – tous contactés indépendamment les uns des autres – à se rencontrer et à produire, en collectif, une archive visuelle, sonore, écrite ou autre. Nous pouvons réfléchir à un dispositif qui remplirait la condition de rencontre entre pairs, à même de faire œuvre de « savoir » expérientiel – au sens où il est transférable à autrui (Simon et al., 2019) –, mais sans amenuiser la nécessaire façon d’en bien parler.
Notes de bas de page
1 On trouve une bonne définition de ce qu’est un porte-parole dans un article rédigé par Michel Callon (1986).
2 Notre étude a été financée sur un appel d’offres conjoint de l’hôpital du Vinatier et l’Université Lyon-2. Je remercie Nicolas Chambon, Sophie Cervello et Romain Pommier pour notre collaboration très riche ainsi que les personnes interviewées pour avoir accepté cet exercice d’éclaircissement.
Bibliographie
Abram, D. (2013). Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens. La Découverte.
Becker, H. S. (2020). Outsiders : études de sociologie de la déviance. Métailié.
Callon M. (1986). Éléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins- pêcheurs dans la baie de Saint- Brieuc. L’Année sociologique, 36, 169-208.
Despret, V. (1999). Ces émotions qui nous fabriquent. Ethnopsychologie de l’authenticité. Points.
Despret, V. et Porcher, J. (2007).Être bête. Actes Sud.
Dulong, R. (1998). Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation oculaire. Éditions EHESS.
Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne (vol. 1). Éditions de Minuit.
James, W. (2003 [1890]). Précis de psychologie (traduit par Ferron). Les Empêcheurs de penser en rond.
Latour, B. (2002). Jubiler ou les tourments de la parole religieuse. La Découverte.
Minkowski, E. (2002 [1927]). La schizophrénie. Psychopathologie des schizoïdes et des schizophrènes. Payot.
Morizot, B. (2016). Les diplomates. Wildproject.
Mol, A. (2013). Ce que soigner veut dire : Les patients, la vie quotidienne et les limites du choix. Presses des Mines.
Simon, E., Arborio, S., Halloy, et Hejoaka, F. (2019). Les savoirs expérientiels en santé : Fondements épistémologiques et enjeux identitaires. Éditions universitaires de Lorraine.
Stengers, I. (2006). La vierge et le neutrino. La Découverte.