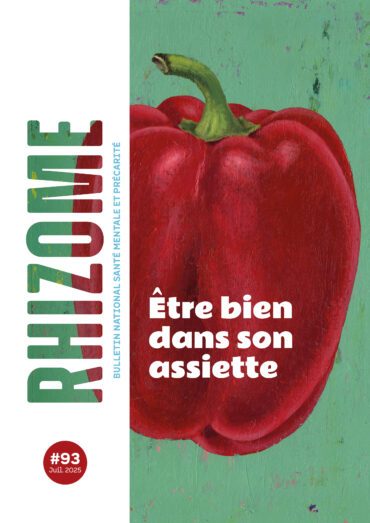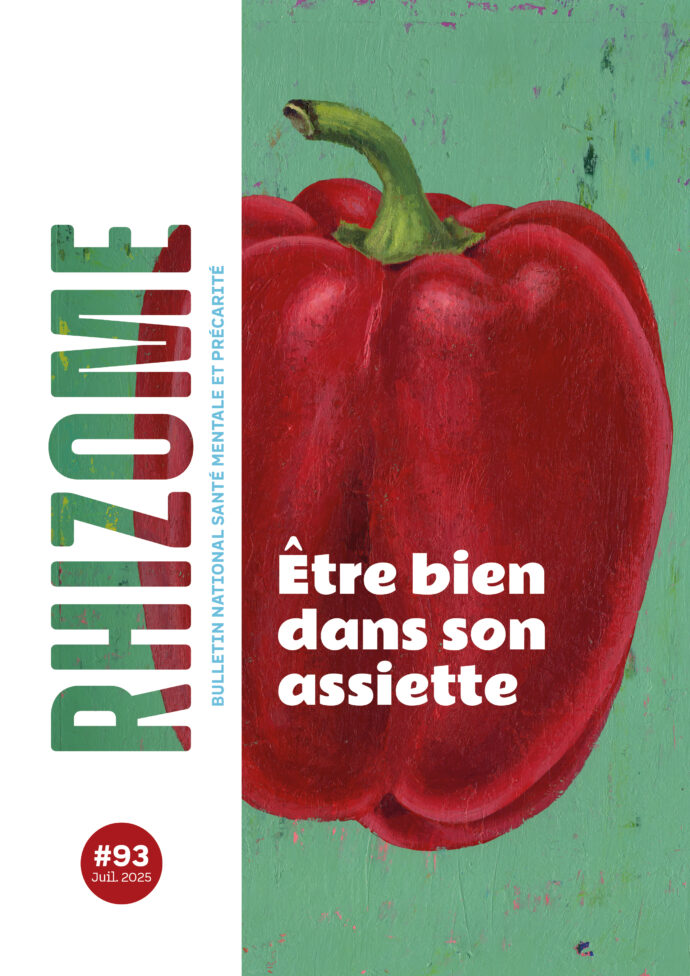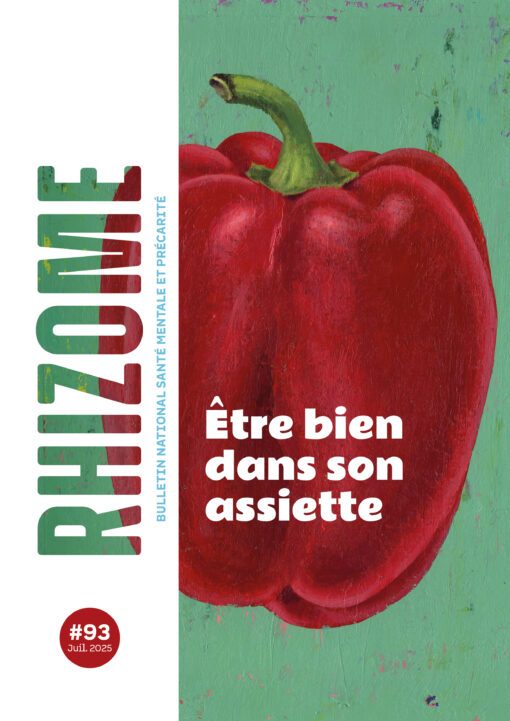Dans un contexte de crise économique et sociale aiguë, la pression est forte sur des choix alimentaires qui doivent être à la fois suffisants, sains, écologiques et bons au goût. Dans ces conditions, pouvons-nous vraiment être « bien dans notre assiette » lorsque nous sommes en situation de précarité ? Et que signifie « être bien » : l’être aux yeux d’autrui, par conformité aux normes alimentaires et à la reconnaissance sociale, ou pour soi-même, en satisfaisant ses goûts et en exerçant un véritable choix ? Ces choix sont-ils le reflet de contraintes économiques ou traduisent-ils une réelle liberté des goûts ?
Bien dans son assiette, une question de coût
Les contraintes financières pèsent fortement sur les choix alimentaires des milieux précaires, mais aussi des ménages modestes qui, sans être précaires, consacrent une proportion élevée de leur budget à l’alimentation. Elles limitent l’accès à des produits valorisés pour leur intérêt nutritionnel et environnemental, tels que les fruits et légumes, dont les apports restent nettement insuffisants par rapport aux recommandations nutritionnelles1. Elles restreignent aussi l’accès à des aliments désirés par les classes populaires, comme les produits locaux ou, plus simplement, les aliments « de qualité ». Ces écarts de consommation ont des effets sur la santé : les populations précaires sont davantage exposées à des pathologies nutritionnelles telles que l’obésité ou le diabète de type 2.
Exercer des choix suppose aussi l’accès à des savoirs, qui émancipent. Or les recommandations nutritionnelles et environnementales se diffusent de manière inégale selon les milieux sociaux. Par exemple, en situation de précarité, la priorité n’est pas de manger « sainement », mais avant tout d’avoir assez à manger.
Cette distance vis-à-vis des possibilités d’accès aux aliments socialement valorisés et des savoirs légitimes peut engendrer des tensions, nourrissant à la fois un sentiment d’exclusion et une exclusion effective de pratiques reconnues. En matière d’alimentation, l’expression « on n’a pas le choix » revient fréquemment, traduisant une autonomie fortement contrainte.
Bien dans son assiette, une affaire de goût
Être bien dans son assiette dépend aussi de la capacité des individus à exprimer leurs préférences. Les choix alimentaires des catégories modestes reflètent également les goûts. Le plaisir pris dans la consommation alimentaire, la valorisation de l’abondance, la jubilation à pouvoir exercer un choix et gâter les enfants par l’alimentation en sont des dimensions essentielles2.
Dès lors, les préférences alimentaires des classes populaires sont souvent éloignées des normes dominantes : elles révèlent une forme de résistance, comme l’illustrent deux exemples significatifs. Le végétal, largement promu dans les recommandations publiques, suscite une adhésion partielle, limitée par des contraintes de coût, de périssabilité et par un rapport moins direct à l’alimentation en tant que facteur de santé. À l’inverse, la viande conserve une forte valeur affective et sociale. Symbole de conquête sociale, elle demeure importante alors même qu’elle est désormais critiquée par ailleurs pour des motifs sanitaires ou écologiques3.
Ces préférences sont façonnées par la position sociale, qui influe sur les perceptions du « bien manger », de la santé et du corps « en bonne santé ». Elles sont également nourries par des dimensions plus individuelles, comme les trajectoires de vie, les souvenirs familiaux, ainsi que par d’autres facteurs tels que le sexe, l’âge ou la génération. L’ensemble de ces dimensions contribue à donner sens aux pratiques alimentaires.
L’alimentation, un enjeu d’intégration sociale
Pouvoir satisfaire ses préférences relève également de la liberté de choix, condition essentielle de la reconnaissance des individus précaires comme des sujets autonomes, même lorsque leur autonomie est par ailleurs fortement restreinte. La consommation alimentaire est une manière de participer à la société de consommation, dont les personnes précaires sont exclues par bien des aspects. L’alimentation, premier luxe accessible, devient pour les catégories modestes un moyen d’intégration sociale, une victoire sur des manques, et un mode d’affirmation de leur liberté face aux contraintes économiques et sociales. L’alimentation est ainsi un espace d’expression des aspirations à une participation à la société.
Cette liberté de choix, bien que relative, s’exerce souvent dans des marges étroites. Elle se manifeste aussi par des savoir-faire, des astuces et une inventivité du quotidien, soit cuisiner avec peu, accommoder les restes et adapter des recettes. Ces compétences permettent d’ajuster les contraintes économiques sans pour autant renoncer au goût ni au plaisir. Elles participent pleinement d’une éthique de consommation populaire.
Conclusion
L’alimentation des classes populaires ne se réduit pas à un manque ou à des contraintes, mais exprime des choix, des goûts et des aspirations propres. Ces pratiques, parfois invisibles ou dévalorisées, traduisent des formes de résistance aux normes dominantes, des stratégies d’ajustement, mais aussi un désir de participation à la société. En les reconnaissant, l’alimentation peut devenir un vecteur d’intégration sociale plutôt qu’un nouvel élément de distinction pour les plus aisés et d’exclusion pour les autres. Penser l’alimentation, c’est ainsi y réintroduire les dimensions sociales, culturelles et symboliques qui font que nous pouvons être bien dans nos assiettes.
Notes de bas de page
1 Perignon, M., Vieux, F., Verger, E. O., Bricas, N. et Darmon, N. (2023). Dietary environmental impacts of French adults are poorly related to their income levels or food insecurity status. Eur. J. Nutr., 62(6), 2541-2553.
2 Schwartz, O. (1990). Le monde privé des ouvriers. Presses universitaires de France. Régnier, F. et Masullo, A. (2009). Obésité, goûts et consommation. Intégration des normes d’alimentation et appartenance sociale. Revue française de sociologie, 50(4), 747-773.
3 Régnier, F. (2024). Transition écologique et choix alimentaires : les classes populaires sous tension. Dans Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale (p. 252-264).
Bibliographie
Régnier F. (2025). Distinctions alimentaires. Presses universitaires de France.