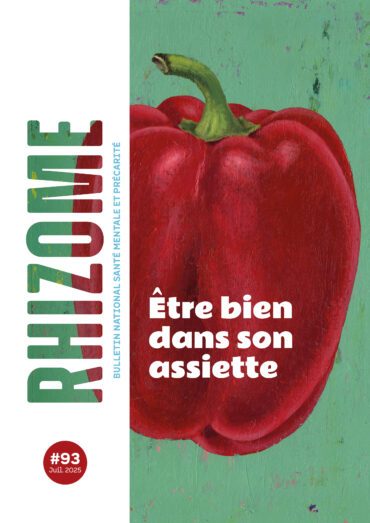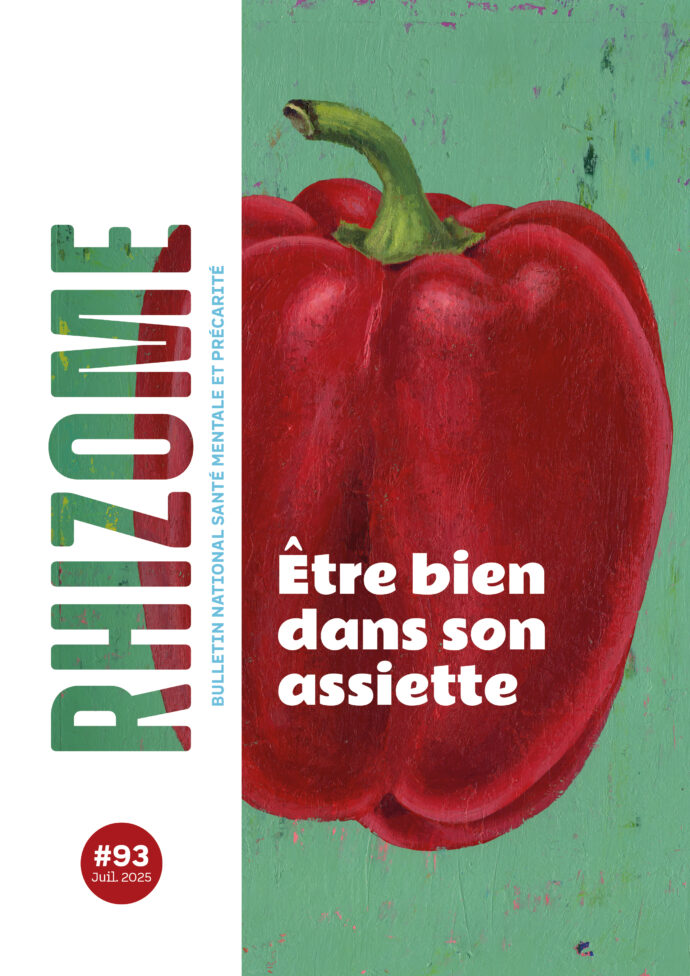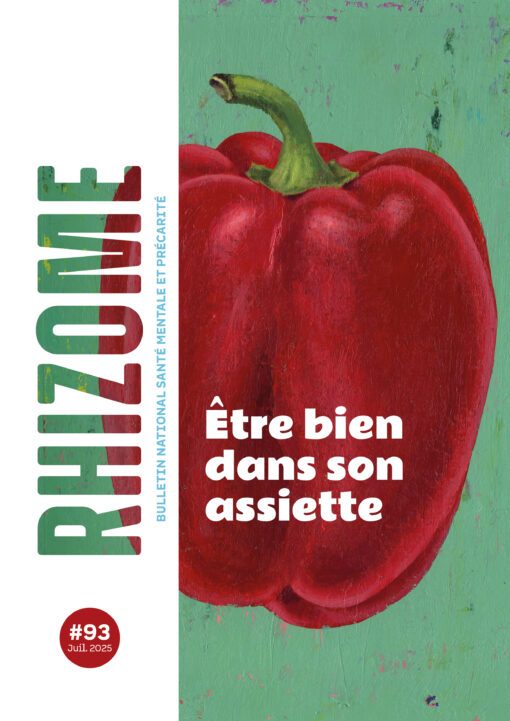« Pour les gens, une personne boulimique “c’est gros” et une personne anorexique “c’est maigre”. […] Peut-être que c’est dans l’imaginaire des gens, parce qu’il y a “boule”, “boulimie”, non ? Parce que moi, je me rappelle, j’avais honte de ce mot. » Jemma
Jemma vit son diagnostic de boulimie en cachette. Le terme « boulimie », souvent associé dans le langage courant à la gloutonnerie et à la corpulence, désigne pour elle un trouble psychiatrique, l’un des troubles des conduites alimentaires (TCA). Contrairement aux représentations courantes, de nombreuses personnes diagnostiquées de boulimie affichent un poids jugé « normal1 », tant d’un point de vue médical que social, ce qui rend leur souffrance souvent invisible ou minimisée par leur entourage.
La méconnaissance de la boulimie en tant que trouble psychiatrique est renforcée par les médias qui ont longtemps nourri l’association entre les TCA et l’amaigrissement2. L’absence de signes corporels visibles rend alors difficile la reconnaissance d’un mal-être associé à un TCA. La réticence de Jemma à partager son expérience s’enracine dans ces représentations sociales.
De fait, la réponse de Jemma illustre le caractère social de la honte, qui a, pourtant, tendance à être perçue comme une expérience intime. D’après Norbert Elias, la honte correspond à un conflit interne entre l’individu et l’opinion sociale intériorisée3. En ce sens, la honte agit comme un mécanisme de contrôle social incorporé.
Normes sociales et souffrances personnelles
À partir d’entretiens réalisés auprès de femmes avec un diagnostic de boulimie, je propose d’explorer comment le sentiment de honte s’articule avec notre contexte social. Concentrons-nous sur deux comportements spécifiques associés à la boulimie4 : la crise de boulimie, qui se manifeste par une ingestion excessive de nourriture dans un laps de temps limité ; la provocation des vomissements qui s’ensuit5.
Vécue par les femmes interviewées comme un manque de volonté, la crise de boulimie est associée à un échec personnel. Dans les sociétés occidentales, où l’injonction à l’autonomie prédomine, la perte de contrôle sur l’alimentation dépasse la sphère alimentaire, affectant la perception de soi en tant qu’individu responsable de ses actes et de son corps6. À son tour, la provocation des vomissements cherche à effacer les conséquences de la crise et à protéger l’individu d’une stigmatisation liée à un corps gros. Cette pratique est également source de honte. Les participantes soulignent que les vomissements sont souvent associés à la saleté. De plus, utilisés comme méthode de contrôle du poids, ils peuvent être perçus comme un choix volontaire et facile, en opposition aux valeurs d’effort et de « travail sur soi » qui prévalent dans notre société7. Les normes socioculturelles exacerbent donc les souffrances personnelles.
Charge morale de la boulimie : un contraste avec l’anorexie
« […] C’est mieux vu dans la société d’être anorexique que boulimique parce qu’il y a cette idée qu’une fille, il ne faut pas trop qu’elle mange. […] Avec mes amis et avec mon conjoint, je mange moins que quand je suis toute seule. » Joséphine
Cette déclaration illustre un décalage entre l’image que Joséphine projette – celle d’une fille qui mange peu – et la réalité dévalorisante qui, si elle venait à être révélée, pourrait nuire à son image. Plusieurs participantes rapportent avoir reçu un diagnostic d’anorexie avant de développer des comportements boulimiques. Leur expérience distincte de ces deux diagnostics révèle des représentations sociales qui leur sont associées :
« La boulimie, j’ai un sentiment de honte, de dégoût, d’échec, quelque chose qui m’apporte rien sur le long terme […]. Par contre, les périodes de restrictions, j’en ai jamais souffert. » Vanessa
Cette perception de la boulimie qui « m’apporte rien », voire qui affecte l’estime de soi et l’image sociale de la personne, contraste avec la description des « périodes de restrictions » qui n’implique pas de telles souffrances. La littérature spécialisée sur les TCA illustre également cette tension entre les diagnostics d’anorexie et de boulimie, qui peuvent être vécus respectivement comme une fierté et un échec8.
Une reconsidération des représentations sociales de la boulimie serait susceptible de promouvoir une compréhension plus nuancée et empathique des souffrances vécues. Sans une évolution des normes et des valeurs dominantes, il semble difficile d’enrayer la montée des TCA et de déstigmatiser la boulimie.
Notes de bas de page
1 Criquillion, et Doyen, (2016). Anorexie, boulimie. Nouveaux concepts, nouvelles approches. Lavoisier.
2 Froger-Lefebvre, (2020). Les voix du rétablissement. Sociologie politique des groupes de parole, le cas des Outremangeurs Anonymes [thèse de doctorat, Université Paris 10].
3 Elias, (1974). La société de cour. Flammarion.
4 Ce texte ne prétend pas remplacer les interprétations médicales ou psychologiques ni couvrir l’ensemble des critères et caractéristiques diagnostiques du trouble.
5 American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders.
6 Détrez, (2002). La construction sociale du corps. Éditions du Seuil.
7 Darmon, (2008). Devenir anorexique Une approche sociologique. La Découverte.
8 Jeammet, (2013). Anorexie. Boulimie : Les paradoxes de l’adolescence. Hachette Littérature.