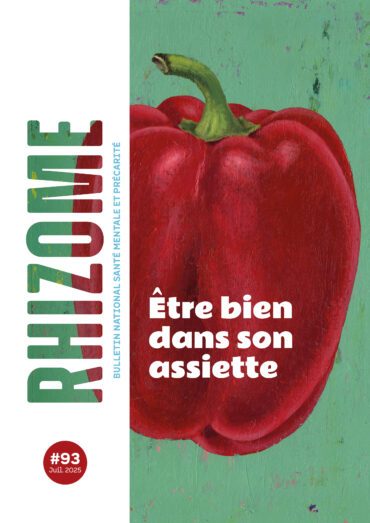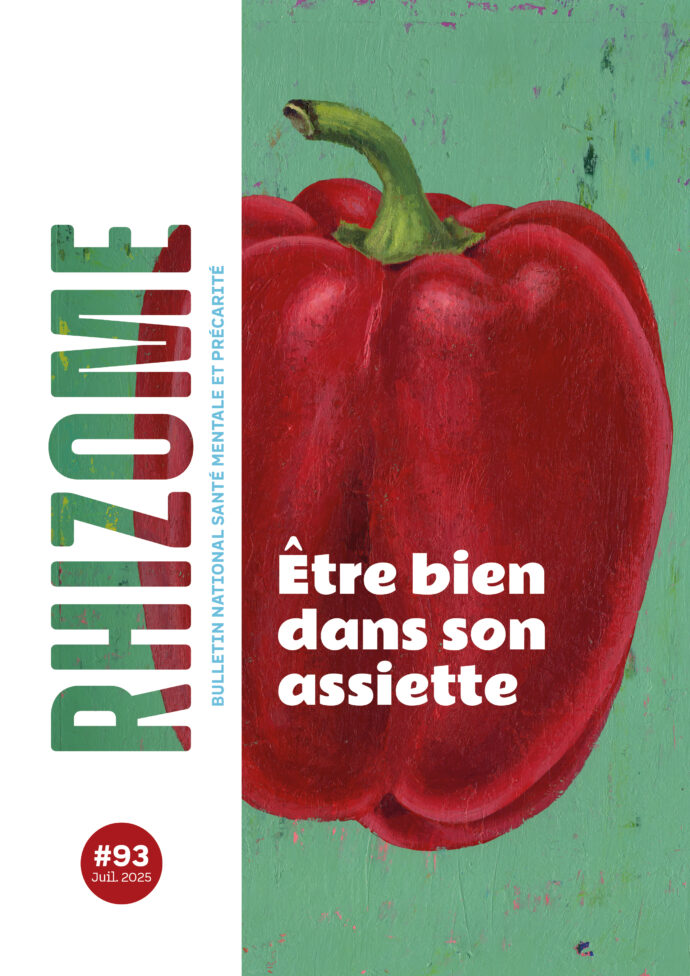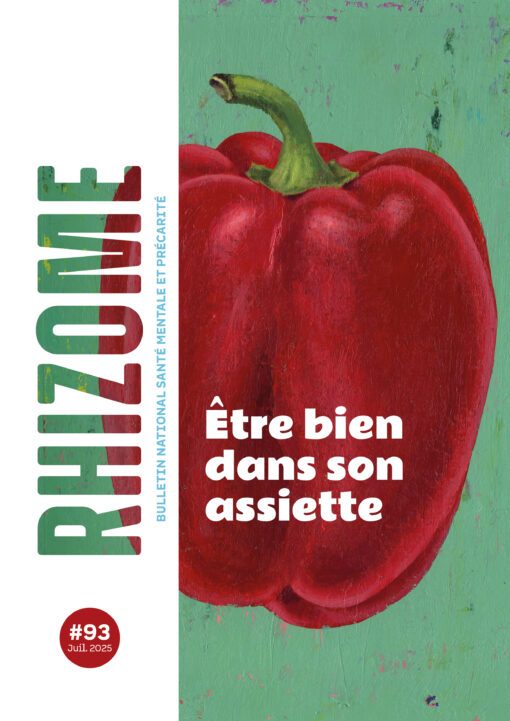Midi, les enfants sortent de classe. « Ils se conduisent différemment à l’école et ici. Pour eux, c’est un soulagement » de venir à la cantine, m’explique un agent de restauration scolaire. Ils entrent dans un espace différent, propice à l’expression des émotions contenues dans la matinée. Alors que je discute avec une tablée de copains qui se détendent et rient en mangeant avec appétit, un garçon fatigué éclate en sanglots dans la queue du self. L’animatrice débordée, occupée à aider les plus jeunes à porter leurs plateaux, soupire et lui dit : « Tu ne vas quand même pas pleurer parce qu’il t’a poussé ! » L’expérience enfantine de la restauration scolaire est contrastée. Si certains apprécient les repas, connaissent et respectent les règles de l’institution, d’autres détournent ces règles ou ne parviennent pas à les respecter, ont du mal à utiliser leurs couverts, crient, bousculent ou se font bousculer, refusent de manger. Mais derrière les discours sur des enfants qui seraient plus « difficiles » que d’autres, ce sont des dynamiques d’inégalités qui se cumulent et façonnent les vécus de la cantine.
Inégalités sociales
Lorsqu’elles apparaissent en France au XIXe siècle, les premières cantines ont un objectif philanthropique. Les communes qui les mettent en place espèrent attirer à l’école les enfants des familles « nécessiteuses » et améliorer leur santé1. Aujourd’hui encore, la cantine est considérée comme un acteur important de la lutte contre l’insécurité alimentaire. Pourtant, elle est sous- fréquentée par les enfants des classes populaires. Les élèves qui ne vont jamais à la cantine représentent 22 % des collégiens des établissements publics hors enseignement prioritaire, mais 73 % de ceux scolarisés en REP+2. Les enfants qui ont été socialisés dans le cadre familial à des normes alimentaires éloignées de celles portées par la restauration scolaire, comme les enfants de personnes migrantes, sont moins susceptibles de connaître les aliments qui y sont servis, sans pour autant être les plus critiques sur la cantine3. Par exemple, les plats végétariens à base de légumineuses laissent sceptiques les enfants qui n’en consomment pas chez eux, à l’image de ce collégien m’interpellant un jour au sujet des burritos sin carne : « Madame, ça existe pas, les wraps végé ! »
Inégalités genrées
L’expérience de la cantine diffère également entre filles et garçons4. Les filles se déplacent peu dans le réfectoire, en groupe lorsqu’elles le peuvent, et discutent avec leurs voisines de table. Les garçons bougent, se parlent d’une table à l’autre, contribuant davantage au bruit et aux bousculades. Il n’est pas rare de voir des garçons empiler fièrement leurs coupelles de dessert vides, théâtralisant leur consommation de quantités importantes. Ils développent des stratégies pour s’approprier davantage de nourriture que la portion théoriquement prévue. Ils osent plus que les filles demander « un peu plus » au self quand on les sert, en insistant sur leur faim pour attirer la compassion des adultes ; il leur arrive de prendre deux desserts, par exemple, en feignant de ne pas savoir qu’ils ne peuvent en prendre qu’un. Les garçons vont également davantage réclamer de la nourriture aux autres enfants, parfois en passant de table en table. Et si les filles ne s’installent à une table où se trouve déjà quelqu’un qu’en dernier recours, des garçons s’assoient sans demander d’autorisation à des tables où se trouvent déjà des filles ou des élèves plus jeunes, voire essaient de les faire partir d’une table qu’ils convoitent. Ainsi, des normes de comportement genrées s’expriment et s’apprennent à la cantine.
Inégalités territoriales
Toutes les cantines ne sont pas logées à la même enseigne pour faire vivre une expérience positive aux enfants. Bien que la restauration scolaire soit de plus en plus réglementée au niveau national, elle relève des collectivités territoriales, qui l’investissent à des degrés variés. Cela crée d’importantes disparités territoriales concernant les tarifs, l’approvisionnement et la qualité des repas. L’agencement des réfectoires, très hétérogène, influence également le bien-être des enfants : une salle sous-dimensionnée oblige à presser les enfants pour qu’ils libèrent leurs tables ; un investissement dans des panneaux acoustiques peut atténuer le bruit. Enfin, la capacité à recruter durablement des agents et animateurs et à remplacer les personnels absents est critique pour donner à ces professionnels la possibilité de consacrer du temps et de l’attention à chaque enfant, de présenter les aliments, de repérer et régler les conflits, d’intégrer les enfants isolés ou de réduire le stress. Or ce sont les enfants les plus vulnérables socialement – allophones, en situation de handicap, issus de familles précaires ou résidant en foyer, par exemple – qui en ont le plus besoin pour pouvoir déjeuner dans de bonnes conditions.
Notes de bas de page
1 Nourrisson, (2002). Des cantines pour l’école. Dans D. Nourrisson (dir.), À votre santé ! Éducation et santé sous la IVe République (p. 71-84). Publications de l’Université de Saint-Étienne.
2 Cnesco. (2017). Enquête sur la restauration et l’architecture scolaires.
3 Tichit, (2020). Construction du rapport à la cantine chez les enfants de migrants. Dans G. Comoretto, A. Lhuissier et A. Maurice, Quand les cantines se mettent à table (p. 79-101). Quae.
4 Ces analyses sont issues de la recherche collective Coralim (Inrae) menée par Christine Tichit, réalisée avec Jieun Jeong, Charlène Le Blanc- Gouverneur, Rébecca Ndour, Alix Pouliquen- Crosato et Noémie Rosillette.