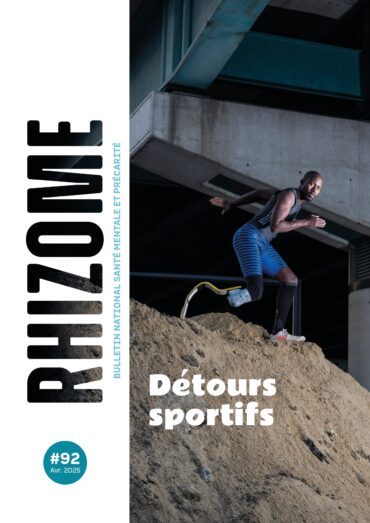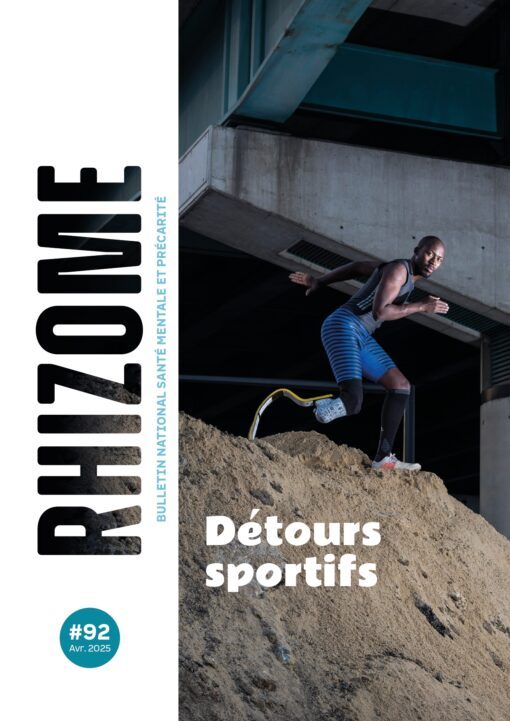« Sitting is the new smoking » (« rester assis est le nouveau tabagisme »), disent les Anglo-Saxons. En France, 95 % de la population adulte est exposée à un risque de détérioration de santé à cause d’un manque d’activité physique ou du temps trop long passé en position assise1. Pour être en bonne santé physique et mentale, il importe pourtant de pratiquer régulièrement une activité ou un sport à intensité variable. Par conséquent, la réduction de la sédentarité est un enjeu de santé publique majeur et constitue un axe fort des programmes de prévention et de promotion de la santé. Ainsi, « Sport et santé » désigne une politique publique dont l’objectif est d’amener l’ensemble de la population à adopter un mode de vie actif2.
Des actions spécifiques destinées aux personnes concernées par les vulnérabilités sociales
Les publics les plus vulnérables sont souvent les plus éloignés des pratiques physiques et sportives. En effet, la précarité et un faible niveau d’éducation sont associés à un faible niveau d’activité physique. À titre d’exemple, nous constatons aujourd’hui que la durée passée devant un écran, le temps total passé en position assise ou allongée et la non-atteinte des recommandations en matière d’activité physique sont globalement plus élevés chez les personnes ayant un faible niveau socio-économique3. Les personnes concernées par les vulnérabilités sociales sont éloignées des pratiques sportives et sont donc des cibles prioritaires des politiques publiques. De plus, ce public est difficile à atteindre. Face à ce constat, l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels agissant en faveur de la mise en œuvre des politiques sanitaires et sociales s’inscrivent dans une démarche d’« aller-vers ». En favorisant, par exemple, la mobilisation des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des personnes sans domicile fixe, cette approche semble être adaptée.
Ainsi, afin de promouvoir les activités physiques et sportives auprès des publics vulnérables, tout en incitant ceux-ci à pratiquer de manière régulière, des actions socio-sportives ont été instaurées. Ce faisant, des activités physiques et sportives adaptées sont proposées dans le cadre des maisons sport santé. Ces dernières sont adaptées aux risques médicaux et prennent en compte les envies, les attentes, mais aussi les capacités et les limites des personnes ayant des besoins spécifiques. Des projets de sport sur ordonnance sont également mis en place au sein des dispositifs d’accompagnement existant entre les structures médicales ou médico-sociales. En complément de l’offre de pratique sportive, ces initiatives facilitent les parcours des publics éloignés ou ayant des besoins particuliers vers une pratique d’activité physique régulière et sécurisée.
Les bénéfices des activités physiques et sportives sur la santé mentale
En luttant notamment contre les effets de la sédentarité, de nombreux travaux mettent en avant les bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé physique. Celle-ci contribue également à une meilleure santé mentale4 en favorisant le bien-être et en améliorant l’estime de soi. Toutefois, les rares études conduites par des spécialistes traitant des effets des activités physiques sur la santé mentale sont peu valorisées alors même que leurs conclusions sont édifiantes5. Les bienfaits des activités physiques et sportives sur le stress et l’anxiété sont les avantages les plus remarquables. Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé rappelle que l’activité physique « permet de réduire le risque de troubles psychiques en agissant notamment sur des facteurs psychologiques tels que le renforcement de l’estime de soi, le sentiment d’auto-efficacité et de contrôle de soi. L’activité physique favoriserait également l’interruption des pensées négatives associées au stress, à la dépression et à l’anxiété6 ».
En effet, pratiquer une activité physique régulière libère des endorphines et une activité sportive réduit efficacement les niveaux de cortisol. La qualité du sommeil, et en particulier la phase d’endormissement, est également améliorée.
Pour les personnes concernées par les pathologies mentales usagères en psychiatrie, la pratique d’une activité physique devrait leur être proposée au même titre qu’un traitement pharmacologique au regard des nombreux bienfaits qu’elle apporte. La plupart des pathologies psychiques ont des conséquences cognitives sur les personnes, telles que des troubles de mémoire, d’attention et des fonctions exécutives7. L’activité physique régulière tend à les réduire. Le sport permet également de développer des compétences sociales et favorise les connexions avec les autres. Ces interactions sociales ont un effet positif non négligeable sur l’état mental des personnes tout en développant un sentiment d’appartenance.
Promouvoir les activités physiques et sportives
Aujourd’hui, il importe de trouver le moyen d’adopter un mode de vie plus actif et moins sédentaire. Il s’agit d’un défi de santé publique. Néanmoins, le développement du sport-santé suppose des interactions nouvelles entre des acteurs (politiques, sociaux, sanitaires et sportifs) qui se méconnaissent. Ainsi, le secteur de la santé doit accorder une place prépondérante à la prévention. L’univers sportif, quant à lui, doit faire évoluer son modèle en passant de celui de la compétition à une offre plus ludique et inclusive.
Notes de bas de page
1 Anses. (2017). Plus d’activité physique et moins de sédentarité pour une meilleure santé.
2 Ce concept récent s’inscrit dans la loi du sport sur ordonnance de 2017. Instruction interministérielle n° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017.
3 Santé publique France. (2024). Activité physique et sédentarité dans la population en France. Synthèse des données disponibles en 2024.
4 Inserm. (2008). L’Inserm en 2008 ; Anses (2016). Actualisation des repères du PNNS- Révisions des repères relatifs à l’activité physique et à la sédentarité.
5 Folkins, C. H. et Sime, W. E. (1981). Entraînement physique et santé mentale. American Psycholo- gist, 36(4), 373-38 ; Martin-Krumm, C. et Tarquinio, C. (2024). Psychologie positive des activités physiques et sportives. Corps, santé mentale et bien-être. Dunod.
6 Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. (2024). Activité physique et sportive : bouger pour une bonne santé mentale.
7 Kern, L., Amado, I. et Milesi, R. (2019). Schizophrénie. Activités physiques adaptées dans un centre de réhabilitation psychosociale. Dans C. Fayollet, L. Kern et C. Thevenon (dir.), Activités physiques en santé mentale (p. 109- 113). Dunod.
Bibliographie
Cha, S., Petit-Sénéchal, P. et Carré, F. (2023). Sport santé : une ambition collective. Hygée Édition