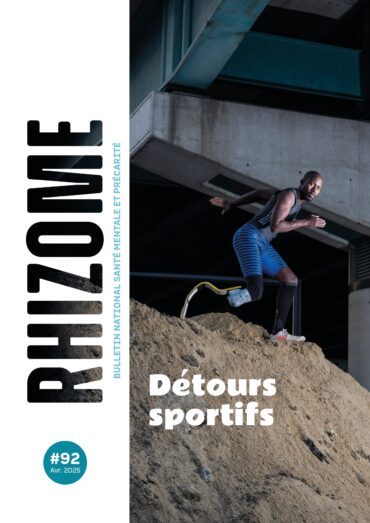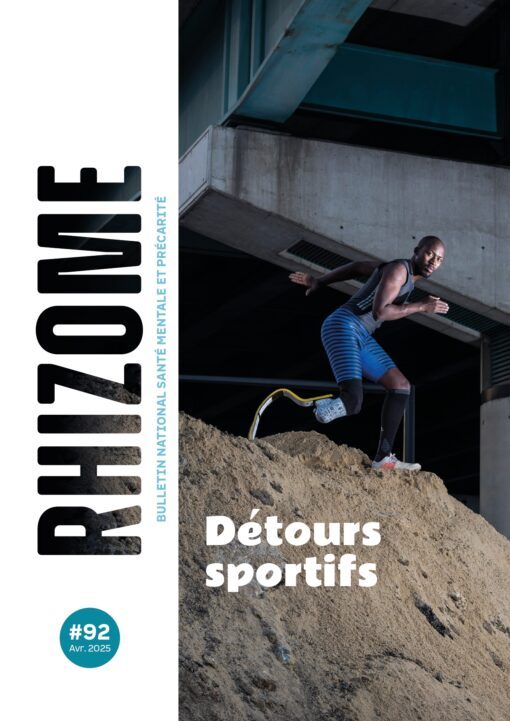Dans un contexte national et international jugé déprimant par de nombreux Français, les Jeux olympiques (JO) de Paris de 2024 ont fait office, pour beaucoup, de « parenthèse enchantée1 ». En pleines vacances estivales, cet événement a été perçu comme un moment hors du temps et régénérant. La communion autour des athlètes a permis à un pays divisé de se rassembler pendant deux grosses semaines, à tel point que les Jeux paralympiques, orgnisés à la rentrée, ont été attendus avec impatience et ont suscité un engouement inédit.
La réussite des Jeux parisiens illustre la capacité des grandes manifestations sportives à créer de la cohésion. En effet, celles-ci peuvent raffermir les liens familiaux et amicaux en centrant l’attention sur un même objet, en permettant d’exulter et de pleurer ensemble – même dans des familles ou des réseaux amicaux dans lesquels les émotions ne s’expriment pas facilement –, et en créant des souvenirs marquants et des rendez- vous attendus – rassemblements devant la télévision autour d’un grand match, sorties au stade ou sur les routes du Tour de France… Au-delà du cercle des proches, le spectacle sportif est une des rares occasions, dans nos sociétés, où les individus peuvent partager un objectif et des émotions intenses – joie, appréhension, déception, colère… –, où ils peuvent crier et chanter ensemble, discuter avec des inconnus, voire les prendre dans les bras après une victoire2. Selon Émile Durkheim, « il ne peut y avoir de société qui ne sente le besoin d’entretenir et de raffermir, à intervalles réguliers, les sentiments collectifs et les idées collectives qui font son unité et sa personnalité. Or, cette réfection morale ne peut être obtenue qu’au moyen de réunions, d’assemblées, de congrégations, où les individus, étroitement rapprochés les uns des autres, réaffirment en commun leurs communs sentiments3 ». Si Émile Durkheim évoquait dans cette citation la religion, cet extrait synthétise bien l’une des principales fonctions sociales du spectacle sportif contemporain.
Le spectacle sportif, entre communion et aliénation
Justement, le spectacle sportif est régulièrement dénoncé comme un « opium du peuple », selon le diagnostic porté par Karl Marx sur la religion. Les grands événements sportifs sont suspectés d’aliéner la population en l’amenant à se passionner pour des activités accessoires, à se détourner des enjeux essentiels et à accepter ainsi des situations difficiles au lieu de les remettre en cause. De fait, si les JO ont été tant appréciés, c’est aussi parce qu’ils ont permis de penser à autre chose qu’à l’actualité politique anxiogène. Qu’ils aient été perçus comme une parenthèse enchantée témoigne cependant du fait que la population n’est pas complètement dupe et qu’elle sait que ces événements sportifs ne constituent qu’un moment éphémère. Selon deux sondages, menés en décembre 2024 par l’Ifop pour Ouest-France et par Odoxa pour Public Sénat, les JO ont constitué, pour les Français, le deuxième ou troisième événement majeur de l’année 2024, après la dissolution de l’Assemblée nationale dans les deux enquêtes, et aussi après la situation économique du pays dans celle d’Odoxa. Ces sondages situent l’importance des JO, tout en soulignant qu’ils paraissent quand même moins cruciaux aux Français que les grands enjeux politiques et économiques du moment.
La Coupe du monde de football 1998 est révélatrice des effets à la fois profonds et superficiels du spectacle sportif. La victoire des Bleus a provoqué des rassemblements inédits depuis la libération du pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce succès sportif est gravé dans la mémoire collective comme un des moments marquants de la fin du xxe siècle. Pour autant, il n’a pas bouleversé aussi profondément le pays que l’ont prétendu ceux qui voyaient dans la sélection nationale le symbole d’une France « Black-Blanc-Beur ». Si la diversité des origines des joueurs a pu plaire à une partie de la population, c’est fondamentalement l’opportunité de communier autour des Bleus et de profiter de moments conviviaux qui a rassemblé les Français. Le mythe d’un pays réconcilié autour de sa diversité culturelle était avant tout porté par des intellectuels peinant à comprendre l’engouement suscité par cette victoire et tentant d’y trouver une explication politique, au risque de la surinterprétation.
Outre l’aliénation, le spectacle sportif est confronté à un autre écueil, celui des tensions qu’il engendre. En effet, il constitue tant un espace de rencontre et de découverte de l’autre que d’opposition et de confrontation à l’autre. La morale du fair-play peut vite être abandonnée au profit du désir ardent de la victoire. Le spectacle sportif suscite régulièrement, de la part de ses spectateurs, des violences envers les adversaires, stigmatisés, insultés, voire physiquement agressés. La communion autour d’une équipe ou d’un champion peut se construire à partir d’une hostilité extrême envers l’autre. Si la guerre en Yougoslavie n’est pas née dans les stades de football, elle y a trouvé des moyens d’expression privilégiés4.
Le sport n’est pas un reflet mécanique de la société : il en constitue plutôt un miroir grossissant et déformant. Il met en évidence des enjeux importants, il donne à voir tant ce qui unit que ce qui divise un pays, comme l’illustrent les débats récurrents autour de la composition de la sélection nationale de football et de la place qu’y occupent les joueurs issus de l’immigration : célébration déjà évoquée de la France « Black-Blanc-Beur » en 1998 ; révélation des blessures encore béantes de la colonisation après l’envahissement de terrain lors d’un match entre la France et l’Algérie en 2001 ; dénonciation, lors de la grève des joueurs pendant le Mondial 2010, des « racailles » qui nuiraient à la sélection comme à l’ensemble du pays5… Le sport peut dépolitiser et aveugler, en amenant la population à se passionner pour des sujets annexes. Il peut aussi faire apparaître des enjeux fondamentaux et éveiller les consciences. Le sport n’est par nature ni bon ni mauvais. Ses effets sont très variables selon la manière dont il est approprié. Il constitue un enjeu de luttes entre différentes conceptions de ce qu’il doit être et entre ses différents acteurs, dont les supporters.
L’engagement dans un groupe de supporters ultras, entre ouverture et repli
Si le spectacle sportif rassemble largement la population lors des grands événements, il mobilise aussi au quotidien, autour d’une équipe ou d’une personne championne, des supporters passionnés. Parmi ces fans réguliers, les groupes de supporters « ultras », apparus dans les stades de football français à partir des années1980, se distinguent par l’intensité de leur soutien à leur club, leur animation spectaculaire des tribunes, mais aussi leurs violences verbales et physiques6. Ces groupes, qui comptent des centaines, voire des milliers, d’adhérents, rassemblent principalement des hommes, et leurs membres les plus actifs sont essentiellement des jeunes entre 16 et 30 ans. Pour autant, les femmes n’en sont pas absentes (elles représentent 10 à 20 % des effectifs selon mes enquêtes) et des supporters plus âgés continuent d’être impliqués au sein des groupes, ou de fréquenter leur tribune. Surtout, les ultras sont issus de milieux sociaux variés. Ainsi, ces groupes permettent à des individus très différents non seulement de se côtoyer, mais également de partager une même passion – ce qui est loin d’être fréquent à notre époque – et de faire preuve de solidarité. Formant souvent l’une des principales associations de leur ville par le nombre d’adhérents et cherchant à s’impliquer dans la vie locale, les ultras collaborent avec les institutions et avec d’autres associations (culturelles ou humanitaires, par exemple), contribuant ainsi à structurer la communauté. Ils se fédèrent aussi, à l’échelle nationale et européenne, autour d’intérêts communs, allant de la défense de la pyrotechnie dans les tribunes à la promotion d’un football « populaire » contre le football « business » porté selon eux par les promoteurs de ce sport, en passant par des revendications sur les horaires des matches, le prix des places ou les modalités de lutte contre les violences des supporters. Cependant, la compétition entre ultras engendre de profondes rivalités entre partisans de clubs différents, mais aussi entre groupes soutenant une même équipe, ce qui débouche parfois sur des violences ou des attitudes discriminatoires. Par conséquent, les groupes ultras constituent tant un vecteur de haine et de rejet de l’autre qu’un espace rare de mixité sociale et d’échanges, ce deuxième aspect étant bien moins médiatisé mais non négligeable. À l’échelle individuelle, l’engagement dans un tel groupe peut s’avérer aussi bien positif que négatif pour l’intégration sociale, comme le slogan récurrent « vivre ultra pour vivre » le souligne. D’un côté, être ultra fournit des relations sociales et des activités variées : au-delà des matches, les animations en tribune doivent être préparées, les déplacements pour suivre l’équipe à l’extérieur organisés, le matériel et la communication du groupe créés… Cet engagement permet d’acquérir des compétences et de se constituer un réseau, ce qui peut être utile pour la vie professionnelle. Plus largement, être ultra aide à se forger une identité positive. Le groupe peut même être une bouée de sauvetage pour certains jeunes en perdition. D’un autre côté, un supporter peut se couper du reste de la société quand il ne vit quasiment que comme ultra, quand cette activité devient sa principale préoccupation et quand il ne s’investit pas ou peu dans d’autres sphères sociales. D’autant que le groupe peut parfois se refermer sur lui-même dans une posture sectaire qui le rend peu réceptif aux points de vue extérieurs. Dès lors, l’engagement d’ultra peut aussi bien être créateur de liens (amicaux, voire amoureux) et d’ouverture sociale, que de confrontation et de repli sur soi.
Ainsi, appréhender les effets du spectacle sportif et du supportérisme sur la société et les individus nécessite d’éviter deux postures caricaturales opposées, conduisant à les considérer comme forcément vertueux ou comme fondamentalement nocifs. Il s’agit plutôt de prendre acte de leur ambivalence et de faire en sorte que leurs aspects positifs puissent se déployer au détriment de leurs versants négatifs.
Notes de bas de page
1 Brafman, N. (2024). Yvan Gastaut, historien : « Le temps laissera plus de place aux Jeux qu’à la période d’instabilité politique. Paris 2024, c’est unique ». Le Monde.
2 Bromberger, C. et al. (1995). Le Match de football. Maison des Sciences de l’Homme.
3 Durkheim, É. (1990[1912]). Les Formes élémentaires de la vie religieuse (p. 610). Presses universitaires de France.
4 Trégourès, L. (2019). Le Football dans le chaos yougoslave. Non-Lieu.
5 Beaud, S. et Sorez, J. (2016). Les Bleus au long cours : indifférence, exaltation et crispations nationales. Dans F. Archambault, S. Beaud et W. Gasparini (dir.), Le Football des nations (p. 197-215). Publications de la Sorbonne.
6 Hourcade, N. (2004). Les groupes de supporters ultras. Agora Débats/Jeunesse, 37, 32-42