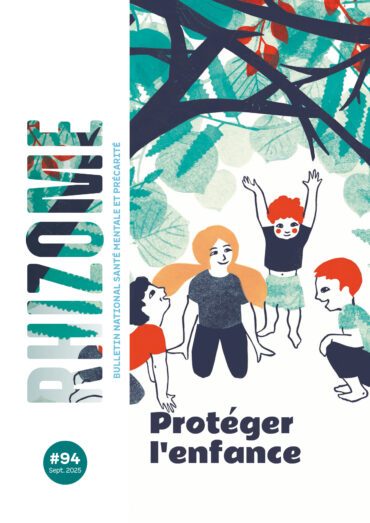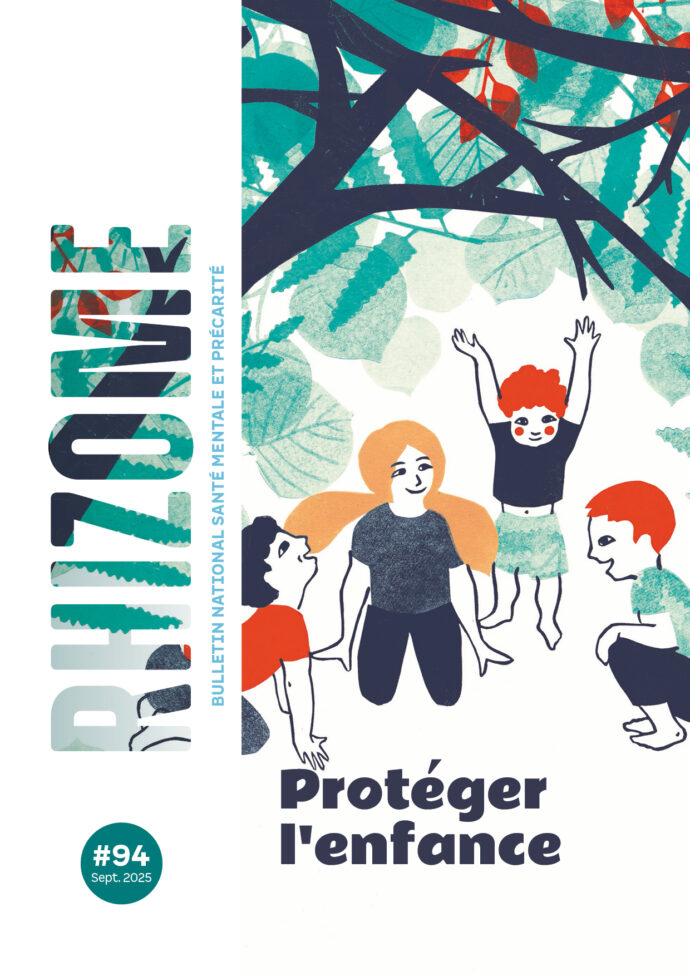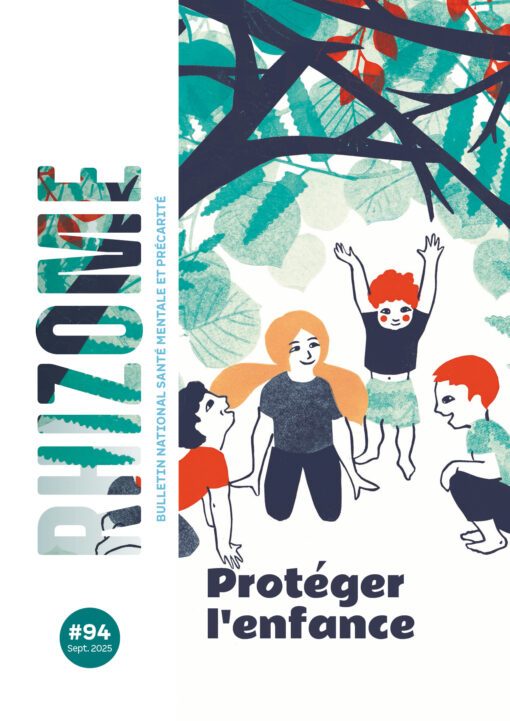Octobre 2024, appel émis par des professionnels du Samu Social 69 à destination du cadre d’astreinte. « Allô, on t’appelle parce qu’on est avec une famille. La mère est avec son compagnon et est enceinte de cinq mois. Sa grossesse est à risque, mais elle n’a pas de document médical l’attestant. Ils ont un enfant de un an et deux mois. »
Entre les lignes se distinguent les portes closes dressées par les catégorisations administratives. Cette mère n’est pas « isolée1 » et ne peut donc pas prétendre à une prise en charge de la métropole, au titre de l’article 222.5 du Code de l’action sociale et des familles2. L’enfant a plus de un an. Son âge ne permet pas, sauf exception, une mise à l’abri immédiate par les services de la préfecture. L’exception se justifierait peut-être par l’état de santé de la mère, toutefois, elle ne dispose pas de certificat à même de le prouver. Ce jour-là, une chance : une faille ou une place libre autorise la mise à l’abri de la mère et de l’enfant. Huit jours plus tard, des jumeaux de 21 mois, présentant un handicap, sont laissés à la rue. Avec leur mère et leur sœur de 6 ans, ils viennent d’être témoins d’une agression au couteau, à proximité de leur lieu de couche.
À Lyon, comme dans les grandes métropoles de France, tandis que l’hébergement d’urgence constitue un droit pour « toute personne en situation de détresse médicale, psychique ou sociale3 », la saturation du parc conduit à un système de priorisation à partir de critères établissant des catégories extra-légales d’ayant droit, dans l’accès immédiat et parfois le maintien en hébergement. Au sein des préfectures, des calculs mathématiques sont effectués afin de fixer les seuils en fonction de la tension sur le parc. Ceux-ci déterminent, en creux, les publics qui n’accéderont pas ou très difficilement à l’hébergement. Les services intégrés d’accueil et d’orientation (Siao) et du 115 portent quant à eux la charge d’effectuer le tri selon les consignes communiquées, celles-ci évoluant selon 11 les saisons, les préfets et la pression de la demande. De plus, les modalités de prises en charge diffèrent selon les territoires4. Progressivement, jusqu’à l’extrême, les digues de l’inconcevable ont cédé tout en laissant transparaître des catégorisations administratives. Celles-ci se resserrent sans limite, soit sans appréhender la fragilité intrinsèque liée à la condition de l’être humain, enfant compris.
Novembre 2024, 23 heures. Gare de Lyon Part-Dieu. Nous retrouvons Denise5 qui a appelé le 115 pour obtenir une couverture. Sa fille, Sophie, a 3 ans. Au départ de l’intervention, nous savons qu’aucune mise à l’abri ne sera possible dans l’immédiat.
À 3 ans, nous avons franchi depuis longtemps le seuil d’âge pour être prioritaire. Denise explique. Cela fait 15 jours que le mari de son amie les a mises dehors car il travaille désormais la journée. La nuit, l’appartement n’a plus de place pour elles. Tandis que Denise égraine les démarches effectuées (le dépôt du dossier Siao, la demande de logement social, le recours droit au logement opposable [Dalo]) tout en espérant que nous lui répondions qu’il en existe d’autres à même de la sortir de l’enfer, Sophie, la tête dans la capuche de sa doudoune rose, transforme le duvet donné en haltère, en attendant son chocolat chaud. Denise s’inquiète des mercredis à errer, lorsqu’il n’y a pas école. Elle a effectué toutes les démarches. Il lui reste à attendre. « On m’a dit huit mois. Je ne pensais pas qu’on me laisserait comme ça. » Nous expliquons que les hébergements sont saturés. Nous ne préciserons pas à cette mère les critères menant à considérer que Sophie est trop grande pour qu’elles soient protégées dans l’immédiat. Au même moment, la petite se cache derrière la poubelle en riant. Si sa mère l’emmène prendre une douche avant l’école, il lui faudra être levée à 6 heures pour se rendre au lieu d’hygiène de la ville. Sinon, à 3 ans, elle portera l’odeur de la nuit sur le béton.
Lors des maraudes, le malaise ressenti est le douloureux prix à payer du refus de la banalisation, parce que les enfants sont avant tout des enfants avant d’être catégorisés sur l’échelle de la vulnérabilité du sans-abrisme. Ce malaise n’est pas l’expression d’une plainte ou d’une lassitude. Il est invité à devenir cri, caisse de résonance des souffrances tues, vacarme à même de conférer visages et voix à celles et ceux qui ne franchissent ni les seuils, ni les catégories, ni les critères. Son origine germe dans la responsabilité à ne jamais s’habituer à observer Sophie jouer avec un duvet devant une gare à 23 heures.
La gestion administrative de la pénurie d’hébergement déshumanise et expose, de facto, à une normalisation du sans-abrisme des enfants, en dépit du droit inconditionnel à l’hébergement et de la Convention internationale des droits de l’enfant. « [S’habituer], en clair, cela signifie perdre de son humanité6. » Au seuil d’une bascule sociétale, le malaise des travailleurs sociaux est l’expression sensible d’une posture politique fondée sur le respect universel des droits fondamentaux. Prioriser l’accès à l’hébergement, plutôt que poser un objectif de réduction du sans-abrisme, est un choix politique. C’est celui qui condamne aujourd’hui des enfants à dormir dans la rue. Demain, d’autres choix seront à même de diminuer le sans-abrisme.
Notes de bas de page
1 Être « isolée » correspond au fait qu’une personne ne se déclare pas en situation de vie de couple.
2 Article 222.5 du Code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : […] 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. »
3 Article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.
4 Ainsi, à titre d’exemples, à Paris, les familles de catégorie 2, 3 et 4 ne sont prises en charge que si une réponse a été apportée aux familles de catégorie 1 (« femme isolée ou famille pour une mise en sécurité suite à des violences conjugales et familiales, grossesses de 3 mois et plus, femmes sortantes de maternité ou avec un enfant de moins de un an, famille avec une personne à mobilité réduite, famille avec une personne présentant une pathologie grave ayant une répercussion sur le quotidien et incompatible avec la vie en rue [ex. : dialyse, cancer] »). À Avignon, en l’absence de titre de séjour, aucun hébergement n’est possible, quel que soit l’âge des enfants. À Valence, le territoire autorise la mise à l’abri de famille avec enfants de moins de un an, avec remise à la rue, quand l’enfant est âgé de un an si aucune autre solution n’a pu être proposée.
5 Les prénoms ont été anonymisés.
6 Quester, H. (acteur). (2000). Primo Levi [interview adaptée en fiction]. Émission Atout poche.