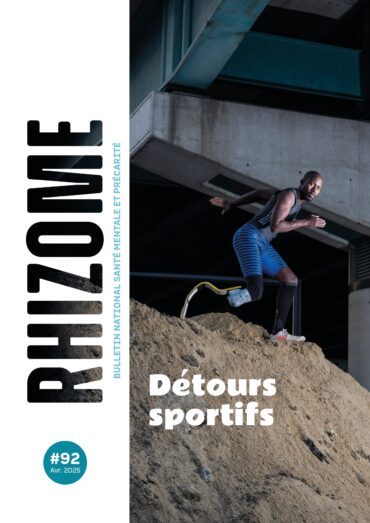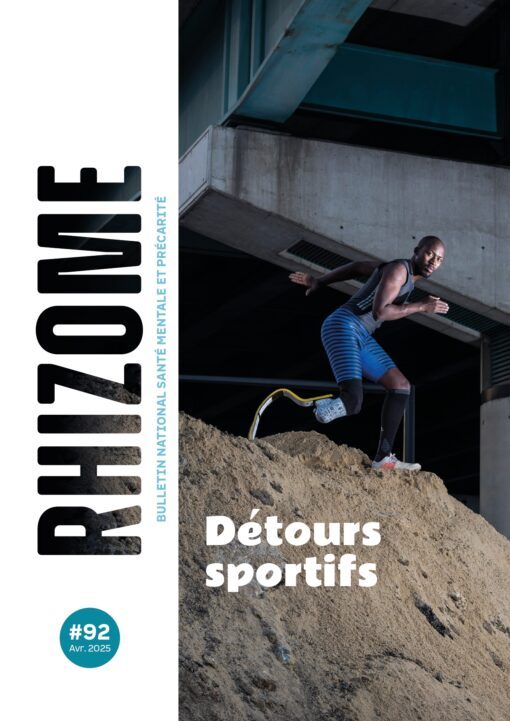Rhizome : Pouvez-vous définir les interventions par la nature et l’aventure (INA) ? Comment la nature et l’aventure sont-elles envisagées dans ce cadre ?
Virginie Gargano : Si le terme « INA » est cité dans la littérature, je propose pour ma part de parler de « pratiques centrées sur la nature et l’aventure » (PCNA) de manière à inclure plus largement toutes les pratiques conduites ou prescrites par des professionnels de la santé physique ou du secteur psychosocial, en individuel ou en collectif, en contexte de nature ou d’aventure. Il s’agit alors d’utiliser la nature, l’aventure, ou la combinaison des deux, au service de l’atteinte d’objectifs concernant la santé physique et mentale des personnes accompagnées. La nature et l’aventure sont ainsi mobilisées comme des leviers d’intervention pouvant permettre, d’une part, d’utiliser leurs bénéfices reconnus dans l’accompagnement des personnes et, d’autre part, d’atteindre des objectifs qui sont difficilement réalisables en contexte d’accompagnement conventionnel. Des formes variées d’intervention existent, allant de la simple exposition à la nature jusqu’à des formats d’expédition s’étalant sur plusieurs jours et mobilisant différentes activités physiques – telles que la randonnée, le surf, l’escalade, ou le kayak.
Rhizome : Quels sont les points d’attention et de vigilance existants autour des PCNA ?
Virginie Gargano : Les premières formes d’interventions en contexte de nature et d’aventure ont historiquement été réalisées sous forme groupale lors de camps de vacances accueillant, par exemple, des publics jeunes avec des troubles du comportement. De nos jours, de plus en plus de pratiques individuelles émergent.
Aujourd’hui, il n’existe aucune contre-indication concernant ces interventions auprès de certains publics. Néanmoins, trois éléments majeurs méritent d’être pris en compte. Le premier fait référence au fait de s’interroger sur les populations à qui les PCNA sont proposées et notamment sur leurs caractéristiques, leurs besoins, mais aussi sur les objectifs à atteindre dans le cadre de ces interventions.
Le deuxième se réfère à l’un des concepts centraux du plein-air, soit la déstabilisation. À notre époque, nous sommes nombreux à vivre dans un contexte industrialisé. La nature n’est donc plus nécessairement notre habitat naturel. Par conséquent, dès que nous sortons dans un milieu naturel, pour la plupart, nous sommes dans une situation de déstabilisation. Cette dernière peut se traduire tant à l’échelle physique – parce que nous ne sommes pas bien dans cet environnement ou à l’inverse parce que le fait d’être dehors nous fait du bien–, qu’à l’échelle psychologique car, hors de notre cadre et de notre environnement habituels, cette expérience nous demande de nous adapter. Dans ce sens, le fait de se diriger vers un contexte qui n’est pas le nôtre est déstabilisant. En effet, cela nous demande de mobiliser des stratégies d’adaptation, mais aussi de nous mobiliser nous- mêmes pour nous lancer dans cette expérience et nous sentir capables de le faire. Au niveau individuel, tout cela demande de l’énergie et au niveau social cela nous demande également de l’adaptation.
Faisons un écart pour souligner l’importance de proposer du répit et des espaces où des personnes puissent se sentir en sécurité au regard des situations sociales qu’elles traversent. Lors d’une PCNA, si nous amenons des personnes en situation de vulnérabilité sociale à quitter leur environnement en les conduisant dans la montagne, où il fait moins 15 °C, il y a beaucoup de neige et de brouillard, et que nous les invitons à dormir dehors, avec des personnes qui leur sont inconnues, tout en leur précisant qu’il y a peu de nourriture et que c’est le feu qui leur permettra de s’alimenter, cette expérience ne sera pas nécessairement vécue positivement. L’exposition peut être trop grande pour certains. Ainsi, si nous décidons, avec les personnes, de leur offrir du répit, il importe de réfléchir sur les aspects qui seront déstabilisés par une PCNA. En effet, pour certaines personnes, le fait de sortir de chez elles est déjà un élément de déstabilisation. Ainsi, l’aventure peut aussi simplement être perçue comme le fait de quitter la zone de confort et d’inviter les personnes à vivre quelque chose de nouveau. Il importe donc de ne pas miser sur tous les aspects de l’aventure parce que cela risquerait d’être trop déstabilisant pour les personnes et ne serait alors pas moteur de développement pour elles. Il est nécessaire de toujours penser à créer un environnement favorable aux apprentissages par l’entremise de différentes activités dans un contexte qui va être suffisamment sécurisant pour les personnes. Par exemple, en montagne, il pourrait s’agir de proposer un hébergement en chalet – avec l’accès à des douches et à une cuisine – qui permettrait d’alterner des moments d’activités – telles que le ski ou des raquettes – avec des moments libres et de répit au chalet.
Enfin, le troisième élément concerne les critères d’inclusion qui sont également à prendre en compte, car les PCNA peuvent être préjudiciables pour des personnes qui sont confrontées à certaines problématiques ou qui traversent certains épisodes de vie. C’est, par exemple, le cas des personnes qui arrêtent de consommer des substances et pour qui les aventures de plein air peuvent être déconseillées, voire dangereuses, certains moments du sevrage nécessitant davantage un contexte sécuritaire et rythmé. Cet exemple nous pousse à nous interroger sur le moment où cette expérience est proposée et comment elle va résonner chez les personnes.
Par ailleurs, le plein-air nous invite parfois à nous centrer sur le moment présent, à nous reconnecter à notre corps, à nos émotions et à être face à nos propres réflexions. Cette reconnexion peut aussi être difficile à vivre à certains moments du parcours des personnes qui ont vécu des traumas ou qui traversent une dépression. Par exemple, le fait de marcher seul en forêt peut augmenter des pensées récurrentes ou des ruminations cognitives. Il faut donc toujours être attentif aux interventions qui sont suggérées, recommandées ou prescrites en fonction, encore une fois, des besoins de la personne.
Concernant les expériences traumatiques, les différents types de nature méritent également réflexion. Par exemple, pour certaines personnes, le fait d’être confrontées à un désert peut être réellement puissant et incroyable. Toutefois, pour d’autres, et notamment les personnes ayant des vécus migratoires, cet espace naturel peut être associé à des expériences douloureuses. Il est donc également pertinent de questionner les personnes sur leur propre définition et représentation des espaces naturels qu’elles identifient comme étant ressourçants pour elles.
Rhizome : Quels sont les effets positifs des PCNA sur la santé mentale des personnes ?
Virginie Gargano : L’humain a souvent besoin de catégoriser, de comprendre et de mettre des mots sur ce qui parfois le dépasse. Aller en plein air a des effets holistiques qui peuvent être difficilement explicables.
La nature et l’aventure peuvent être envisagées comme des médiateurs de résultats. Par exemple, une personne qui a un chien, en le promenant, va être amenée à croiser d’autres individus. Cela pourra lui permettre de créer des liens et même de se sentir intégrée et affiliée à une communauté – du quartier, ou d’autres personnes ayant des chiens. Dans ce cadre, l’élément naturel, soit le chien et la relation que cette personne a avec son animal, deviennent des médiateurs de bénéfices sociaux.
Les expositions à la nature, qu’elles soient associées à une haute ou basse intensité d’activité physique, ont des effets positifs sur les personnes. En effet, le fait de s’exposer à la lumière naturelle, d’aller marcher pendant plusieurs heures en milieu périurbain ou naturel, ou de s’asseoir sur un banc dans un parc permet, par exemple, de baisser des indicateurs de stress tels que le taux de cortisol ou le rythme cardiaque et augmenter certaines cellules dites anticancéreuses. Nous retrouverons aussi d’autres effets positifs supplémentaires, tels que le fait de ressentir des sentiments de calme, de plénitude, de relaxation ainsi que l’augmentation de la forme physique.
Dans le cadre des expéditions qui impliquent une plus longue durée d’exposition, les effets sont de fait potentialisés. Les personnes vont être davantage actives physiquement sur une temporalité plus longue. Au niveau social, les effets sont également importants car les personnes sont en groupe et souvent dans des situations d’interdépendance. Par exemple, dans le cadre d’une expédition en kayak de mer, deux personnes doivent pagayer, une seule ne pouvant parvenir à transporter l’embarcation sans aide. D’autres effets psychologiques ont également été constatés au niveau communicationnel, émotionnel et spirituel.
Bien évidemment, les personnes font aussi face à des enjeux personnels lors de ces expériences collectives, notamment en ce qui concerne les sentiments d’affiliation ou d’acceptation, particulièrement importants à l’adolescence.
Enfin, les valeurs et la dynamique au sein du groupe dépendent beaucoup des intervenants. Ces derniers jouent un rôle majeur afin que la dynamique du groupe et les valeurs véhiculées soient positives. Par exemple, les valeurs d’inclusion ne règlent pas tout mais elles participent à diffuser des effets positifs au sein du collectif et permettent à tous les membres de se sentir respectés au sein d’une même dynamique.
Rhizome : Quels sont les enjeux inhérents aux pratiques des PCNA ?
Virginie Gargano : Aujourd’hui, de nombreuses populations peuvent vivre des bénéfices à aller en plein air ou à participer à des programmes de plein air. L’accessibilité et la mobilité des personnes vers les espaces naturels sont donc des enjeux majeurs. Le plein-air et la nature peuvent être assez accessibles pour les personnes qui habitent au sein de régions périurbaines, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Nous pouvons citer les personnes qui ne sont pas véhiculées ou encore celles à mobilité réduite qui sont confrontées à davantage d’obstacles lors de leurs déplacements. Ici, le manque d’accessibilité souligne des inégalités sociales existantes. L’accès à certaines zones – une plage, un parc, la traversée d’une rivière ou la navigation sur un lac –, autant en milieu urbain que rural, peut également être réglementé et payant, ce qui est un frein supplémentaire. L’aspect financier autour de la pratique de la majorité des activités de plein air est également à prendre en compte au vu de l’investissement que peut représenter l’acquisition du matériel, mais aussi de l’accessibilité aux espaces de pratique. Au-delà de la marche, les activités de plein air peuvent parfois être limitées. Pour la majorité des personnes, il est inenvisageable de partir régulièrement en milieu naturel. Il importe donc d’investir l’environne- ment dans lequel nous sommes et qui nous entoure afin d’avoir du pouvoir sur notre situation.
Il importe que les expériences impliquant la nature et l’aventure soient accessibles à tous au vu des bienfaits sur la santé mentale des individus. Des politiques d’accessibilité les promouvant sont intéressantes à penser et à mettre en place.