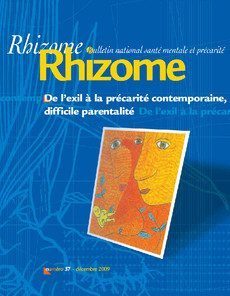La précarité et la demande d’asile ont parties liées, intimement. On peut même dire que la demande d’asile constitue l’un des paradigmes de la précarité et que, s’agissant de la parentalité, on peut observer des effets psychosociaux en rapport avec cette situation éminemment précaire.
Rappelons tout d’abord les basics
La précarité n’est pas la pauvreté, car la précarité n’est pas avoir peu, voire très peu, c’est avoir peur. Peur de quoi ? Peur de perdre ce qui permet à l’homme de jouer à l’humain avec d’autres humains ; ce qui est très concrètement perdable, ce sont les objets sociaux investis par le socius, qui font lien et qui permettent d’être reconnu comme un humain digne de ne pas être exclu de la commune humanité via son groupe d’appartenance. Les principaux objets sociaux sont : le logement, le travail, le statut, l’argent (on retrouve la pauvreté à un niveau non quantitatif), la famille (la famille peut être « perdue »), et, s’agissant de la demande d’asile, les papiers, ceux qui autorisent à vivre dans un pays et à bénéficier des droits y afférents.
Sur son versant ordinaire la précarité se définit d’abord comme la position constitutive d’avoir besoin de l’autre, des autres : nul ne peut vivre seul, voilà la vulnérabilité première sur le plan psychosocial aussi bien que biologique. A partir de là, les circuits vitaux de la demande, pendant l’enfance et tout au long de la vie, organisent des liens qui, dans les bons cas, produisent la confiance : confiance en soi-même (si l’on m’aide, je suis bon, confirmation narcissique), confiance en autrui (s’il m’aide, il est suffisamment bon, récusation du monde paranoïaque), et confiance en l’avenir (s’il m’a aidé aujourd’hui, lui ou un autre m’aidera demain : récusation du monde mélancolique) ; certes, l’avenir est par nature incertain et même inconnu, voilà la vulnérabilité seconde ; mais anticiper d’être accompagné par l’autre, les autres, pour vivre demain en société ouvre le goût à une temporalité vectorisée par le désir. Bien sûr, la demande et l’aide sont en position complémentaire, asymétrique, mais comme elles se situent dans le cadre du don et de la dette, de l’obligation de recevoir et de rendre, elles ouvrent à la réciprocité : le don constitue l’autre face de la demande, que celle-ci soit explicite ou implicite. Ainsi, de par cette précarité constitutive, vulnérabilisante, les individus sont reliés à eux-mêmes, à autrui, au socius et à l’avenir grâce à une production suffisante de confiance narcissique, qui fonde la relation d’objet, qui permet le désir d’un sujet « allant-devenant dans le génie de son être et de son sexe », comme disait Françoise Dolto. Le narcissisme, on n’y insiste pas assez, est étroitement lié à la confiance ; c’est elle qui donne leurs couleurs aux images et représentations, qui fonde l’amour de soi et ses prolongements.
Or la clinique psychosociale en régime d’hyper-modernité a une tendance forte à révéler une déficience de la production de confiance, ce qui aboutit à des troubles identitaires narcissiques, à une paranoïa ambiante collective, et au risque majeur d’une perte de la notion même d’avenir, avec mélancolisation, catastrophisme, décadentisme, phénomènes peu propices à une pensée écologique située par essence dans le grand temps. A l’inverse, être précaire à l’excès, c’est entrer dans le temps de l’urgence permanente, du court-termisme, du stress comme genre de vie1. Cette défaillance de la confiance doit être comprise dans le contexte du management néolibéral du monde qui privilégie les flux aux personnes, les individus isolés aux institutions.
La précarité excessive et la demande d’asile
Il est simple de comprendre, avec un minimum d’empathie et de mémoire (de sa propre expérience), cette peur de perdre la possibilité de jouer pour de vrai à l’humain avec d’autres humains, la peur de ne plus avoir de place reconnue dans une société donnée en tant qu’humain digne d’y appartenir. Cette non assignation, c’est-à-dire cette absence de place juridique validée, est exemplaire en ce qui concerne la demande d’asile lorsque celle-ci dure, lorsqu’elle « s’éternise », ou lorsqu’elle est déboutée : il n’y a parfois même plus l’urgentification du monde signalée plus haut, mais une pure et simple suspension du temps ; voici des sujets humains qui ne sont plus là-bas, d’où ils sont venus pour des problèmes de violence d’Etat ou inter ethniques, et qui ne sont pas davantage ici »; le temps suspendu s’accompagne d’un état d’apesanteur avec perte des lois de la gravitation psychosociale qui normalement fixent une personne sur cette terre, en ce lieu, à cette époque, avec ce socius, en qualité de sujet qui prend place avec d’autres dans une distance qui permetla relation. L’anomie décrite par Durkheim au début du XXème siècle, au moment du premier capitalisme et de l’exode rural, signifie littéralement « absence d’assignation », tandis que la désaffiliation de Robert Castel, au temps de la seconde modernité, ou hypermodernité, situe cette perte d’assignation au sein d’un groupe d’ayants droit qui, normalement, est supposé dispenser les sécurités de base.
Voici une observation : deux sœurs, âgées d’environ cinquante ans, consultent en CMP. Elles viennent d’un pays où se sont exercées des violences contre leur nationalité ; leurs conjoints sont décédés de mort violente, comme le gendre de la fille de l’une des sœurs. L’une des sœurs a obtenu ses papiers, elle parle bien le français, s’occupe de tout le monde, a fait des stages de professionnalisation (elle avait un diplôme d’études supérieures dans son pays d’origine) ; l’autre sœur n’a pas eu ses papiers : par suite d’un changement d’adresse, elle ne s’est pas présentée dans les temps à l’OFPRA, et le recours ne sera d’aucune efficacité. Cette seconde sœur parle très mal le français, apparaît comme « étonnée » (dans le sens obstétrical du terme : ces nouveau-nés qui naissent avec difficulté, sans mimique, comme s’ils n’étaient pas encore là, dans le monde aérien), avec des complications somatiques et psychiques qui émaillent son histoire récente. Cette seconde sœur apparaît « hors temps » alors qu’elle a des enfants avec elle et un petit fils. Elle qui exerçait un métier de haut niveau dans son pays d’origine, se retrouve dans un entre-deux sans deux, dans un « entre » sans rien, ni d’un côté ni de l’autre : pas de papiers, pas d’assignation, la précarité poussée à son paroxysme. Elle est entretenue et nourrie par sa sœur. Je demande pour elle (une fois les recours d’usage épuisés) le statut pour étranger malade, largement justifié, qu’elle obtiendra avec les droits afférents : elle se mettra à parler français, à sourire, à reprendre goût à la vie et à la parole, trouvera un travail d’accompagnement pour les personnes âgées de sa nationalité, et bien sûr me donnera des cadeaux, des friandises : elle entre dans le don et la réciprocité, tout en gardant une pathologie psychosomatique. Fait important pour le thème traité ici, elle m’amène un jour sa fille en consultation, à sa place, elle aussi dans une temporalité suspendue, dans l’éternisation d’une demande de recours qui s’avérera heureusement favorable quelques mois après. Je percevais dans cette jeune femme, sa fille, une espérance immobilisée, qui se mettait en jeu lorsqu’elle évoquait son fils, qui lui, allait bien à l’école, ou lorsqu’elle me serrait la main, en partant. J’arrête là cette vignette sur ce point de pivotage où la mère, reconnue via son nouveau statut d’étranger malade, devient une mère non seulement soucieuse pour sa fille, ce qu’elle était déjà, mais en puissance de préoccupation parentale active : elle m’amène sa fille en consultation2.
Comment comprendre le rapport de la précarité avec la parentalité ?
On peut schématiquement en décrire trois modes avec des formes de passage de l’un à l’autre.
Premier mode : Lorsque la situation de précarité et de perte possible des sécurités est vécue sans déni de la souffrance psychique, avec des étayages anciens et actuels convenables, elle peut stimuler les capacités de débrouille, entraîner certes des moments de découragement et de pathologies, mais qui n’empêchent pas la demande d’aide et le fait de pouvoir rebondir. Les sujets conservent une capacité de désillusion non sidérante qui permet de penser l’avenir. Les enfants, en tant que « supports concrets de l’avenir », stimulent cette capacité et ressentent eux-mêmes la possibilité d’un avenir ouvert, avec une vulnérabilité assumée qui permet d’accepter les défis. La parentalité s’exerce normalement, voire en surrégime.
Deuxième mode : Lorsque la situation de précarité commence d’empêcher de vivre par l’idée fixe de la perte des objets sociaux, il y a mélancolisation du sujet ; celui-ci a déjà perdu, psychiquement, avant d’avoir perdu concrètement ; les situations de découragement, voire de désespoir, sidèrent la capacité d’une ré-illusion positive, et produisent des effets de désinvestissement de soi-même et des autres en tant qu’aidants potentiels, tandis que l’avenir devient impensable, sauf du côté de l’irrémédiable : il s’est passé une perte, ou il va se passer une perte à jamais immobilisatrice du désir d’aller-devenant dans le génie de son être et de son sexe ; la parentalité a alors du mal à se déployer comme une puissance d’agir pour ses enfants qui, au mieux, représentent un avenir substitutif, un symptôme. On imagine l’effet sur des enfants ou des adolescents d’avoir des parents pour qui l’avenir est perdu : comment transmettre à ses enfants le goût « d’y aller », dans la vie qui est là et qui appelle, si le monde dont on témoigne est considéré comme perdu, aboli, ou une catastrophe annoncée ? La toute impuissance remplace la toute puissance nécessaire du parent qui doit penser pouvoir aider ses enfants, quoi qu’il arrive, en acceptant au passage le minimum d’épreuve de réalité. Ce fut, je pense, le cas de la seconde sœur et de sa fille, évoqué plus haut, avant l’obtention du statut d’étranger malade, avec cette temporalité suspendue, mélancolique, discrète autant qu’impressionnante lorsqu’on la rencontre. Dans ces types de situation, l’enfant peut aussi se parentaliser, c’est-à-dire inverser sa position et prendre en charge ses parents immobilisés, « déparentalisés ».
A l’extrême, il est des situations qui empêchent même de souffrir, et donc de se ressentir dans une entité psychosomatique vivante et souffrante. Le déni et le clivage sont à leur comble, dont j’ai décrit les formes extrêmes sous le terme de syndrome d’autoexclusion3. L’un des signes majeurs en est la rupture active des liens, notamment avec les conjoints et les enfants. L’enfant devient invisible lorsque le parent reste physiquement en présence, mais avec souvent une séparation effective. J’ai vu des parents rechuter dans l’autoexclusion à la simple vue inopinée des enfants dont ils étaient séparés. Mais la rupture peut se faire avec tout l’environnement, et entraîner un isolement de la famille qui devient un véritable ghetto.
Ce que je viens de décrire n’est pas spécifique de la demande d’asile, qui est une des situations exemplaires de précarité parmi beaucoup d’autres. Son exemplarité vient de la non assignation paradigmatique, transitoire, des demandeurs d’asile, qui peut se pérenniser lorsqu’ils quittent ce statut pour des situations encore plus précaires.
Il y a d’autres modèles de la précarité que la non assignation, qui en constitue le versant socio-juridique, avec ses effets psychiques : je cite, sans exhaustivité, la maltraitance infantile, la maltraitance politique du type des camps de concentration, et l’on sait qu’il peut y avoir des effets « comme dans les camps sans camps » ; il peut enfin y avoir le paradigme de la présentation de l’enfant par la famille au grand groupe, au 40ième jour dans les sociétés traditionnelles4. Dans tous les cas, le respect dévolu aux parents conditionne, en grande partie, les conditions d’expérience et de pratique de la parentalité.
Notes de bas de page
1 On pourrait aussi bien parler de souffrance psychique d’origine sociale, de traumatisme, de comportement de survie, mais nous n’entrons pas dans ces notions différentielles maintenant.
2 On sait aussi que l’obtention d’un statut peut déstabiliser une personne en demande d’asile ; cela signifie aussi l’authentification juridique de l’exil, la perte de « là-bas ».
3 J’ai décrit ce syndrome depuis 1999, dans un rapport collectif de l’Orspere : Place et rôle des acteurs de la clinique psychosociale (épuisé) ; on peut lire sur ce thème : Furtos J., les cliniques de la précarité, contexte social, psychopathologies et dispositifs, Masson, 2008, le chapitre 11, ou : De la précarité au syndrome d’autoexclusion, édition la rue d’Ulm, 2009.
4 Rochette J., Précarité et périnatalité précoce : 40 jours pour transformer le désordre aléatoire en « chaos organisé », in Furtos J., les cliniques de la précarité, op. cit., p 98-113.