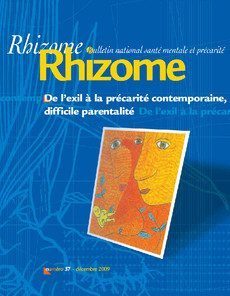Si l’exercice de la fonction parentale est en soi une question complexe, elle l’est de manière accrue lorsqu’elle a lieu dans le cadre d’un processus migratoire.
Comment somme toute assurer à son enfant protection, sécurité, moralité, éducation, développement, santé –missions imparties aux parents par l’article 371.1 du Code civil – dans le cadre insécurisant de la migration ? Surtout lorsqu’elle s’accompagne de la situation irrégulière ou provisoire (demande en cours, autorisation provisoire, etc…) des parents.
Plus généralement la parentalité en exil est confrontée sur un terrain juridique à une série de sujétions particulières, d’obstacles spécifiques.
La première série de difficultés découle de la technicité du droit ici en œuvre, à mi-chemin entre droit des étrangers et droit international privé, entre règles écrites et principes informels.
La deuxième est imputable aux restrictions posées à certaines formes de parentalité sur le sol français, voire même à des définitions spécifiques de la filiation quant il s’agit de migrants.
Enfin, vivre en famille dans un contexte où l’immigration familiale est quotidiennement décriée suppose soit une certaine résistance des intéressés, soit une grande indifférence.
Un entre-deux complexe : le droit international privé
La famille étrangère relève d’un entre-deux éminemment complexe qui découle du droit international privé. Sur certains points, elle relève du droit de la famille en œuvre sur la terre d’accueil, sur d’autres, elle se voit appliquer des règles du pays d’origine (c’est le statut personnel). Règles de droit applicable en matière d’autorité parentale, de tutelle, de mariage ou de divorce, de nom de l’enfant pour des étrangers vivant en France sont autant de sujets pointus sur lesquels les plus éminents juristes peinent régulièrement. On comprend alors que pour les intéressés le « nul n’est sensé ignoré la loi » fait ici figure de pétition de principe bien utopique.
Prenons l’exemple du nom de l’enfant étranger né en France. Depuis 2005 ses parents peuvent choisir en application du droit français de lui donner le nom de l’un, de l’autre des parents ou le double nom. Une fois cette démarche effectuée ils se rendront probablement auprès de leur consulat pour enregistrer leur enfant sur les registres de leur pays. Et là le nom qui lui sera donné le sera en application du droit d’origine, en général le nom du père. Du coup, le même enfant portera deux noms distincts sur ses différents documents d’identité.
En matière d’autorité parentale, la loi française pose depuis 1993 le principe d’un exercice conjoint par les deux parents. Ce n’est pas le cas dans tous les pays de provenance : du coup, pour le même enfant, le père sera seul à prendre les décisions quand ils seront au pays et les deux parents les prendront arrivés sur le sol français.
Ce difficile passage d’un modèle à l’autre pourrait être illustré par un courrier adressé il y a une dizaine d’années par une association de maliens de France au président de la république pour se plaindre du versement à leurs conjointes des prestations familiales. Et de dénoncer ce qui est pour elle les incidences destructrices de cette pratique sur leur modèle familial.
Ces exemples parmi d’autres illustrent la complexité du processus migratoire en matière de droit familial. Sur le terrain de la conjugalité, des exemples tirés de répudiations, de succession, de polygamie ou même de consentement au mariage pourraient d’ailleurs, de la même manière, illustrer cet entre-deux complexe.
Des règles coutumières non écrites
Outre la complexité des règles écrites, l’étranger est confronté à des normes implicites, non formalisées. Prenons l’exemple de la contrainte exercée par les parents sur leurs enfants.
L’exercice de l’autorité parentale peut en effet conduire des parents à recourir à des formes de contrainte sur leurs enfants pouvant même aller jusqu’à des formes de violences légères que les tribunaux français tolèrent1. On pense à la gifle ou à la fessée qui, sous certaines conditions (légèreté, en réponse à un fait, proportionnée, non répétée), n’entraînera aucune sanction à l’encontre des parents. C’est d’ailleurs au regard de cette tolérance qu’ils critiquent qu’un certain nombre d’acteurs des droits de l’enfant réclament une pénalisation de tels actes2.
Dans l’attente d’une éventuelle réforme et indépendamment de toute modification législative, le niveau de tolérance a considérablement évolué en France au cours des dernières années. Le fouet ou le martinet, largement en usage il y a trente ans, ne sont aujourd’hui plus admis. Que dire encore du coup de réglette à l’école. Reste que, selon son pays de provenance, l’étranger est porteur d’un niveau de tolérance en la matière souvent bien différent de celui désormais en vigueur ici. Au demeurant l’exercice de la contrainte peut y être partagé (à la famille, à la communauté, au village) quand en France il est l’œuvre exclusive des titulaires de l’autorité parentale.
On peut dès lors comprendre la difficulté pour le migrant de repérer, en l’absence de toute règlementation précise, le positionnement du curseur de cette tolérance en France. L’expérience que nous tirons d’ateliers autour de la parentalité dans les centres sociaux et culturels l’illustre aisément. Systématiquement ce curseur est interrogé. « Jusqu’où puis-je aller en matière de contrainte ? » est une question récurrente.
Migrants avant d’être une famille
Famille étrangère ou étrangère famille ? Textes, discours, pratiques font souvent passer l’extranéité comme une grille de lecture prioritaire avant toute autre.
Il faudrait par exemple refaire l’historique du discours politique relatif aux étrangers bénéficiaires de prestations familiales. Le plus célèbre est évidemment celui d’un président de la République, discours désormais connu sous le nom « le bruit et l’odeur ». Cette fameuse famille « qui gagne 50 000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler ».
Tout se passe comme si ce type de discours avait impacté les pratiques des caisses qui parfois n’hésitent pas, et ce malgré moult condamnations judiciaires, à restreindre les droits aux prestations des migrants.
Le premier exemple est tiré du refus d’ouvrir les prestations familiales aux enfants entrés en dehors du regroupement familial.
Faisant fi de sa mission légale et prioritaire, la CNAF semble vouloir faire payer –y compris illégalement- l’entrée irrégulière sur le territoire d’enfants étrangers. Les condamnations contentieuses des Caisses d’allocations familiales ne cessent pourtant de s’accumuler3. La défenseure des enfants en juin 2004, puis la HALDE en novembre 2006 n’ont de cesse de critiquer les positions de cette institution contraires tant à la Convention européenne des droits de l’homme et que de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le deuxième exemple peut être tiré de la situation faite aux enfants étrangers confiés en France. Ils peuvent l’être au titre de Kafala de droit musulman (dans les pays où l’adoption est prohibée) ou même sans aucun acte juridique, le tout à un membre de famille ou proche vivant en France. Là encore malgré les jurisprudences4 et surtout le Code de la Sécurité sociale au terme duquel « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant »5, de nombreuses CAF refusent d’ouvrir un droit aux prestations familiales à ces enfants. Sous le couvert d’un argument officiel – l’absence de lien juridique qui unit le demandeur de prestations et l’enfant – ce sont les formes étrangères d’organisation familiale qui sont sanctionnées.
Cette question des enfants confiés illustre d’ailleurs une lecture ethnocentrée des structures familiales. Suspicion de trafic, d’enfant en danger, ou d’utilisation des mineurs aux fins de contournement des contrôles aux frontières sont autant de lieux communs entendus ici. Or la réalité est souvent plus complexe. Des familles vivant en France peuvent confier de la même manière un enfant à un proche resté au pays. Au demeurant, rares sont les étrangers qui confient un enfant au premier venu : ce sont souvent des proches –membres de famille ou non- dignes de confiance. Evidemment ces situations seront complexes à gérer sur le sol français en particulier au regard des règles de base du droit de l’autorité parentale. Pour autant, parler d’enfant en danger est un raccourci bien discutable.
C’est d’ailleurs pour sanctionner de manière plus radicale ces pratiques que le ministre de l’intérieur Sarkozy a fait modifier en 2006 l’article 311.11 alinéa 3 du code des étrangers. Jusqu’alors tout enfant même entré irrégulièrement avant l’âge de 13 ans était régularisé à 18 ans. Désormais le texte précise que pour être régularisé l’enfant devra justifier avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Manière très explicite de rejeter toute autre forme de parentalité. Paradoxalement, alors que la réforme de la filiation qui entre en vigueur en 2006 supprime toute référence aux notions de légitime, naturel ou adoptif, le code des étrangers y fait pour la première fois référence en… 2006. Concrètement cela signifie désormais que ces enfants, même entrés à la prime enfance, seront irréguliers à l’âge de la majorité.
Des modes d’établissement de la filiation différents pour les étrangers ?
Tout a été écrit sur la loi Hortefeux et le contrôle de la filiation par test Adn dans le cadre du regroupement familial. Notons simplement le paradoxe d’une telle loi et d’une lecture « biologisante » de la filiation dans le droit des étrangers au moment où sont votées des réformes de l’autorité parentale et de la filiation dans le Code civil qui la définissent tout à fait autrement.
Cette loi n’est toutefois pas la première à définir la filiation étrangère différemment de celle de la population autochtone6.
Un précédent récent peut être cité. Dans le projet de loi Sarkozy de 2006, il était déjà question de contrôler spécifiquement la filiation des migrants. La question n’était alors pas liée au regroupement familial mais plutôt aux reconnaissances dites de complaisance.
Si finalement l’idée de contrôler les filiations a vite montré lors du débat parlementaire plus d’inconvénients que d’avantages, un tel contrôle a toutefois été mis en place sur une partie – certes éloigné – du territoire national, à Mayotte. Sans susciter aucune réaction.
L’article 2499-2 du Code civil voté alors met en place un système de contrôle de la filiation par l’agent d’état civil. Le texte précise que « lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d’un enfant est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance ». Reste ensuite aux soins de l’agent de déterminer ce que peuvent les fameux indices de fausse déclaration.
Le reste de la procédure est calée sur celle existant en matière de contrôle des mariages : le parquet dispose de 15 jours pour enquêter et surseoir éventuellement à l’enregistrement de la filiation pour une durée d’un mois renouvelable une fois. Il peut également s’opposer à l’établissement de la filiation.
Plus généralement la suspicion généralisée sur le mariage des étrangers s’accompagne d’une large mise en doute de la parentalité des migrants : « du mariage blanc aux enfants blancs ». Dès 1993 les lois Pasqua-Méhaignerie remettaient en cause le droit du sol afin de lutter contre les régularisations des parents d’enfants français. En 1998, la loi Chevènement-Guigou rétablissait certes le droit du sol mais seulement à la majorité ou de manière anticipée à 13 ans. Il n’est alors toutefois pas souhaité rétablir ce droit dès la naissance afin de lutter contre les naissances de « complaisance » et donc pouvoir reconduire à la frontière pendant cette période. L’idéologie dominant, en facteur commun, ces deux textes reposent sur l’idée selon laquelle les étrangers donneraient naissance aux seules fins d’obtention des papiers.
Du coup, pour pouvoir régulariser sa situation administrative le sans-papiers parent d’un enfant français doit désormais apporter la preuve qu’il contribue « effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans »7. Or l’article 371.2 précité du code civil porte sur la contribution financière (« selon ses ressources ») à l’éducation de l’enfant.
Cette preuve –au demeurant par écrit – est d’autant plus complexe à apporter que le sans-papiers n’étant pas autorisé à travailler, il ne peut donc a priori pas justifier de contribution financière. Sur la même base légale, la préfecture des Hauts de Seine vient, dans un dossier récent, de s’appuyer sur le fait qu’un enfant était pris en charge par l’aide sociale à l’enfance pour justifier l’absence d’entretien par le père et donc son éloignement.
Vivre sa famille dans la culpabilité
Aujourd’hui le discours ambiant en matière migratoire valorise une immigration – l’immigration de travail – et en stigmatise une autre : l’immigration familiale. On doit clairement comprendre travail quand on parle d’immigration choisie et comprendre non désirée pour l’autre. Il faut dire que le miracle démographique français entraîne des divergences d’appréciation en Europe de cette question : dans de nombreux pays voisins l’immigration familiale est justement choisie et priorisée.
En raison de ces divergences, l’Union européenne peine à reconnaître un vrai droit de vivre en famille aux migrants. Les consensus se font plutôt autour de politique commune d’éloignement, de la restriction du droit d’asile, ou encore sur l’exigence d’intégration dans l’obtention des droits au séjour. C’est donc plus devant les instances du Conseil de l’Europe8 que celle de l’UE, en se prévalant de son texte de référence –la Convention européenne des droits de l’homme- que les migrants peuvent faire reconnaître leur droit de vivre en famille. Ou au moins préserver les droits acquis.
Pour autant, bien que ce droit de vivre en famille soit reconnu par ce texte et depuis peu par la jurisprudence du Conseil d’Etat et la Cour de cassation, les freins à l’exercice de ce droit ne cessent de se multiplier9. Pis, du service du logement de la mairie au service social en passant par la préfecture, du discours des médias à ceux des politiques, le demandeur sera confronté à toute une palette discursive qui aura pour effet de lui faire comprendre que sa famille est une contrainte. Surtout si elle est nombreuse.
On peine alors à imaginer le ressenti de l’étranger face à un tel discours récurent. Pour quelques rares qui malgré tout revendiqueront leur famille comme un droit combien vivront une certaine culpabilité dans le fait de vivre en famille en France.
Non seulement la famille étrangère est présentée comme une difficulté, un problème, mais elle est aussi ponctuellement une grille d’explication de nombreux maux de la société.
Rappelons-nous par exemple des explications données au moment des émeutes urbaines de 2005. Pour Gérard Larcher, ministre, la polygamie en était une explication puis de poursuivre sur « la désintégration des familles africaines face aux valeurs d’égalité » et une « pauvreté culturelle« . Pour conclure qu’ »un certain nombre de familles africaines » dont les enfants vivent dans « un appartement sur-occupé », ont « une référence lointaine au père, et une mère qui, parfois, connaît des problèmes de respect et d’égalité« . Aussitôt suivi par Bernard Accoyer, le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale, qui constatant que les pouvoirs publics s’étaient montrés « étrangement laxistes avec la polygamie », estime qu’il est nécessaire de « poser la question du regroupement familial ».
Citons enfin Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française, qui sur une chaîne de télévision russe déclare que « beaucoup de ces Africains, je vous le dis, sont polygames. Dans un appartement, il y a trois ou quatre femmes et vingt-cinq enfants. Ils sont tellement bondés que ce ne sont plus des appartements, mais Dieu sait quoi ! On comprend pourquoi ces enfants courent dans les rues ».
Face à cet exercice difficile de la parentalité en exil qu’en est-il des soutiens dont peut bénéficier le migrant ? Du côté des associations de proximité qui jouent traditionnellement un rôle de décryptage, de sas permettant d’appréhender les enjeux, elles ont vu leurs marges d’action considérablement réduites. Le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) désormais généralisé et obligatoire a englobé toutes les ressources de l’ex-Fasild, du SSAE et autres financeurs associatifs. Aujourd’hui financer une action parentalité dans un centre social et culturel est devenu éminemment complexe. Or le CAI vise à permettre de connaître la langue, les valeurs et institutions de la République mais ne se préoccupe pas de la question de la parentalité.
Quant au sas que peuvent être les communautés, elles n’ont de cesse d’être stigmatisées. Le mot même de « communautarisme » est devenu péjoratif. Sans qu’on ne prenne jamais la peine de distinguer celles qui peuvent certes être enfermantes et celles qui peuvent permettre à ceux qui arrivent en France de se retrouver dans cet entre-deux tellement complexe.
Notes de bas de page
1 T. Pol.Bordeaux, 18 mars 1981, Tribunal correctionnel d’Orléans, 18 mai 2006.
2 Futuribles n° 305 – février 2005, « Vers la fin des fessées ? », Julien Damon.
3 Voir la décision de la Cour d’appel de Lyon qui, dans une décision du 20 janvier 2009, condamne même la CAF de Lyon à 1000 € de dommages et intérêt pour “résistance abusive” et à 1000 € au titre des frais. Voir également Cour d’appel de Toulouse du 25 septembre 2009 qui qualifie les pratiques de la CAF de discriminatoire et contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
4 La première jurisprudence est l’Arrêt « Époux Manent », Cour de cassation, 5 mai 1995.
5 L.513.1 du Code de la Sécurité sociale.
6 Par analogie on fera remarquer qu’alors que le couple est entendu depuis 1999 différemment, avec la reconnaissance du PACS et du concubinage, ces deux formes d’union n’existent pas en droit des étrangers. Ce n’est qu’à condition d’être marié –et non pas partenaire ou concubin- avec un français qu’un étranger pourra voir sa situation être régularisée.
7 Article 313.11 alinéa 6 du code des étrangers.
8 47 membres et une juridiction à Strasbourg : la Cour européenne des droits de l’homme.
9 Les lois de 2006 et 2007 ont durci les conditions de logement et de ressources. Elles ont par ailleurs prévu un test linguistique et sur les valeurs de la République depuis le pays et même une formation sur place en cas d’échec aux tests.