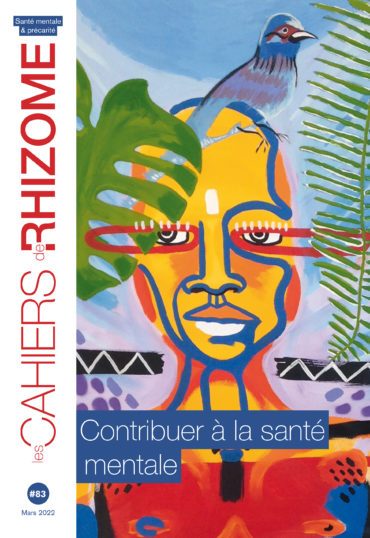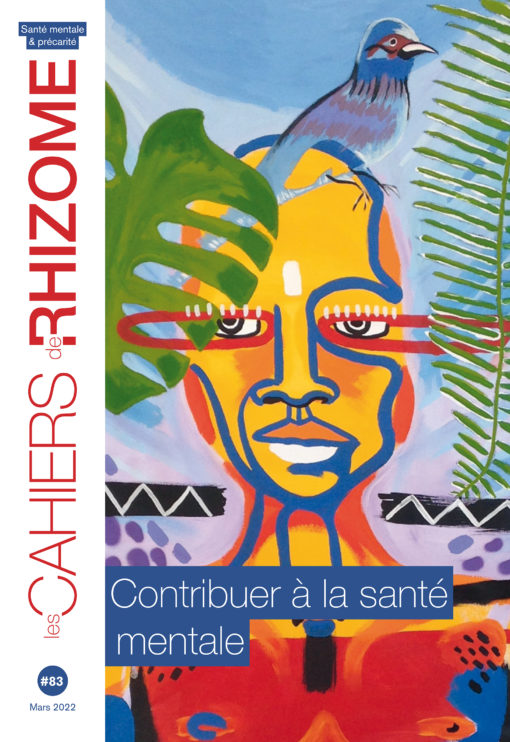En Guyane française, au bord du fleuve Maroni, se situe la ville de Maripasoula. Sa position géographique en fait un lieu isolé : pour la rejoindre depuis le littoral, il est nécessaire de prendre un avion ou une pirogue pour un voyage de deux jours lorsque les conditions sont bonnes. De l’autre côté du fleuve se trouve le Surinam, si proche que les Maripasouliens l’appellent « en face » et vont y faire leurs courses.
La population du Haut-Maroni, comme souvent en Guyane, se remarque par son multiculturalisme. L’histoire coloniale de ce territoire est inscrite dans les différentes communautés. Les Amérindiens, peuple autochtone, vivent entre eux dans des villages qui bordent les rives du Maroni, naviguant entre la France et le Surinam. Les Bushinenges, ou Noirs marrons, descendants d’esclaves enfuis dans la forêt, habitent en ville ou dans des villages en amont du fleuve. Les métropolitains, blancs, jeunes et instruits pour la grande majorité, occupent les postes de soignants, de professeurs et de gendarmes. De nombreux Brésiliens et Dominicains, souvent attirés par l’orpaillage illégal, s’ajoutent à ce mélange de langues et de croyances. Chacune de ces communautés porte son histoire, indissociable de celles des autres, et chacune exprime son mal-être à sa façon. L’alcoolisme transcende les cultures, engendrant une violence hétéro ou autoagressive.
Le centre médico-psychologique (CMP/CMPI) de Maripasoula est le seul centre de santé mentale sur cette partie du fleuve. Il prend en charge les habitants de la ville, mais aussi ceux des villages amérindiens et bushinenges voisins. Chez ces derniers, la souffrance psychique se manifeste essentiellement par des comportements addictifs et des phénomènes de crise de Baclou1, crises hystériformes collectives ayant lieu notamment dans les cours de récréation des collèges. Les Wayanas, Amérindiens du Haut-Maroni, sont tristement en prise avec la difficulté à s’adapter à la modernité, à la perte de leurs savoirs ancestraux et à l’empoisonnement de leur milieu naturel par l’orpaillage illégal. Ce dernier point est alarmant : un rapport datant de 2015 (Archimbaud, 2015), le dernier en date, décrit un taux de suicide chez les Amérindiens âgés de 15 à 25 ans supérieur de dix fois à celui de la métropole.
Face à ce drame de santé publique, l’agence régionale de santé de Guyane a financé en 2018 la création d’une équipe mobile de santé mentale au CMP/CMPI de Maripasoula. C’est dans ce contexte que nous avons tenté d’intervenir auprès des Wayanas en proie à ce phénomène massif de suicides. Nous tenterons, à travers cet écrit, d’élaborer autour de notre manière d’être présentes auprès de cette population et des questionnements qui nous ont traversés, tout en interrogeant le phénomène en lui-même.
Entre deux eaux : la psychiatrie à la rencontre des gens du fleuve
Les missions Fleuve de l’équipe mobile consistaient à se rendre dans les villages, à se présenter au capitaine ou chef coutumier2 et à recueillir les informations nécessaires : est-ce que certains jeunes semblent plus vulnérables ces derniers temps ? Est-ce que certains ont tenu des propos suicidaires ? Notre objectif était, au fur et à mesure des rencontres, de tisser – ou tresser, comme des feuilles de palmier pour la vannerie – un lien de confiance suffisamment bon pour que chacun puisse ensuite nous interpeller.
L’objectif de cette équipe mobile était double. Son rôle était de prévenir le suicide et d’être capable d’intervenir lors d’événements traumatiques (suicides aboutis, accident de pirogue…), à la façon d’une cellule d’urgence médico-psychologique3. Le projet était ainsi de proposer une offre de soins couvrant les trois temps de la crise : avant – par un rôle préventif –, pendant – au décours de la prise en charge, en urgence du traumatisme – et après – par la possibilité de suivis au centre médico-psychologique.
La prise en charge en santé mentale telle que nous la pensons et l’imaginons n’est pas encore développée sur ces territoires. Nous en sommes au stade de la rencontre, de la prévention. En même temps, ce pan de la prévention se mêle et s’entremêle parfois brutalement avec la prise en charge de la crise, dans l’urgence de la souffrance qui se manifeste par la tentative de suicide ou le suicide abouti.
Les missions Fleuve étaient comme des visites à domicile prolongées : après nous être présentées au capitaine, grâce à une médiatrice, nous entreprenions un tour du village afin de rencontrer chacun de ses habitants. Dans ce mouvement, comment aller vers cet autre qui vaque à ses occupations quotidiennes
et ne semble pas avoir de demandes ? Comment respecter son intimité sans faire intrusion ? Et surtout, qui a besoin de qui ? Quelles sont les attentes des Amérindiens du fleuve chez qui nous venions sans y être invités ? Cette pratique nous donnait parfois un sentiment de demande inversée où le soignant venait chercher le patient, là où il (en) était.
Dans les faits, nous passions parfois de longs moments à tisser du lien en épluchant du manioc avec une famille, ou en nous baignant dans le fleuve avec des enfants. Qu’espérions-nous faire ? Créer de la confiance, de la proximité, des liens pour ensuite les renforcer. Cette équipe mobile fondée sur l’aller vers, la disponibilité, l’informel, se résume au fait d’être avec, d’être présent, de faire avec. C’est l’avec, le lien, la disponibilité à la rencontre, qui décrivent la posture professionnelle que nous avons adoptée tout au long de ce travail. De cette manière, nous permettions à l’autre de nous repérer, d’accéder à nous, de questionner, d’échanger, le sensibilisant aux enjeux de santé mentale. Là où chacun répondait toujours que « tout va bien », et ce, même au lendemain d’une tentative de suicide, nous souhaitions être un destinataire pour leur souffrance. L’enjeu de dire, de rendre possible l’émergence de l’émotion, même de manière brute, est colossale. Car l’émotion qui n’est pas dite, la souffrance intériorisée, accroît la vulnérabilité psychique.
Écouter les amer-indiens4
La perception des suicides dans la parole amérindienne recouvre de la fatalité, de la résignation : « On sait que ça va recommencer », nous disent-ils. Dans ce « ça », nous entendons l’archaïque, impossible à penser, incapable d’être sublimé. Le terme « vague de suicides », utilisé par les professionnels du médico-social, illustre ce mouvement dans lequel se noie l’individualité. Ce drame humain est désigné comme une catastrophe naturelle, incontrôlable, où toute subjectivité semble gommée. Cela laisse l’impression qu’une malédiction sévit sur ce peuple, supprimant toute possibilité d’action. Cette croyance existe en effet chez les Wayanas. Les suicidants, lorsqu’ils survivent, expliquent avoir été appelés par un proche décédé, la plupart du temps lors de forte alcoolisation. Il est vertigineux de comprendre que chaque Amérindien a dans sa famille une personne qui s’est suicidée, créant des lignées de suicidants. Or chaque passage à l’acte augmente le risque suicidaire des autres membres du groupe, amenant une banalisation extrême de la mort. De tout son poids, le traumatisme est inscrit dans le transgénérationnel. Le suicide apparaît souvent, dans le discours des patients, comme la seule fin envisageable, l’évidence inévitable.
Face à ce tsunami mortifère, nous sommes tentés de questionner la responsabilité individuelle dans l’acte posé : quelle est la place du sujet dans ce déclin collectif ? Cette interrogation apparaît alors comme une transposition de notre pensée occidentale à un système au référentiel différent. Les fondements de l’identité Wayana reposent en effet sur le groupe, l’individu a peu de place pour émerger.
Cette dualité entre la pensée Wayana et la nôtre, occidentale, se retrouve dans la temporalité de nos interventions. Nous sommes animées par l’urgence face à la violence de la situation et du traumatisme, nous projetant dans un agir qui nous empêche parfois de penser. Nous sommes également pressées par notre institution qui réclame des résultats quantifiables, mesurables.
Par opposition, le temps amérindien est lent. Souvent, les patients ne viennent pas quand on les attend et viennent lorsqu’on ne les attend pas (ou plus). Dans une temporalité flottante, sur le fleuve on ne se donne pas rendez-vous à midi, mais plutôt après l’abbati5. Nous sommes alors nous-mêmes flottants, en latence, prêts à être saisis, utilisés au gré de cette temporalité si particulière, mais aussi de ces besoins ainsi que de leur manifestation si éphémère et fragile.
Nos venues sur les villages nous faisaient souvent vivre un sentiment de vide : le fait de n’être pas (ou plus ?) attendues, d’éprouver autant de difficultés à trouver la bonne manière de rentrer en lien et la faible file active sur les villages nous questionnaient. Nous étions paralysées par le vide. Un sentiment d’errance, un complexe de soignant qui ne peut être aidant, nous mettait à mal. En miroir avec les patients, nous vivions une errance identitaire qui empêchait la mise en sens de nos actions et du fondement même de notre rôle. Avec le recul, il nous apparaît flagrant que nous étions contaminées par la problématique désorganisante et douloureuse que nous tentions de prendre en charge : la souffrance identitaire, l’entre-deux, si inconfortable, que nous étions en train d’expérimenter à notre échelle, nous donnait une idée de celle de nos patients. En effet, « rien n’est plus angoissant dans les premiers temps que de se trouver brusquement projeté dans cette situation “sans-filet”, disons-nous souvent, c’est-à-dire sans nos protections habituelles qui peuvent être le divan du psychanalyste, une technique bien codifiée, ou la présence des murs de l’hôpital psychiatrique » (Vanel et Massoubre, 2011, p. 85).
Alors finalement, qu’avions-nous à apporter ? Étions-nous légitimes à être là ? Ces questionnements en amenaient d’autres, intrinsèques à notre présence en Guyane : devions-nous voir dans nos interventions la tentative de soigner – de sauver ? – ces peuples autochtones, comme un désir de réparation des souffrances causées par de lointains ancêtres ? Il y aurait alors une part de culpabilité dans l’agir de nos soins. En outre, notre accompagnement thérapeutique, basé sur des théories et des pratiques souvent occidentales, participerait-il au déracinement et à l’acculturation de ces peuples ?
Ces questions sont inhérentes au travail en interculturalité, qui peut accentuer la difficulté du positionnement et le vécu d’intrusion. Cette pratique inédite nous a amenés à repenser notre cadre d’intervention et notre manière d’être, d’aller vers, d’entrer en lien. Tout à coup, l’échange était possible, l’émotion pouvait parfois se dire, la réassurance se faire : le pouvoir de la relation thérapeutique se déployait et portait ses fruits, à la hauteur de la confiance que nous portait le patient. C’est en continuant de revenir sur les villages que nous avons pu tresser, maille après maille, le lien nécessaire à toute relation thérapeutique. En venant malgré le fait de n’être pas attendus. Pas même regardés parfois, tant cette communauté semblait déçue (autant que nous) de notre incapacité à leur proposer quelque chose qui soit adapté à leurs besoins, qu’elle-même ne parvenait pas à repérer.
Ainsi, éplucher du manioc sous un carbet ou se baigner dans le fleuve avec les enfants, est-ce cela la psychiatrie ? Comment faire comprendre à notre institution, lors de nos rapports de mission, que même sans avoir de résultats quantifiables, notre travail a du sens ?
L’équipe mobile à l’épreuve de la crise
Dans l’urgence de la crise, les enjeux étaient tout autres. Nous nous rappelons cette famille, si distante, qui venait de perdre un adolescent de 17 ans, suicidé par arme à feu. Nous étions arrivées sur le village alors que des violences intracommunautaires secouaient les habitants à la recherche d’un coupable. Pendant deux jours, nous avons été présentes pour la famille. Juste là, à côté, en retrait, laissant la médiatrice construire le lien dans ce chaos. Nous jouions avec une nièce traumatisée, devenue muette à la suite de ce suicide auquel elle avait assisté. Notre infirmière faisait quelques bandages sur les plaies de la mère. Ce lien fut très investi par la famille à l’issue de ces deux jours, parce que nous sommes restés. Parce que nous avons accepté le silence, le sentiment de vide, l’errance, accepté de ne pas être utilisés tout de suite. De ne pas être regardés tout de suite. Parce que nous étions là, sans condition, et sans attente.
Transformer le subir en agir
Nous nous sommes également interrogées sur les attentes des personnes auprès de qui il nous était demandé d’intervenir : avaient-elles une demande ? S’il en existait une, elle était en tout cas très éloignée de la demande institutionnelle. Elle était centrée sur notre temps de présence, jugé trop court, trop irrégulier et trop soumis aux imprévus et à un calendrier qui ne permettait pas de repérer nos venues. Dans un même temps, l’anticipation de celles-ci semblait résonner comme un non-sens dans la temporalité amérindienne, où tout se fait dans l’instant.
La demande institutionnelle était d’être sur tous les territoires à la fois, mais aussi de rendre compte de notre activité par des données statistiques. Nous nous retrouvions alors à côté de simples bonjours, formalisant ce qui se tissait dans l’informel. Prises dans ces attentes contradictoires, nous avons fait le choix, en nous raccrochant à notre rôle de soignantes, de nous en écarter pour repérer et interroger celles des communautés de l’intérieur.
Le lien avec les médiateurs fut précieux pour accéder aux attentes des personnes que nous rencontrions en permettant de matérialiser le tiers indispensable à la compréhension mutuelle. Venant ainsi incarner cet entre-deux mondes dans la relation thérapeutique, le médiateur se trouvait dans une position centrale à la jonction des deux référentiels culturels, permettant l’entrée en relation. Avec leur appui, nous renvoyions nos propres interrogations aux villageois, passant ainsi de « Qu’avons-nous à apporter ? » à « Que souhaitez-vous que l’on vous apporte ? », et mettant alors leur désir au centre de la prise en charge.
Nous aimons à penser que l’écart culturel, expérimenté à chacune de rencontres avec un amérindien, peut également servir d’appui dans la relation thérapeutique. La différence culturelle entre le soignant et le soigné autorise une expérience de l’altérité. Or ce fossé entre modernité et traditions, entre la génération des adolescents et celle de leurs parents est précisément le lieu où se creuse la souffrance. Les adolescentes notamment, savent très bien se saisir de cet écart, de cette différence des mondes et des codes, afin de laisser émerger leurs questionnements adolescents : parler de sexualité, aborder des tabous…
Quel avenir pour les Wayanas ?
Les métis identitaires « sont des sujets qui ont connu, au cours de leur existence, une expérience d’acculturation : soit du fait d’une migration intraculturelle ou interculturelle, soit du fait d’une mutation sociale, intellectuelle ou spirituelle. Les sujets concernés ont changé de milieu culturel, social ou spirituel (conversion religieuse, affiliation sectaire), par choix, par nécessité ou par contrainte » (Sironi, 2013, p. 30). Ainsi les Wayanas semblent en proie à ce processus de manière majorée avec l’influence de trois mondes culturels et sociaux qui se mêlent et se percutent parfois les uns aux autres : les traditions et croyances propres à leur culture d’origine, les attentes et le modernisme du monde occidental, et l’influence religieuse grandissante à travers l’évangélisme qui se déploie de manière exponentielle sur les villages amérindiens.
À partir de ces postulats, il devient nécessaire de se questionner sur l’essence de ce phénomène de suicides : est-il social, sociétal, psychiatrique ? L’imbrication de toutes ces dimensions rend sa prise en charge complexe lorsqu’elle est limitée (donc limitante) à une prise en charge psychiatrique. Les Amérindiens sont pris entre modernité et tradition, ils subissent une rupture familiale lors de l’entrée au collège, qui se fait loin du village d’origine. Le mal-être, à plusieurs étages, ancré profondément dans les générations, ne devrait-il pas être pris en charge à chacun de ces étages ? La communauté elle-même ne devrait-elle pas être au centre des actions afin de redonner le pouvoir d’agir à ce peuple et en valoriser les savoir-faire ? Les équipes formées en santé mentale pourraient alors intervenir en soutien et en impulsion de ce travail.
Nous aimerions conclure sur l’avenir incertain de la psychiatrie sur le Haut-Maroni, au vu des décisions récemment prises par l’institution qui en a la charge. En effet, il a été choisi de retirer les postes de psychologues et de revenir à des équipes mobiles venant ponctuellement depuis le littoral. Ce fonctionnement, ignorant les liens tissés avec la communauté, accentue une fois encore le vécu de rupture déploré tant par les partenaires du médico-social que par les patients. La brutalité de la fin de ce dispositif rejoue celle de la pathologie qu’il accompagnait.
L’espoir de renouveau à travers la créativité des soignants et le déploiement d’autres dispositifs doit cependant continuer de nous animer. Il s’agit d’accompagner cette communauté en souffrance, notamment avec les générations futures qui porteront dans leur histoire la souffrance de leurs aînés. L’enjeu semble, pour les Wayanas, de retrouver du désir, de la pulsion de vie.
Notes de bas de page
1 Le Baclou est un personnage de la culture noir-marron, un être de petite taille effrayant envoyé par des personnes qui souhaitent nuire à autrui, acquérir du pouvoir ou de la richesse. Le plus souvent, ce sont des adolescentes qui disent en voir apparaître un, ce qui les fait entrer dans une forme de transe ressemblant à une crise d’épilepsie, pouvant contaminer le reste du groupe.
2 Le chef coutumier est la personne porteuse de l’autorité au sein d’un village, reconnue comme telle pour l’État français.
3 Une cellule d’urgence médico-psychologique (Cump) est un dispositif de prise en charge thérapeutique du traumatisme en immédiat ou post-immédiat.
4 Ce terme est emprunté à l’ouvrage Les abandonnés de la République: vie et mort des Amérindiens de Guyane française (Mathieu, 2014).
5 L’abbati est un morceau de terrain sur lequel on abat puis brûle les arbres afin d’y faire pousser des arbres fruitiers, des plants de manioc…
Bibliographie
Archimbaud, A. et Chapdelaine, M. A. (2015). Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions pour enrayer ces drames et créer les conditions d’un mieux-être. Rapport établi par les Parlementaires en mission auprès de Madame la Ministre des Outre-mer.
Mathieur, A., Gruner, C. et Géry, Y. (2014). Les abandonnés de la République : vie et mort des Amérindiens de Guyane française. Albin Michel.
Sironi, F. (2013). Les métis culturels et identitaires. Un nouveau paradigme contemporain. L’Autre, 14(1), 30-42.
Vanel, A. et Massoubre, C. (2011). Expérience en équipe mobile de psychiatrie et précarité. L’information psychiatrique, 87(2), 83-88.