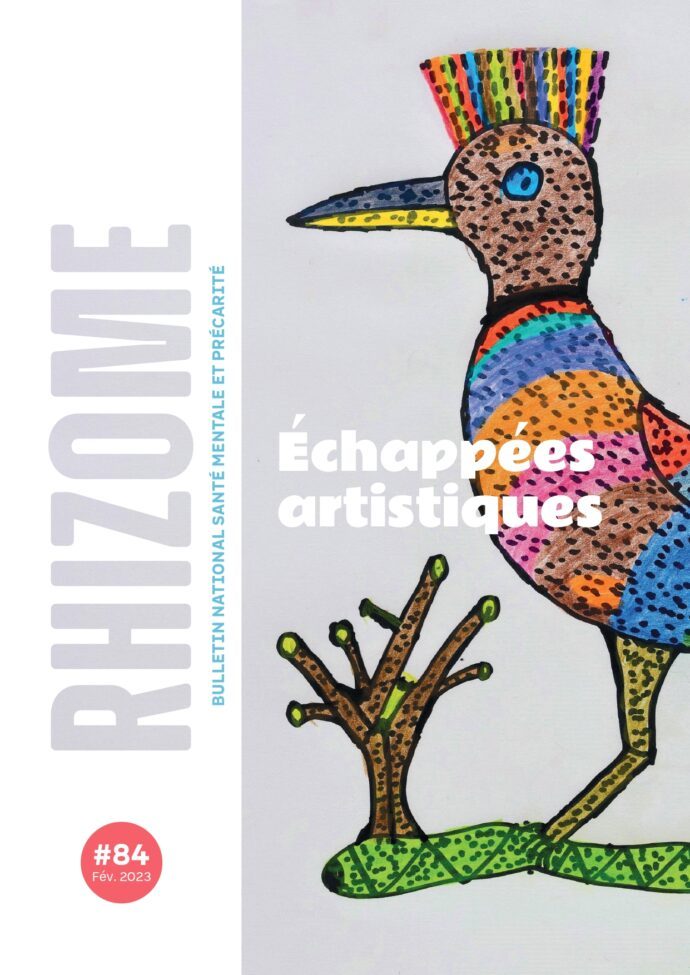Parler d’art et de soin, et les penser ensemble, serait-il obscène ? Comment, en effet, vouloir faire, sinon du beau, du moins de l’art, avec de l’effroyable, de la souffrance et de la maladie ? S’il y a une obscénité, c’est celle qui associe, en une alliance trouble et équivoque, le pathétique et le pathologique, le plaisir et la souffrance. Car il y a une dissonance entre la dimension pathétique de l’esthétique, avec son déferlement de sollicitations sensibles qui suspend l’action d’un côté, et, de l’autre, la dimension pathologique de l’humain écrasé par la maladie, sa souffrance et sa chronicité qui, elle, appelle l’action. Mais peut-être que les arts sont l’occasion pour les soignants de se redire que sous leur science et technique biomédicales se cache un art des égards qui prend soin ? Et suggérera-t-on que l’architecture hospitalière en témoigne ?
Cet art des égards n’est pas de l’art au sens des beaux- arts distinguant des pratiques spécifiées (peinture, sculpture, dessin…). Il pointe la disposition sous-jacente qui les soutient, à savoir une expérience esthétique, une épreuve sentie (pathique) du monde que l’artiste et le soignant auraient alors en partage. Elle serait une esthétique de la rencontre en amont du pathologique pour les soins ou du pathétique pour les arts. Nous plaiderons pour cette hypothèse. Ces questions, les soins dits «somatiques » les ont travaillées. Ils montrent, plus que l’analogie, la parenté profonde entre le geste de soin dans le tact et l’esthétique du tact en musique ou en sculpture, par exemple. Mais, plus particulièrement, c’est à eux que nous nous intéresserons, l’architecture et le design de l’espace les ont faits leurs. Dans cet esprit, le soin spatial ou un care architectural se concevront-ils comme cette forme d’attention à l’inframince (l’à peine perceptible qui représente une différence infime et singularisante)… qui ouvre à une transformation, à une extension de notre capacité à percevoir, par déblocage de toutes les identités, fixées, de toutes les répétitions qui enferment, qui enchaînent1 ?
Défaire l’hôpital pour faire hospitalité: la dialectique du sécurisé et du sécurisant
Dans le soin du monde, cultivant moins une culture de l’aménagement que du ménagement, l’architecture occupe une place singulière. Entre concept et conception, matérialisations de théories via le bâti, les établissements humains vivent d’une tension entre la norme et la forme. La norme tire du côté des contraintes de programmation qui s’imposent, extrêmement nombreuses, notamment concernant les enjeux sanitaires. La forme, de son côté, ouvre ce que la norme vient fermer, activant l’intention sensible qui les soutient, à savoir la visée de l’hospitalité. L’architecture hospitalière est travaillée et tend à rendre habitable cette tension, évitant l’excès de la norme invivable et le prestige de la forme inadaptée.
Rendre habitable cette tension vise à ne pas ignorer que les espaces-temps de la plainte que sont les hôpitaux, au sens large, auxquels répliquent les normes, sont aussi des espaces-temps où l’humanité tend à se déchiffrer, sachant la plainte et la souffrance. C’est ce que maintiennent, vibrantes, les formes.
Le défi des architectures hospitalières est bien là : soutenir, par la portance des lieux, la possibilité de la rencontre et une forme d’attention. Il s’agit, pour elles, de ne pas rajouter de la peine à la peine en renforçant, par la stigmatisation, l’enfermement, la mise à l’écart et l’éloignement ou, par une imagerie stéréotypée, les espaces-temps du travail de soin. Le défi est encore plus exigeant, si l’on veut faire de l’architecture un soin. Il s’agit d’une opération qui consiste à défaire l’hôpital de cette imagerie toute faite qui institue une manière de dévisager la maladie dans le malade, pour faire l’hospitalité.
On sait, on sent, très vite, trop vite qu’on est à l’hôpital. Le poids curatif de la machine à guérir impose ses normes et son souci de la maîtrise et du sécurisé. Cela concerne la taille et l’ouverture des fenêtres, l’exclusion des autres êtres vivants que les humains au nom de l’hygiène, le travail sur la lumière ou une forme d’esprit géométrique plaqué sur la vie hospitalière. Cet espace de soin qu’est l’hôpital est saturé de théories matérialisées, qu’il s’agisse de l’espace intime de la chambre (de la rampe d’oxygène au lit médicalisé) ou des espaces partagés (avec leurs clôtures de prévention des errances, des suicides ou des intrusions…). Ce faisant, il encourt le risque sinon de la stigmatisation, du moins de l’identification de ceux qui fréquentent ce lieu à la représentation que les imaginaires sociaux se font de ce qui s’y vit : le mourant en unité de soins palliatifs (USP), le dément ou le « légume » en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), le fou à l’asile, le cancéreux au pôle d’oncologie…
Aussi, porter une attention à l’architecture et au design, non seulement comme ce qui vient honorer le cahier des charges, souvent très lourd, d’un programme, s’envisage dans la façon d’installer un processus, de mettre du jeu dans les évidences. En résistant à la domination du programme pour laisser sa place à la possibilité d’une forme de contingence, de surprise, de jeu avec l’espace entendu dans sa dimension de jeu jouant (playing), l’architecture n’est plus seulement un décor, un cadre ou l’élaboration d’un local. Elle ouvre un espace en formation. Elle active un milieu par et avec lequel déployer des liens soutenants. Elle active de possibles suscitations. Elle fait exister des déplacements qui deviennent des chorégraphies, suscitant des troubles dans les évidences. Soudain, l’espace identifiable peut devenir invitation à un parcours de la reconnaissance mutuelle. Dans et par cette instabilité maintenue, un espace pour de possibles chorégraphies libératrices se déploie. Prenons des exemples. La façade de l’hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon défait l’hôpital pour qu’il devienne un bâtiment intriguant. « Où est-on ? » y redevient une question possible. La possibilité d’y entrer, avant le contrôle sécurité (du plan Vigipirate, de la Covid-19), par une galerie d’art fait du visiteur non plus un visiteur de malade, mais d’œuvres d’art, lavant son regard avant de rencontrer, comme une œuvre, le visage du malade. Travailler sur de grandes ouvertures pour voir la vie depuis son lit ou inventer des percées poétiques de vols d’oiseaux en inox sur les murs de l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier Le Vinatier (Lyon-Bron) convoque la rêverie de l’évasion et le droit de rêver comme un soin sécurisant, soutenant chacun dans sa consistance de sujet. De même, en design d’espace2, dans des unités de soins psychiatriques infantiles, remplacer les portes sécurisées avec leurs barreaux ou leur blindage par de grands ballons accueillant en leurs formes sphériques tout en permettant un contrôle visuel et la confrontation à des textures molles et résonantes prend soin du souci de «veiller sur » là où dominait un surveiller.
L’architecture : un art des égards au service d’un soin de l’attention
Une conception bien pauvre de l’art le pensera d’une indéfendable légèreté devant l’insoutenable pesanteur que la maladie et la souffrance apportent à l’existence humaine. Certes, l’art ouvre en imagination ce que la souffrance, dans la circularité de la plainte, vient clore. Mais si l’art, bien plus et davantage qu’un superficiel décor, s’envisageait comme un art des égards des établissements humains à l’attention de celui qui vient, précisément, s’établir et peut-être « se rétablir » ? Et si l’architecture, en travaillant à une esthétique de la rencontre, était justement le lieu de recueil et d’accueil du soin, ce qui contribuerait à être une des conditions du soin ?
Parce que la maladie affecte la possibilité de se tenir là, debout comme terrestre, altérant cette puissance d’agir qui se déploie dans nos déambulations spatiales, il importe de soutenir cette capacité spatiale. La psychiatrie a ceci de singulier que sa clinique (klinê) ne s’exerce pas au lit du malade, mais au cœur de la maladie, affectant une manière de se conduire/se tenir spatialement. La maladie abime l’être au monde, le dépeuplant. Le soin travaille à le rendre habitable pour et avec celui qui traverse un enduré de la maladie – et l’endurance, en ces matières, n’est pas secondaire. Il le tente par le langage, des théorisations de la maladie et des techniques de soin, mais aussi par des arts de l’espace qui sont des formes d’attention.
Il est assez commun, ça l’est même trop, d’envisager la place de l’architecture du point de vue des usagers non comme un soin, mais comme le décor du soin. Elle relèverait d’une dimension décorative, plaisante ou pittoresque, c’est-à-dire comme d’un arrière-plan sur le fond duquel le soin pourrait vraiment avoir lieu. Il est moins courant de l’envisager du point de vue des soignants, se demandant ce que l’art fait aux soignants et aux soignés dans le réveil, la révélation du soin comme arts des égards. Avec l’architecture, la question se déplace. Elle travaille des espaces-temps qui déploient non seulement
des contextes objectifs de soin désignés comme tels (l’hôpital, l’Ephad, l’USP…), mais aussi des « milieux » au sens de Kurt Goldstein. Envisager l’architecture comme une clinique des milieux permet que le sécurisant et le sécurisé s’y déploient comme une dialectique, et non une dichotomie. Le souci de sécuriser (via le discours de la commande et du cahier des charges) l’emporte trop souvent sur celui d’être sécurisant. L’architecture des espaces de soins, s’ils veulent être soignants, déplace la focale de la dimension décorative d’un beau lieu de soin vers la question du type de relations entre soignants et soignés – sur fond de milieu – qu’elle permet. En quel sens et comment l’architecture hospitalière permet-elle la rencontre sans laquelle le soin n’est plus, n’est pas possible, devient alors la question centrale.
Trois points d’attention peuvent ainsi être retenus :
a) Comment faire en sorte que soignants et soignés ne soient pas seulement convoqués une fois le projet architectural achevé, mobilisant moins le déploiement d’un programme que l’accompagnement d’un processus où la réception est une étape postérieure à sa création ou cocréation ?
b) En quel sens l’architecture peut-elle être un amplificateur des conditions de la rencontre de soin, permettant d’identifier les conditions d’une relation thérapeutique? Comment la dureté des matériaux et des structures sou- tient-elle, plutôt qu’elle n’inhibe, la durée vécue ? En quoi consiste la traversée, pour une histoire de vie, d’une chronique de la maladie longue ? Si l’espace hospitalier est investi par une rationalité instrumentale qui déploie une culture du programme et du protocole, il tend à être un espace très codifié, dominé par une intelligence spatiale laissant peu de chance à la surprise, irréductible, à la mauvaise surprise. Une poétique de l’espace peut, en installant de la contingence, travailler à une esthétique de la rencontre. Elle permettrait à des relations de se déployer, en tentant d’investir et de faire exister des espaces interstitiels. En effet, dans un espace maîtrisé/ métrisé, où toute mobilité est possiblement dévisagée comme un danger (risque de chute, crainte de l’errance pour le désorienté) et non envisagée comme une capacité, l’enjeu est d’autoriser la possibilité pour ceux qui vivent cet espace d’exprimer des stratégies spatiales. Il s’agit d’accompagner et de soutenir un style spatial leur permettant d’expérimenter leurs risques (s’autoriser à être assis par terre…) et, sans prétention ou parfois avec attention, de déployer leur capacité à ouvrir l’espace, à l’inaugurer en le chorégraphiant 3.
c) L’architecture, si elle est de l’espace où l’on chorégraphie la relation de soin, est aussi du temps. S’y questionne comment, au long des jours, s’apprivoise, s’approfondit la cohabitation et un temps traversés ensemble dans une dimension non seulement individualisée, mais individuante.
On peut donc, l’architecture en témoigne, concevoir des alternatives aux cultures de l’isolement en ayant, par une esthétique de l’attention, soutenu le sens soignant de l’apaisement.
Notes de bas de page
1 Davila, T. (2018). De l’inframince. Brève histoire de l’imperceptible de Marcel Duchamp à nos jours (p. 30-31). Éditions du regard.
2 Voir la séance du 17 juin 2021 du séminaire du Lab-ah «Violence et contrainte en psychiatrie – que peut le design ? ». Site du groupe hospitalier universitaire.
3 Voir le projet de Sophie Larger, artiste et designer, et de Vincent Lacoste, chorégraphe, organisant un bal en Ehpad, initiant par-là, un espace individuant. «Senior mobile-Espace de réappropriation par la danse» (Ehpad Alquier-Debrousse, Paris, novembre 2020).