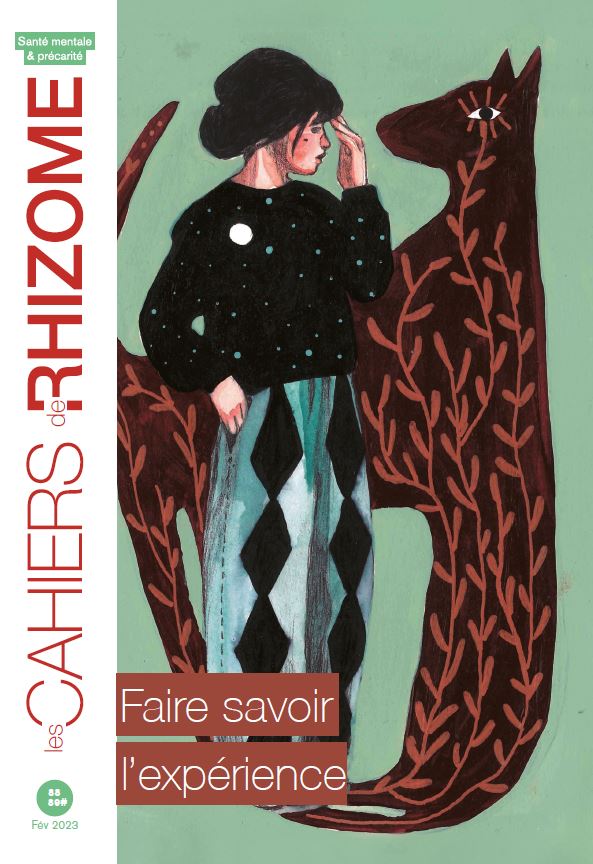À quoi pensez-vous lorsque vous lisez le mot « enfance » ? À sa magie ? Son innocence ? Pour moi, « enfance » a rimé avec « violence ».
Les morceaux d’un puzzle éclaté
Je suis tombée en dépression progressivement, après des années de lutte et des sortes de mini-effondrements – professionnels, relationnels et militants – qui sont arrivés les uns après les autres. J’ai alors dû commencer à faire face à mes ombres, à un passé que je pensais révolu, mais qui est revenu me hanter. Morceau par morceau, j’ai dû affronter un puzzle éclaté de mon histoire dans lequel les pièces s’emboîtaient petit à petit. C’est lors de ce processus intérieur de réunification que j’ai écrit, un soir, d’une seule traite, le texte « La violence ».
La violence
Selon les étiquettes sociales, je suis ce qu’on appelle « une enfant battue ». La violence s’est installée, sournoisement, au quotidien, dans une famille nombreuse, catholique, patriarcale. Trop d’enfants pour deux parents fragiles qui ont lui et elle-même connu la violence. Mère violentée sexuellement par l’un de ses frères pendant des années, dans le tabou des belles familles aristocrates. Père, fils de petit commerçant, élevé à la dure.
Le cycle de la violence qui s’installe. D’abord psychologique, par la faiblesse mais la force de la domination, l’emprise du patriarche craint par sa femme et ses enfants, surtout les filles. Puis les coups qui arrivent, on ne sait pas quand, comment, pourquoi. Parce que la journée a été longue et fatigante et qu’on est là au mauvais endroit, au mauvais moment.
Les cris, les gueulantes, les coups de fourchette sur les doigts pendant les repas, le silence imposé parce qu’on est enfant et que seuls les adultes ont le droit de parler.
Se réfugier dans le silence, les rêves.
Les brimades, les gifles, les fessées… Puis les coups de poing, les coups de pied… Les punitions injustes et terrorisantes, dans la cave, au pain sec et à l’eau, dans le noir total et la peur panique des rats… Et le reste… On serre les dents, on doit vivre, survivre. Et on doit surtout fermer sa gueule, ne pas montrer qu’on souffre, les frères et sœurs ne doivent pas savoir qu’on a été tabassé·e·s, ni les gens dehors.
Serrer les dents, oublier les coups, les bleus qui lancinent, ne pas montrer qu’on a peur, surtout, ne pas en parler… parce qu’on est coupable. Parce qu’on a été coupable, de parler, d’agir. Parce que le parent a toujours raison et l’enfant tort. Coupable de dire ce qu’il ne fallait pas dire, de faire ce qu’on ne devait pas faire.
La violence est insidieuse parce qu’elle est taboue. Elle ne dit pas son nom, elle enferme, terrorise, isole. La peur s’installe et ne part plus. L’arbitraire règne. Ce n’est pas une autorité juste, mais des coups de colère et de violence soudains, impulsés par l’émotion du moment, sans raison apparente.
Parce qu’un jour, descendre en pyjama à 11 heures est inacceptable, alors que d’autres fois non. Parce qu’avoir un caractère têtu, décidé et indépendant est un crime contre l’autorité patriarcale. Parce qu’il faut s’abaisser, s’écraser, la fermer. Pendant des années. Des années de silence, de terreur, de douleur.
Les années collège restent silencieuses et solitaires, dans la souffrance et l’isolement. Personne ne parle à une ado renfermée, mal dans sa peau, agressive dès qu’on lui adresse la parole. La distinction entre le bien et le mal, la justice, n’est pas acquise. C’est une construction sociale qu’on apprend avec l’éducation.
Des années de rêves, d’espoirs, d’envies d’évasion, mais de manque de force, de courage certain. Écrasée par un poids autoritariste et dominant qui a empêché la moindre construction d’une confiance en soi, qui limite toute prise de liberté. La peur et la souffrance au ventre. Peur d’aller au collège et d’être la souffre-douleur qui encaisse et ferme sa gueule, parce qu’elle a toujours appris à faire ça. Peur de rentrer à la maison et de subir l’humeur et la violence du patriarche.
Coincée dans une vie qui n’en est pas une.
14 ans. Quelques rencontres. Quelques amies. Quelques échanges. Je découvre que cette vie n’est pas celle de tout le monde. Ces mots qui ont mis des années à résonner : « Ce n’est pas normal ce que tu vis. » Des refuges après les coups, chez cette amie, voisine, qui depuis toujours m’ouvre ses bras, m’apporte l’amour dont j’ai tellement manqué, une écoute… Et cette révolte qui naît et ne dit pas encore son nom.
16 ans. Cette année fatidique où j’ai cru que mon père allait tuer ma mère. Elle hurlait dans la maison, de manière indécente. Alors même que la violence doit se taire, s’encaisser, s’assumer, seul·e. Ma mère qui a du mal à marcher le lendemain, cassée par les coups de poing, de pied, du fer à repasser qui lui est tombé dessus… Ma mère qui brise ce tabou une première et unique fois et nous dit à table – un midi, alors que mon père n’est pas là – qu’elle aurait aimé qu’on réagisse, qu’on appelle les voisin·e·s, qu’elle a cru mourir cette fois. Incompréhension, choc. Des mots sur la violence.
Je lui fais la gueule à mon père le lendemain. Comme d’habitude. Quelques jours. Alors que le pic de violence laisse place à la lune de miel : la gentillesse incarnée, les attentions, la douceur dans les mots, le regard. C’est ce qu’il y a de pire dans le cycle de la violence familiale. Ce ne serait qu’un bourreau, ce serait tellement facile à détecter, pointer du doigt, et accuser, détester. Mais, après le pic de violence vient la douceur, la tendresse. On culpabilise d’être sur la défensive, à se protéger, alors que lui est tellement gentil. On se détend, on ouvre son cœur et ça recommence. Continuellement. Et c’est ainsi que l’amour tue. L’amour lie et détruit. Parce que la violence revient, toujours.
Cette fois, je commence à comprendre que ce n’est pas normal, qu’il y a un vrai danger. Je fais la gueule, plus durablement. Qu’on me touche, je m’en fous, ce n’est pas pareil, mais ma mère qui appelle à l’aide… Et puis une semaine après, c’est mon tour, écrasée derrière ma porte de chambre que j’essayais de maintenir fermée, parce que je l’entendais monter, en colère. La terreur, la panique, parce que je sais ce qui va tomber. Et la pluie de coups de poing, de coups de pied. Comme d’habitude, je me réfugie en boule sur le sol, pleure et supplie en même temps, « Arrête papa, arrête. » Je suis recroquevillée, j’attends que sa colère passe, j’ai mal, je serre les dents. J’ai 16 ans, mais j’ai l’impression d’en avoir 6. Il finit par partir. Je rampe jusqu’à mon lit et comme d’habitude m’effondre en mordant l’oreiller. Et puis j’en ai marre. Je ressens cette colère incroyable et cet espoir qui me tient de- puis des années. L’espoir. Une certitude venue d’on ne sait où ; que ce ne peut être ma vie toute ma vie. Que je ne peux pas mourir avant d’avoir été heureuse, avant d’avoir vécu. Je pars me réfugier chez mon amie qui me dit comme d’habitude que ce n’est pas normal. Cette fois je l’entends. Ça a été trop loin. Je ne veux pas qu’il continue à nous toucher et nous tuer à petit feu, mes frères, ma mère et moi… Je veux vivre, moi, pas survivre !
Aide sociale à l’enfance, discussion avec une psy, une avocate, une éducatrice spécialisée… Le privé est politique, je le découvre, non sans violence. C’est dur de devoir faire face. Tellement dur. Et pourtant j’apprends. Je comprends. Que je ne suis pas coupable. Qu’il est coupable. C’est énorme tout ça. On ne dirait pas, seules les personnes qui l’ont vécu peuvent comprendre. On sort d’un mensonge de 16 ans. D’une réalité qui n’est que mensonge, faux, violence. On met en lumière ce qui ne devrait jamais l’être, c’est d’une douleur et d’une libération la plus totale. Je suis seule mais puissante, pour la première fois de ma vie.
17 ans. Je quitte la maison, je pars en internat. Je découvre les relations humaines, le partage, les confidences, l’amitié, l’amour… La sécurité, au moins extérieure. D’autres mondes, réalités. Un accouchement. On m’appelle Kriska, je nais, j’ai 17 ans. Je découvre la vie, et la puissance de la liberté !
La quête de compréhension
Lorsque j’ai redécouvert ce texte, des années plus tard, avec toutes les connaissances accumulées depuis sur les violences faites aux enfants, j’ai réalisé que tout était là : la reproduction intergénérationnelle de la violence, le conflit de loyauté, l’adultisme1, le cycle des violences intrafamiliales, la confusion entre amour et violence, les conséquences sur la construction de la structure psychique… Le savoir chez moi était empirique avant d’être théorique. Cette expérience m’a fait développer une sensibilité particulièrement exacerbée sur le sujet.
Pendant six longues années de dépression, j’ai continué à chercher, à donner un sens à mes souffrances, à tout prix. Le plus grand moteur du savoir expérientiel, c’est sans doute celui-là. L’insoutenabilité du mal-être conduit à de multiples stratégies de contournement, mais aussi à des quêtes de compréhension. Ma conscience s’est développée en même temps que mon cheminement thérapeutique. La théorie est venue appuyer mes prises de conscience, mais l’essentiel était déjà là. C’est le vécu dans le corps qui m’a donné des clefs. C’est l’expérience qui a ouvert cet espace de conscience pour ensuite rencontrer dans mes lectures Alice Miller (1983), psychanalyste et docteure en philosophie, Cyrinne Ben Mamou (2023), docteure en neurosciences, Dorothée Dussy (2013), anthropologue, et Muriel Salmona (2012), psychiatre. Autant d’inspirations qui m’ont nourrie parce qu’elles venaient résonner profondément en moi. D’ailleurs, ces femmes, avant d’être des expertes sur les violences et les traumatismes, les ont vécus dans leur chair. Leur œuvre est fondée sur leur savoir expérientiel.
La quête de guérison
Ma quête de guérison m’a amenée à rencontrer la théorie polyvagale (TPV) et l’intelligence relationnelle (IR)2. Des thérapies par la parole sont nécessaires pour les prises de conscience, mais des thérapies psychocorporelles sont indispensables pour la guérison des traumatismes dans le corps. Quel espoir, enfin. D’association en association, nous observons la rémission de la dissociation… Au fur et à mesure des séances d’IR, je sentais physiologiquement mon cerveau se réparer. C’est étrange à dire, j’avais le sentiment que plus j’avançais, plus mon intelligence se développait. En réalité, mon système nerveux se régulait et j’avais davantage accès à mon néocortex frontal, siège de la conscience. Il me semblait atterrir, gagner en sécurité intérieure. Puis, les dérégulations sont revenues avec force. Je ne savais pas ce qui m’arrivait. Je n’ai compris qu’ensuite ce que la restructuration de mon psychisme provoquait : un terreau suffisamment solide pour qu’un passé refoulé surgisse. C’est ainsi que la mémoire traumatique a commencé à émerger sous la forme d’émotions refoulées se traduisant par d’intenses colères injustifiées et de la détresse. Puis j’ai commencé à avoir des flash-back d’une scène traumatique. Ces images apparaissaient pendant des séances de thérapie ou lorsque j’étais au calme. C’était comme des bulles de mémoire qui trouvaient enfin un passage pour remonter à la surface. L’une après l’autre. D’abord, cet homme qui m’emmène par la main. Puis les attouchements. Le viol. La terreur et l’anéantissement qui vont avec. Ce n’est qu’au bout d’un mois que j’ai su que c’était mon père. Plusieurs fois l’intuition m’a traversée, mais ma conscience la balayait. Puis, l’image s’est imposée, de plus en plus. Jusqu’au moment où il n’y avait plus de doutes. C’était lui. L’horreur la plus totale. Les sensations n’arrêtaient pas de remonter. Je le sentais collé à moi, son poids, la chaleur de son ventre. Je me souviens faire des gestes répétitifs comme pour le décoller de ma peau. Passé et présent mêlés dans un tourment insupportable. J’ai cru cette fois que je n’y survivrai pas. Et pourtant si. Les sensations, une fois toutes ressenties, se sont atténuées puis ont disparu. Le travail thérapeutique, le sport, le yoga et l’écriture m’ont permis de revenir dans le présent, d’intégrer cette mémoire traumatique et de la remettre à sa place, dans le passé.
La part des autres
Pourquoi la mémoire traumatique est revenue si tard ? Pendant dix ans, lorsque je partageais mes questionnements sur une éventuelle agression sexuelle à des soignant·e·s, les réactions étaient soit du déni, soit une réponse médicamenteuse. Personne n’a jamais interrogé mes doutes. Le passé appartenait au passé et l’important était d’envisager la suite. Vivre avec. Mais comment se construit- on lorsque les fondations sont pourries ? Avec des traitements qui contiennent et étouffent les émotions et le passé ? Et si le passé avait justement besoin de ressurgir et d’être accueilli pour être guéri ? Après de nombreuses années, une seule personne, victimologue, m’a demandé pourquoi j’avais ces doutes. J’ai partagé une longue liste : l’énurésie nocturne jusqu’à mes 15 ans ; mon premier copain – sa langue dans ma bouche et mon envie de mourir ; le dégoût et la honte dans ma sexualité ; mes relations déstructurées aux hommes ; les cauchemars à répétition avec des scènes de tortures et de violences sexuelles – ces mêmes images de violences que j’avais besoin de ressasser le soir pour arriver à m’endormir ; les angoisses sourdes qui arrivent par intermittence, sans raison apparente ; l’absence de souvenirs de mon enfance ; ma réaction émotionnelle disproportionnée lorsque j’ai vu la formidable pièce de théâtre d’Andréa Bescond (2014) sur la pédocriminalité et que je n’arrêtais pas de sangloter… Il a écouté puis il m’a répondu : « Oui, c’est tout à fait possible, vous avez tous les symptômes. Mais on ne peut pas l’affirmer ou l’infirmer. Si vous avez été victime de violences sexuelles, vous le saurez quand vous aurez suffisamment de sécurité intérieure pour que se lève l’amnésie traumatique. » Enfin, quelqu’un ouvrait une porte que jusque-là tou·te·s les soignant·e·s tenaient fermée. Quel soulagement.
C’est si important de sortir du déni face à la terrible réalité de l’ampleur des violences sexuelles, de croire les victimes et de ne pas remettre en question leur parole. Le déni empêche la résurgence des mémoires traumatiques parce qu’il maintient les personnes concernées dans un état de survie insupportable ; parce qu’il participe au tabou. Quelques fois, le doute est revenu. Est-ce que c’est bien réel ? Ai-je vraiment vécu tout cela ? Les remises en question de quelques proches me contaminaient et me faisaient douter de moi. Pourtant, les émotions, les sensations, les images… tout cela ne s’invente pas. D’ailleurs, quelques mois après la résurgence de la mémoire traumatique, un membre de ma famille a témoigné avoir vu mon père « jouer au papa et à la maman » avec moi quand j’avais 4 ans. Enfin, une preuve de l’extérieur est venue valider mes ressentis et leur donner une légitimité. Je pense à toutes les victimes qui n’ont pas la « chance » d’avoir de témoins. C’est là que j’ai pris conscience aussi que la levée de l’amnésie n’était pas complète car je ne me souvenais que d’un épisode. Aujourd’hui, je sais qu’il y a eu d’autres attouchements. Des mémoires enfouies remontent encore parfois. Il faudra sûrement encore du temps pour que tout émerge et peut-être que certaines mémoires n’émergeront jamais. Il me reste encore ce besoin viscéral de vérité et de clarté, mais peut-être que cela va finir par s’apaiser.
Politiser l’expérience
La mise en lumière de ma propre histoire m’a amenée vers une conscience collective de l’ampleur des violences faites aux enfants. En 2018, j’ai écrit et produit une conférence gesticulée sur les violences intrafamiliales et leurs conséquences psychotraumatiques (Kriska, 2018). Cet exercice m’a permis de passer d’une expérience individuelle à la compréhension d’enjeux sociétaux, et notamment des rapports de domination qui structurent notre société, tels que le sexisme, le classisme, le racisme et l’adultisme. Donner une dimension politique à ce savoir expérientiel a été un véritable processus d’empowerment individuel et collectif. Suite à cette représentation, j’ai reçu de nombreux témoignages de personnes touchées par la résonance avec leur propre vécu. Lorsque l’identification réciproque opère, elle révèle des savoirs explicites communs, appelés « savoirs situés ». Ils se constituent en faisant émerger ce qu’il y a de général, au-delà des expériences subjectives individuelles. Les savoirs situés viennent compléter et parfois s’opposer aux savoirs savants. Ils incitent à dépasser les présupposés et à approfondir les réflexions.
Le drame de la dissociation
c’est cette séparation entre qui l’on est et ce que l’on donne à voir
Cet incommensurable besoin d’être vu·e et cette incapacité à être nu·e
Ce qui hurle à l’intérieur et la tranquillité extérieure
L’apparence légère et vivante et la mort attenante
La honte et la culpabilité à être qui l’on est
Un puits sans fond dans un tiroir qui aspire la vie,
comme un trou noir
Le drame de la dissociation c’est qu’elle peut durer toute une vie
Sans jamais connaître l’association qui fait sortir de la survie
Le drame de la dissociation c’est qu’elle se transmet
de génération en génération
tant qu’elle n’est pas conscientisée Le drame de la dissociation
c’est la dédramatisation L’espoir dans la dissociation c’est l’association
Et quel beau cadeau d’œuvrer à se réassocier
Pour pouvoir enfin accompagner d’autres personnes concernées
à revenir à la vie dans ce qu’elle a de plus beau
ACK
Notes de bas de page
1 Soit le rapport de domination des adultes sur les enfants.
2 La théorie polyvagale (TPV) a été théorisée par Stephen Porges, professeur de psychiatrie, puis vulgarisée et mise en application clinique par Deborah Dana, psychothérapeute. Celle-ci a inspiré François le Doze, neurologue, qui a alors développé l’intelligence relationnelle (IR). L’IR est un modèle psychothérapeutique neurobiologique qui s’appuie sur la plasticité du cerveau. L’idée principale est de venir réguler le système nerveux autonome. La théorie de l’attachement donne un socle pour installer une sécurité relationnelle, préalable indispensable au travail sur les traumatismes. L’IR s’appuie également sur le formidable travail de Bessel van der Kolk, psychiatre, publié dans son livre Le corps n’oublie rien (2020). Il y explique notamment à quel point le traumatisme est physiologique.
Bibliographie
Ben Mamou, C. (2023). Accueil. Cyrinne.com.
Bescond, A. (2014). Les chatouilles ou la danse de la colère [pièce de théâtre].
Dussy, D. (2013). Le berceau des dominations. La Discussion.
Miller, A. (1984). C’est pour ton bien. Racines de la violence dans l’éducation de l’enfant. Éditions Aubier.
Kriska, A.-C. (2018). Conférence sur les violences intrafamiliales et les conséquences psychotraumatiques [vidéo].YouTube.
Salmona, M. (2022). Le livre noir des violences sexuelles. Dunod.
Van der Kolk, B. (2020). Le corps n’oublie rien. Albin Michel.