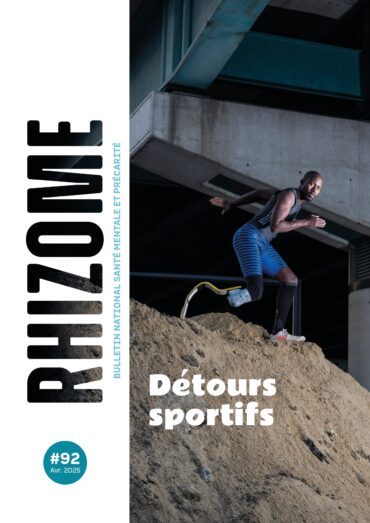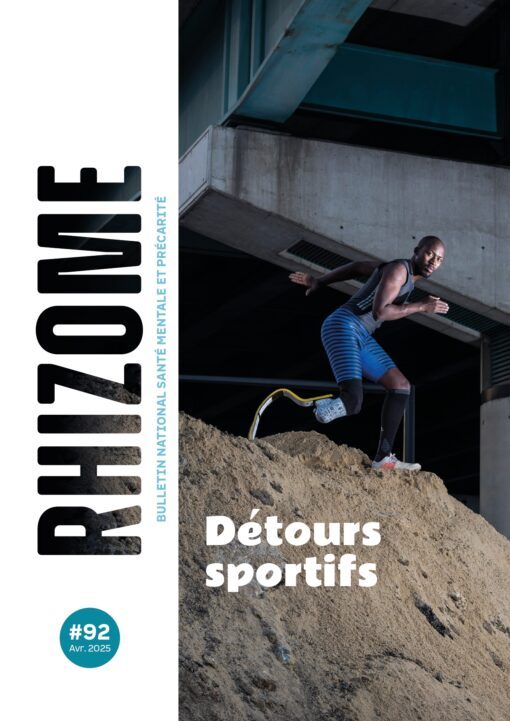Lancées en 2019, les maisons sport santé (MSS) proposent à des personnes vivant avec une maladie chronique, ou ayant un risque fort d’en développer, adressées par un professionnel de santé, un parcours d’accompagnement et d’orientation vers l’activité physique adaptée. Celle-ci est reconnue comme une thérapeutique avec une efficacité qui peut être équivalente, voire supérieure à celle des médicaments1. Plus de 550 MSS existent actuellement en France. Le dispositif permet d’orienter les personnes vers des séances d’activité adaptées à leurs besoins. L’accent est mis sur l’accompagnement avec des rendez-vous réguliers ainsi qu’un enseignant en activité physique adaptée qui évalue les capacités physiques et accompagne l’engagement dans le parcours de transformation des habitudes de mobilité. La ville de Paris a fait le choix d’implanter des MSS publiques dans les quartiers populaires afin de répondre aux besoins des personnes qui sont le plus touchées par les maladies chroniques et pour qui l’offre sportive est la moins accessible. Aujourd’hui, environ 1 300 Parisiennes et Parisiens sont suivis. Le public est majoritairement constitué de femmes de plus de 50 ans, mais se diversifie progressivement. Deux MSS fonctionnent dans les 15e et 19e arrondissements, deux autres ouvriront dans le courant de l’année 2025. La proposition municipale se distingue des autres offres parisiennes par le fait qu’elle est hors les murs de l’hôpital et qu’elle propose un suivi et des activités gratuites ou à faible coût.
Le modèle parisien repose également sur une fonction accueil constitutive du parcours : l’espace est aménagé pour que les usagers puissent s’installer confortable- ment, et ils sont accompagnés selon leur degré d’autonomie dans le renseignement des formulaires d’entrée. De plus, les bilans initiaux durent deux heures : des tests d’aptitude sont réalisés, puis détaillés avec les usagers. Beaucoup ont tendance à sous-estimer leurs capacités. Ce premier retour est un moment important pour commencer à leur proposer une autre image d’eux- mêmes. Après deux ans d’expérience, les agents qui travaillent dans les MSS sont marqués par la diversité des bénéfices pour les personnes suivies. Adèle Ronné, enseignante en activité physique adaptée à la MSS Lefebvre, a pris l’habitude de noter les verbatim des retours des personnes suivies. D’une part, évidemment, l’amélioration de la condition physique est soulignée dans de nombreux témoignages : « Grâce à l’activité physique, ma douleur à l’orteil a diminué et j’ai perdu du poids. Mon cardio s’est amélioré, le renforcement musculaire m’aide beaucoup aussi, j’ai gagné en équilibre, je marche mieux dans la rue et je me sens mieux ! » Nombre de ces personnes relatent une reprise de confiance dans leur propre corps, que la maladie avait entamée : « Je me sens beaucoup mieux, parce qu’après un infarctus on a très peur de bouger », « Je n’osais plus utiliser mon bras et maintenant je suis rassurée. » D’autre part, en pariant sur l’accompagnement et l’orientation qui offre l’opportunité d’explorer de nouveaux lieux, de nombreuses personnes partagent une amélioration de leur moral – « la remise en forme la semaine dernière m’a redonné psychologiquement beaucoup de vitalité » – et la construction de nouveaux liens sociaux – « [à propos d’une personne rencontrée au cours de gym douce] On se quitte plus, c’est devenu ma meilleure amie. » La solitude et l’isolement, liés à la maladie chronique comme au manque de moyens financiers, sont évoqués par la grande majorité des personnes qui se présentent dans les MSS. En ne renvoyant ni à l’univers du guichet social ni à celui du soin ou de la prise en charge psychologique, les MSS peuvent apporter des réponses à ces demandes qui ne sont pas exprimées en première intention. La construction de propositions diversifiées, allant du groupe de marche ou d’ateliers cuisine, dans un esprit proche de celui de la santé communautaire, cherche à amplifier ces dynamiques sociales. Néanmoins, pour ces publics éloignés de l’activité qui ont souvent des difficultés économiques et sociales, le lien est fragile : une première séance qui se passe mal, un changement d’éducateur sportif ou des aléas personnels sont susceptibles de briser le lien construit. C’est dans ces moments que la secrétaire médico-sociale en charge de l’accueil et la médiatrice en santé interviennent pour relancer, comprendre les causes de l’absence, retisser le lien et adapter le parcours.
Malgré l’engagement de certaines collectivités locales comme Paris, le modèle des MSS publiques offrant un service gratuit ou très accessible reste précaire, alors que le « sport sur ordonnance » n’est pris en charge que pour les personnes qui ont les contrats de mutuelle les plus protecteurs, excluant de fait les plus modestes. Les MSS sont à contre-courant de la fascination pour les dispositifs de prévention et de lutte contre la sédentarité centrés sur le numérique. Les « externalités positives » de ce service en matière de santé mentale et de sociabilité, constatées par les professionnelles, ne sont à ce jour ni mesurées ni reconnues. Les retours de terrain sont pourtant prometteurs.
Notes de bas de page
1 Pour une mise au point : Carré, F. et Grémy, I. (2021). Activité physique et maladie chronique : de quoi parle-t-on ? Actualité et dossier en santé publique, 114.