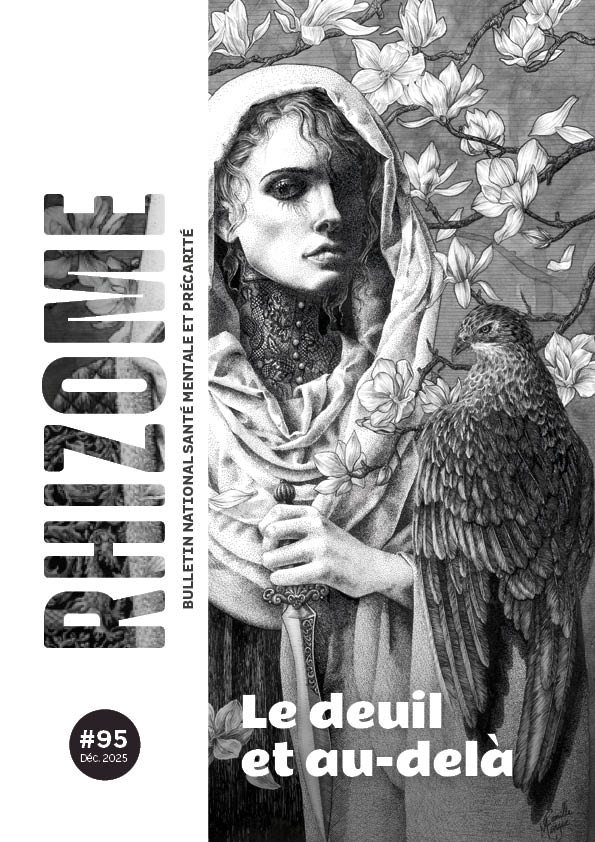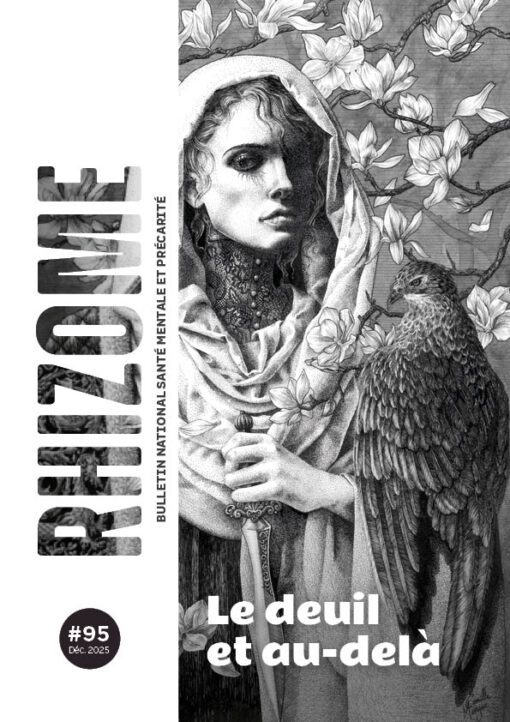Elle est partie mais elle est là. Sa présence se diffuse dans la douleur comme dans la joie. Larmes et souvenirs, images et voix : tout s’entrelace. L’expérience du deuil déchire autant qu’elle cicatrise. Elle détruit un monde connu et en révèle un autre. Le deuil arrache autant qu’il relie : aux autres, à soi, à l’absence. L’abîme vide. Le vide abime. Vicieux le cercle.
Chacune et chacun connaît ces présences dont l’absence hante. Certains parlent de fantômes, d’un passé qu’il faudrait oublier, dépasser. Que faudrait-il comprendre ? Avaler la mort, la digérer peut-être. La douleur cisaille, entaille, creuse l’entraille. Ce qu’il reste, un geste, un amour, un cri, du punk morbide : À mort la mort !
Ce Rhizome explore, sonde le deuil et au-delà. Ce qui reste, ce qui insiste, ce qui relie. Deuiller1 transforme. La puissance du deuil transperce, traverse, déborde et appelle, collectivement, à faire place à ce qui disparaît, ce qui demeure. Fidèle à la ligne éditoriale de la revue, ce numéro refuse de réduire les questions de précarité et de santé mentale à des catégories de publics pour penser les enjeux relationnels, cliniques, sociaux et profondément politiques. Il provoque les frontières entre métiers, champs, cultures et mondes.
Le deuil et ses langues
Plusieurs articles mettent en intrigue une question récurrente : qu’est-ce qui relève du psychique, du normal, du pathologique, du soin ou du social ? Le numéro s’ouvre sur une analyse de la psychiatrisation du deuil, de son inscription dans les nomenclatures et les protocoles thérapeutiques, mais aussi de ses promesses de soulagement. On voit comment les discours psychiatriques et psychologiques s’emparent d’une expérience universelle pour la traiter. La perspective clinique nous rappelle quelque chose d’essentiel : penser le deuil, c’est penser le sujet sans le réduire à des symptômes. Elle nous dit aussi le besoin de temps, de répit.
Modernité et colonialité ont pourtant mis à distance les morts, les ont relégués aux marges de nos mondes. Elles ont déplacé la mort hors du commun, du quotidien, des vivants. La médicalisation de la fin de vie et la psychologisation du deuil ont transformé les rituels collectifs en les déplaçant vers des espaces institutionnels où les émotions sont régulées et encadrées. Toutefois, le deuil est aussi une langue, une écriture : une manière de témoigner, de réparer, de relier. Il peut même devenir une langue commune entre des mondes, des expériences et des cultures.
Le deuil et ses mondes
La mort affecte, parle et met à l’épreuve les institutions, les équipes, les métiers. Elle vient parfois comme un échec dans la culture biomédicale, générant malaise et souffrance chez les professionnels. La mort nous confronte à la fois à notre fragilité et à notre finitude.
Plusieurs articles en appellent à une anthropologie du deuil située, plurielle et relationnelle, et invitent à reconnaître sa dimension sociale et communautaire. Une affaire sociale, en somme, une affaire de travail social. Le deuil demande de l’accompagnement, du lien, des rituels, des espaces où déposer ce qui déborde. Ces contributions plaident pour une écologie du (prendre) soin. Le deuil s’accompagne, se travaille, se pense. Il demande un espace symbolique à habiter ensemble.
Le deuil précaire
Les inégalités sociales, la précarité, l’isolement transforment l’expérience du deuil et rendent son accompagnement plus difficile. Certaines morts, dans les mondes de la précarité, sont brutales, violentes, traumatiques : décès à la rue, overdoses, morts sans corps, suicides… Des morts sans rites, sans adieu, sans paroles. Des morts administrées. Des morts que personne n’attendait mais que beaucoup redoutaient.
Les personnes précarisées sont souvent exclues des lieux où s’élaborent la perte et la mémoire. Comment se donner, et donner, les moyens de faire son deuil quand tout manque déjà : l’espace, le temps, les ressources, les proches, la reconnaissance ? Dans la continuité du numéro de Rhizome « Ces morts qui existent2 », l’importance de rendre visibles des morts invisibles est encore ici présente. On y lit la possibilité d’une politique du deuil : faire place à celle et ceux qu’on ne voit pas, à leurs morts comme à leurs mots. Reconnaître ce qui est en train de disparaître, d’être transformé, en nous et autour de nous.
Deuiller les survivances
Deuiller les survivances, comme une tension sémantique entre perte et persistance. Les survivances sont alors des traces, des empreintes : des gestes, des voix, des habitudes, des manières d’être ou de sentir qui continuent de vivre alors que la personne n’est plus là.
Ces survivances peuvent aussi dire quelque chose de nos mondes. C’est ce qu’il faudrait résister à effacer : certains morts pèsent plus lourd parce que certains vivants comptent moins. Des vies précaires, qu’on déplace, qu’on expulse et les morts qu’on ne sait pas accueillir. La colère, la tristesse ou la tendresse refusent de disparaître avec celles et ceux qu’on a laissés aux marges. Pour finir, la mort est précieuse car elle nous rappelle à la vie. Elle fait mémoire. Elle relie. Souvenir de l’avenir : rétablir les personnes vivantes et les mortes ; continuer à faire monde avec elles. Parce que deuiller, c’est vivre. Autrement, ailleurs, avec.
Notes de bas de page
1 Bigé, (2023). Deuiller au travers. Pertes et affects trans*espèces. Trou noir, 15, 127-144. Inspirée notamment par les pratiques collectives décrites par Léa Rivière, elle définit « deuiller » comme un art relationnel et partagé, une manière d’accueillir les transformations du monde sans fétichiser les morts, humaines ou non humaines.
2 Ces morts qui (2017). Rhizome, 64.