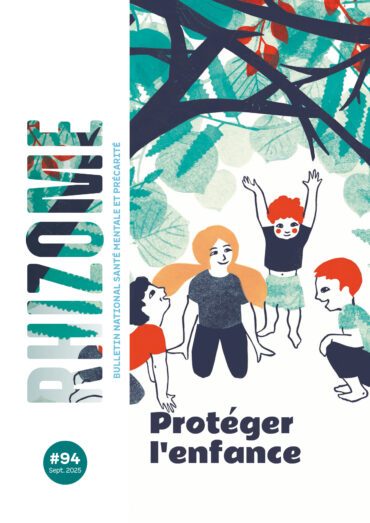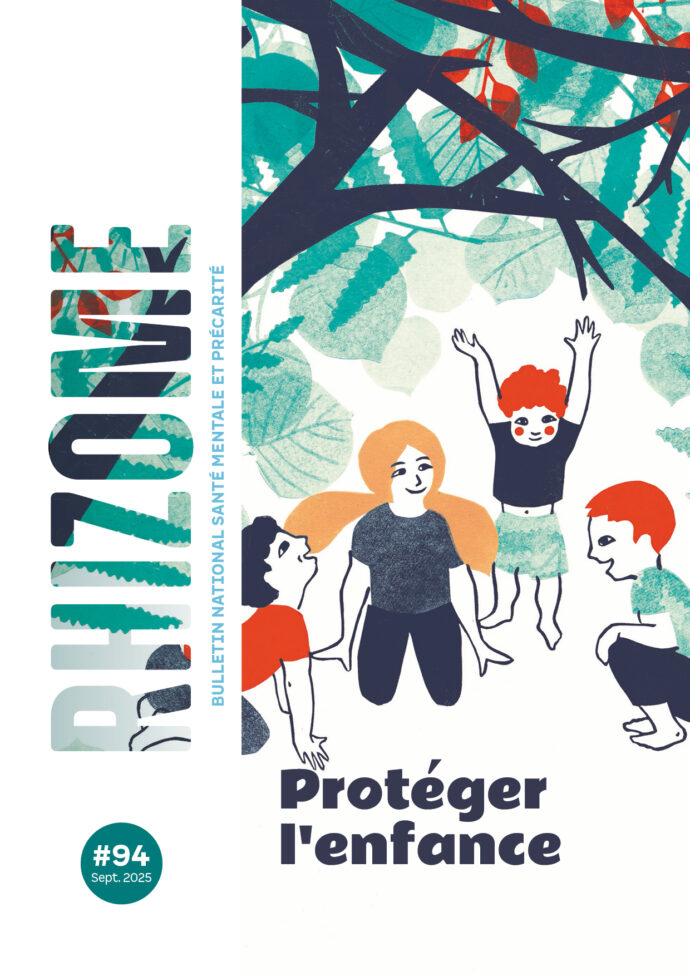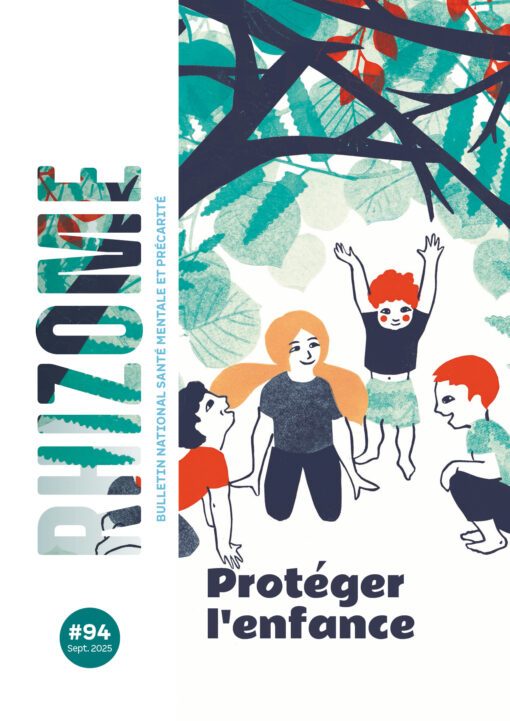Je m’appelle Julie et j’ai été placée à mes 17 ans. J’ai un trouble psy et, à cet âge-là, je faisais beaucoup de tentatives de suicide. Mes parents ont été négligents avec moi. Une énième tentative de suicide a alerté un interne en psychiatrie qui était de garde ce soir-là et qui me connaissait déjà très bien, puisqu’il était également interne dans le service de pédopsychiatrie dans lequel j’avais été hospitalisée pendant deux ans d’affilée. Ayant également connaissance du profil de mes parents, un signalement a été adressé à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) qui a prononcé un placement.
Des placements marqués par un accompagnement insuffisant
Les structures où j’ai été placée n’accueillaient pas spécifiquement des adolescents concernés par les troubles psy. D’ailleurs, mon trouble n’a jamais vraiment été pris en compte par l’ASE ou dans les foyers. Au contraire, ils avaient plutôt tendance à bien le mettre sous le tapis, ce que j’ai mal vécu. J’avais l’impression que les travailleurs sociaux n’étaient pas à l’aise avec les questions de santé mentale. Ils n’en parlaient pas, ils semblaient aussi peu informés que formés à ce sujet. Par exemple, comme je m’automutilais, j’ai parfois eu le droit à des réactions inadaptées de leur part. Par conséquent, j’ai fait de nombreux passages à l’acte. Lors de mes placements, j’ai souvent ressenti que je devais me débrouiller seule, que je n’avais pas le choix et que j’étais un fardeau ou de trop dans le foyer. Avec le recul, je dirais que l’accompagnement des adolescents est insuffisant au sein de ces dispositifs. Le manque de professionnels souligne à quel point ils sont dépassés. Les jeunes ne reçoivent pas assez d’attention, on ne prend pas assez soin d’eux. Par exemple, certains jours, chaque adolescent passait le temps dans sa chambre à se tourner les pouces et à ruminer. Je sentais également une différence de traitement de la part des éducateurs entre les garçons et les filles qui avaient tendance à être plus contrôlées, recadrées, voire sexualisées par certains.
Au long de mon parcours à l’ASE, j’ai rencontré des adultes qui m’ont aidé, certains de manière plus pertinente que d’autres. Je me souviens particulièrement d’une assistante sociale qui a entreprit des démarches pour que je sois reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le projet d’intégrer un foyer d’accueil pour les personnes en situation de handicap mental à ma majorité m’a été proposé. Nous sommes allées visiter cet endroit que j’ai trouvé horrible. Les personnes étaient toutes regroupées dans ce lieu, où peu d’activités sont proposées et où elles ne progressent pas parce que personne ne cherche à les faire progresser. Cette assistante sociale s’est battue avec moi pour que je puisse avoir une autre option en sortant du foyer. J’ai ainsi découvert le programme Un chez soi d’abord.
Découvrir et intégrer un dispositif différent
En intégrant le programme, j’ai tout de suite senti qu’il n’était pas comme les autres. Souvent, lorsque l’on est concerné par un trouble psy ou un parcours de vie assez atypique, on a le sentiment d’être un « cas » et de ne pas être « normal ». Parfois, on a du mal à se sentir humain. Cette sensation on la ressent un peu partout, même auprès des psychiatres qui nous suivent, car les consultations sont très focalisées sur les symptômes, le trouble, le risque de rechute ou de mauvaise gestion et la recherche de ce qui ne va pas. Au Chez soi, je me suis toujours sentie bien accueillie, respectée et mise au même niveau que les professionnels. Leur intention et leur regard sont normaux, simplement. Ils me donnent vraiment la parole et m’écoutent, même si je suis en retard. Si j’annule une visite à domicile, ils me rappellent toujours et me disent qu’ils sont présents. Ces temps individualisés sont soutenants et montrent qu’ils pensent à nous et qu’ils sont là quelle que soit la question, l’heure du rendez-vous, ou notre volonté de les voir ou non d’ailleurs. Les pairs-aidants, qui sont parfois passés par les mêmes difficultés que nous et qui ont réussi à les surmonter – ou en grosse partie –, sont de très bons exemples pour les personnes qui souffrent. Avec eux, on se comprend, alors que ça ne serait pas forcément le cas avec un autre professionnel.
Gabin
La naissance de mon fils, Gabin, m’a permis de renouer des liens avec de nombreuses personnes qui ont perçu à quel point j’avais changé grâce à lui. J’ai préparé l’arrivée de mon enfant, je suis devenue responsable et bien organisée. Avant, j’avais tendance à faire des bêtises, je prenais de la drogue, je parlais avec des mauvaises personnes ou je cherchais à me mettre en danger. Avoir vécu ces expériences me donne l’impression d’avoir toujours besoin de faire mes preuves, ne serait-ce qu’envers moi-même. Aujourd’hui, les personnes qui m’entourent sont bienveillantes et respectueuses de l’éducation que je donne à mon fils, bien différente de celle de mes parents. Le fait d’avoir eu des parents plutôt agressifs et violents m’aide à ne pas l’être. Je ne veux pas que mon fils vive ce que j’ai vécu, qu’il se sente comme je me suis sentie et comme je me sens encore parfois à l’heure actuelle.
Pour conclure, prendre le temps et écouter des personnes en souffrance, surtout quand elles sont adolescentes, mais aussi leur faire savoir que quelqu’un est là pour elles, même quand elles dérangent, peut tout changer à leurs yeux.