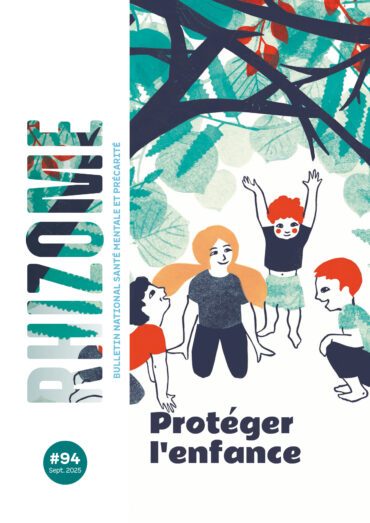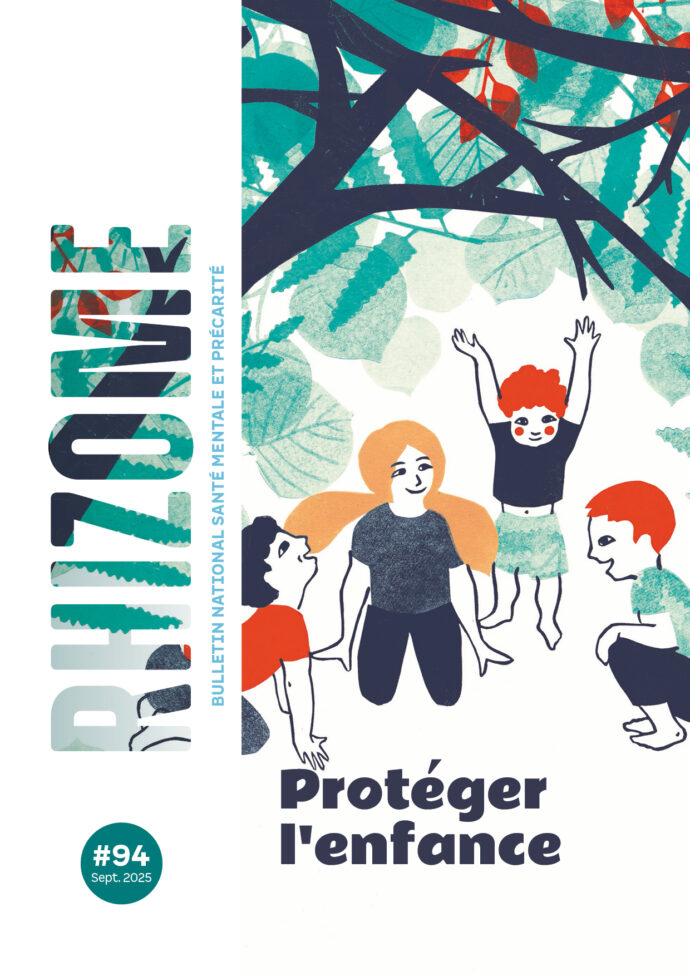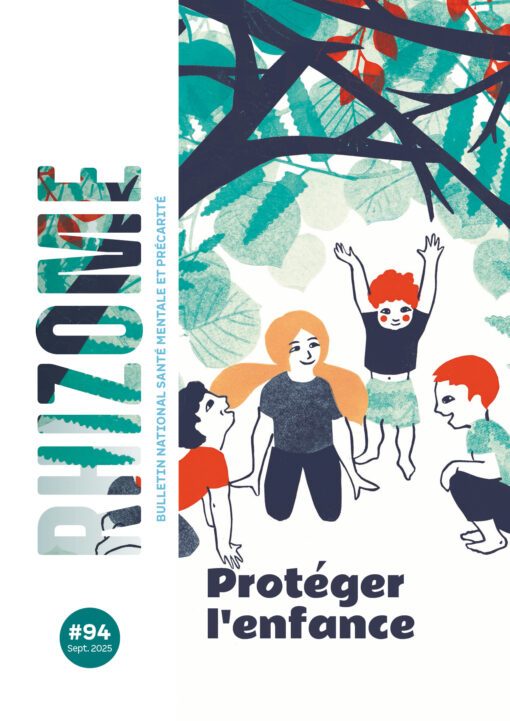Les relations aux pairs sont souvent moins étudiées que les relations parents-enfant, pourtant elles jouent un rôle clé dans le développement des enfants. Ces interactions influencent leur socialisation et leur bien-être.
La compréhension des autres : le rôle clé de la cognition sociale dans le développement de la prosocialité
Malgré l’idée largement répandue selon laquelle l’individu serait foncièrement égocentré et motivé par ses propres intérêts, de nombreuses études montrent qu’une grande partie des comportements humains sont orientés vers les autres. Dès la petite enfance, les enfants s’engagent dans des interactions sociales et adoptent des comportements prosociaux tels que le partage, l’empathie et l’entraide. Ces compétences se développent progressivement et se renforcent tout au long de l’âge scolaire. L’expérimentation de relations positives avec les autres favorise le développement de la cognition sociale, permettant aux enfants de percevoir, comprendre et réagir aux comportements d’autrui. Cette aptitude leur offre ainsi la capacité de s’autoréguler en fonction des normes du groupe et d’interagir de manière adaptée avec leurs pairs. Une bonne maîtrise de la cognition sociale a des effets positifs sur la qualité des relations interpersonnelles, l’acceptation au sein des groupes de pairs et la réputation sociale. Lorsqu’un enfant cherche à intégrer un groupe, un comportement socialement adapté serait de parler de l’activité que le groupe réalise, « C’est très joli ce que vous avez fait, est-ce que je peux vous aider ? » plutôt que d’interrompre brutalement l’activité avec une remarque comme : « Moi aussi je veux jouer avec vous maintenant ! » Cette dernière attitude, perçue comme intrusive, peut entraîner une exclusion. Les enfants dotés d’une cognition sociale plus développée montrent de meilleures compétences en communication, sont plus adaptés socialement et réussissent mieux académiquement. À l’inverse, des difficultés dans cette sphère peuvent entraîner des problèmes d’adaptation sociale et scolaire. De surcroît, un déficit de sociabilité dès le plus jeune âge est associé à des troubles du comportement persistants durant l’enfance et l’adolescence1.
Du conflit à l’agressivité
Contrairement à une idée reçue, le conflit peut être constructif. Le concept de conflit sociocognitif décrit les situations où des contradictions entre idées, représentations ou actions surviennent2. La manière dont ces conflits sont négociés – via le dialogue, le compromis et la prise en compte du point de vue d’autrui – peut être une source d’apprentissage et de développement sociocognitif, notamment parce qu’elle s’exerce sans agressivité et grâce à des stratégies adaptées. Toutefois, au cours de leur socialisation, les enfants peuvent manifester différentes formes d’agressivité. Ces dernières émergent vers la deuxième année et sont étroitement liées au développement langagier. Il existe quatre types d’agressivité3 :
- instrumentale (entre 2 et 6 ans), motivée par la volonté d’obtenir ou de conserver un objet ;
- réactive, caractérisée par une impulsivité en réponse à une provocation perçue ;
- relationnelle, qui consiste à exclure ou à nuire aux relations sociales d’un autre enfant (rejet, insultes) ; • par intimidation, impliquant des violences physiques ou verbales répétées envers une victime sans défense. Si les deux premières formes résultent d’une régulation émotionnelle en construction, les deux dernières traduisent des comportements antisociaux plus marqués. Ainsi, l’agressivité instrumentale et l’agressivité réactive constituent des passages qu’une grande partie des enfants vont traverser et qui contribuent à l’affirmation de soi, alors que l’agressivité relationnelle et l’agressivité par intimidation ne concernent qu’une partie des jeunes et entravent profondément les relations aux autres.
La comparaison sociale, vecteur d’influence des relations
La comparaison sociale est un processus cognitif où l’individu évalue ses capacités et ses caractéristiques en fonction des autres4. Chez l’enfant, ce mécanisme devient plus marqué à l’école primaire, notamment en raison des évaluations académiques. Ces comparaisons influencent l’estime de soi et la perception de sa propre compétence. Au-delà du cadre scolaire, l’enfant utilise ces comparaisons pour se situer socialement. À l’adolescence, l’importance croissante des pairs accentue cette dynamique : les jeunes cherchent à se conformer aux normes du groupe pour être acceptés, au risque de subir une pression sociale. Ceux qui n’y parviennent pas sont plus vulnérables au rejet, augmentant la détresse psychologique et le repli sur soi. Un rejet prolongé peut conduire à des troubles internalisés et externalisés. Toutefois, l’identification à un groupe de pairs et les amitiés solides peuvent jouer un rôle protecteur. Elles offrent un soutien émotionnel face aux difficultés, favorisent le développement des habiletés sociales et constituent un facteur de protection face aux expériences interpersonnelles négatives5.
Notes de bas de page
1 Mormont, É. et Stievenart, M. (2022). La prosocialité limitée chez l’enfant : État des lieux. Enfance, 2(2), 217-231.
2 Astolfi, J.-P. (2008). La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre. Presses universitaires de France.
3 Stassen Berger, K. (2012). Psychologie du développement. De Boeck.
4 Wood, J. V. (1996). What is social comparison and how should we study it?. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 520-537
5 Glick, G. C., & Rose, A. J. (2011). Prospective associations between friendship adjustment and social strategies: Friendship as a context for building social skills. Developmental Psychology, 47(4), 1117–1132.