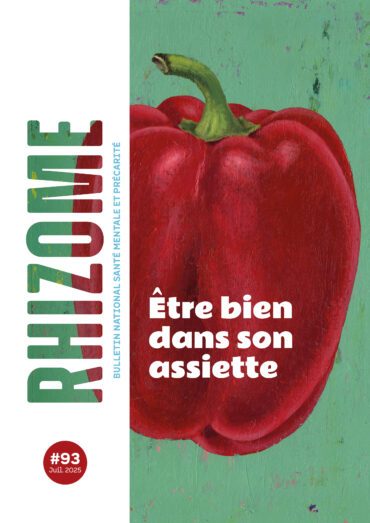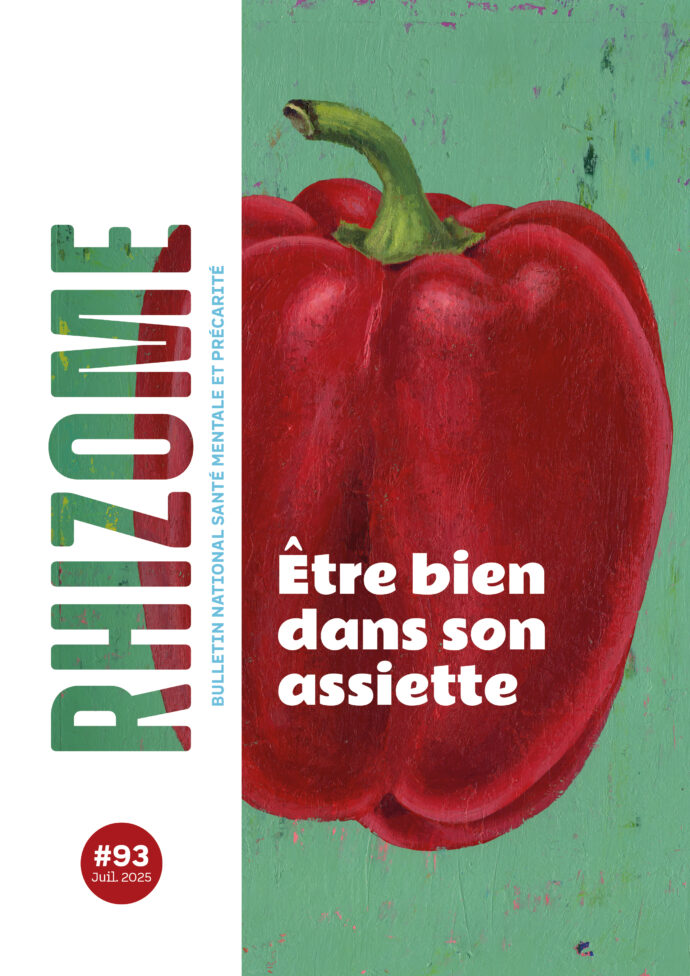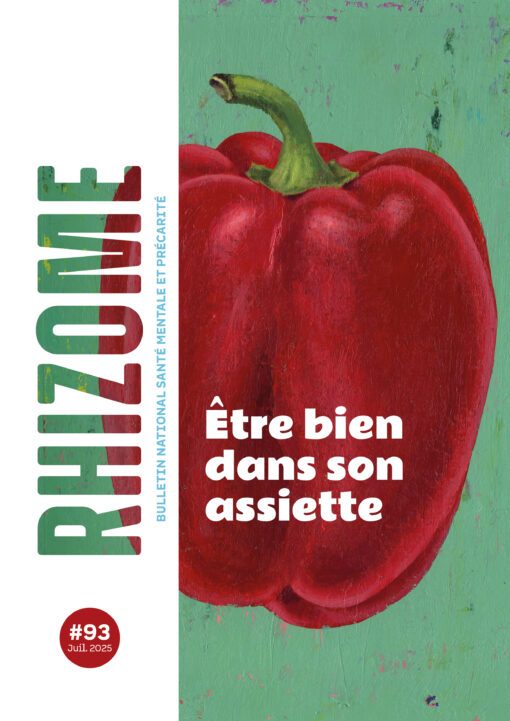Manger pour vivre, vivre pour manger. Si le fait de se nourrir nous renvoie à nos fonctions instinctuelles et à notre condition humaine, il ne se limite pas uniquement à cela et représente un fort marqueur social et identitaire. Quels effets notre alimentation a-t-elle sur notre santé, mais aussi sur notre environnement ? Surtout, que dit-elle de nous ? Tandis qu’une partie de la population mondiale lutte au quotidien pour se nourrir, une autre cherche à manger« mieux », en réduisant l’impact de sa consommation sur les êtres vivants et les écosystèmes. L’alimentation révèle et renforce des inégalités – sociales, économiques, géographiques et environnementales – particulièrement en période de crises (causées par des instabilités politico-économiques, des conflits, des catastrophes ou la précarité).
Choisir ce que nous consommons, retrouver des saveurs d’enfance, vivre de nouvelles expériences, préparer un plat pour celles et ceux que nous aimons, partager des recettes familiales… L’alimentation procure des sentiments de réconfort et de bien-être.
Comme le rappelle l’expression « eat your feelings » (« manger ses émotions »), des liens étroits existent entre la manière dont nous nous sentons et ce qui nous nourrit. Être empêché de choisir ce que l’on mange, dépendre de l’aide alimentaire, ne plus ressentir de plaisir ou être privé de nourriture nous affecte profondément tant sur le plan psychique que physique. Mieux appréhender les liens entre la souffrance psychique, les troubles psychiatriques et l’alimentation nous invite à repenser la manière de nous nourrir.
Précarité alimentaire
Manger à sa faim, accéder à une nourriture variée, choisie et à des ingrédients de qualité, mais aussi avoir la possibilité de cuisiner, d’inviter ou de partager ses repas sont autant d’actes empêchés par la précarité sociale. Accentuées par la crise sanitaire, les craintes autour de la précarité alimentaire sont aujourd’hui appréhendées comme un véritable enjeu de santé publique, tout en veillant à respecter la dignité de tout un chacun. Comme l’atteste l’Observatoire des Restos en France, le nombre de personnes dépendant des distributions alimentaires ne cesse d’augmenter. Des initiatives, telles que la mise en place d’une sécurité sociale alimentaire ou des tiers-lieux alimentaires, voient alors le jour et se déploient sur le territoire. Celles-ci redonnent du pouvoir d’agir aux personnes précaires en leur permettant notamment de choisir comment se nourrir en marge des contraintes financières.
Troubles dans l’alimentation
Ces dernières années, la psychiatrie et la psychologie clinique s’intéressent davantage aux effets de l’alimentation sur la qualité de vie des patients.
Les pathologies psychiatriques et les effets des traitements ont également des effets sur la satiété et le plaisir. Reconnaître les liens entre souffrance psychique, stress ou anxiété et alimentation permet d’envisager de nouvelles formes de soin, et de redonner aux personnes un certain pouvoir sur leur santé.
Faire de l’alimentation un sujet de la clinique et de l’accompagnement invite les professionnels à une écoute plus fine des besoins et des récits des personnes. Être concerné par des troubles du comportement alimentaire expose les personnes au regard des autres et à la discrimination sociale associée.
La nourriture qui nous lie
La préparation, le partage des repas et la production alimentaire donnent lieu à des interactions sociales. Ainsi, les ateliers de cuisine ou les cuisines partagées permettent de créer des liens avec d’autres, autrement. La nourriture peut être donnée, partagée, échangée, offerte. Les identités se tissent à travers des traditions culinaires, des héritages, des manières de cuisiner ou d’assaisonner. Pour autant,
se retrouver autour de la nourriture peut être vécu autant comme un moment de partage que de contrainte. Autour de la table, des rapports de pouvoir s’expriment aussi : des rôles peuvent être assignés, des corps jugés, des nourritures valorisées ou même dénigrées.
Ce numéro de Rhizome propose d’explorer l’alimentation comme un révélateur d’inégalités, mais aussi comme un vecteur de liens et de soins. Il nous invite à penser ce que manger veut dire, dans un monde où l’accès à une alimentation choisie, digne et partagée reste profondément inégal. Prendre soin de soi et des autres, c’est aussi prendre soin de ce qui nous nourrit.