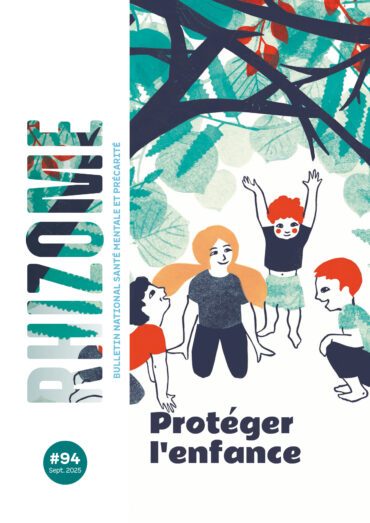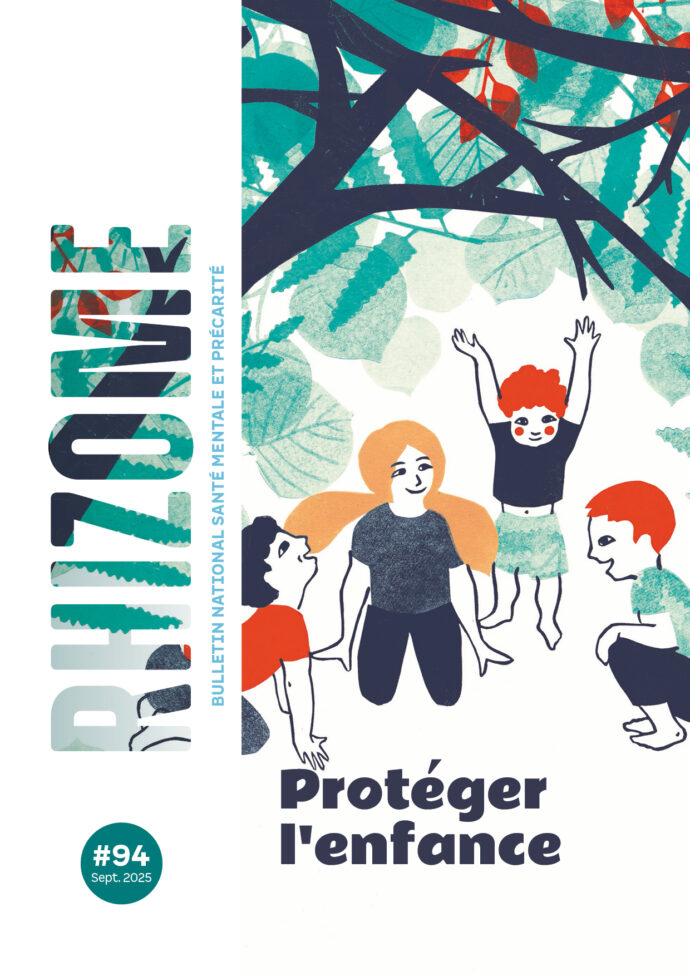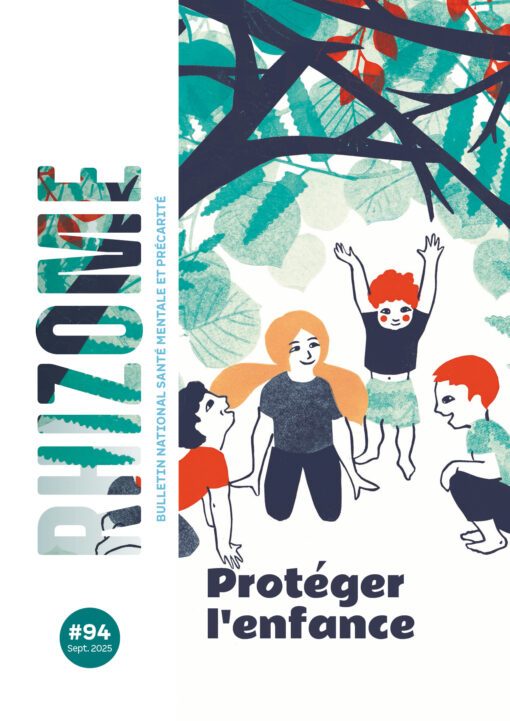La protection maternelle et infantile (PMI) est un service public de prévention et de promotion de la santé physique, psychique et sociale. Ce service de proximité est assuré par les départements.
Les professionnels de santé de la PMI proposent des actions à toutes les femmes enceintes, aux (futurs) parents et aux enfants de moins de 6 ans. Une attention particulière et des actions « d’aller vers » sont notamment menées envers les personnes confrontées à une situation de vulnérabilité. Enfin, la PMI participe aux missions de protection de l’enfance lorsqu’il y a une notion de danger pour un mineur. Depuis 1988, une équipe de PMI du Rhône puis de la métropole de Lyon intervient auprès des femmes enceintes et des mères avec leur enfant à la maison d’arrêt de Corbas.
Une unité nurserie en prison
Située dans le quartier des femmes de la maison d’arrêt, en retrait des autres espaces, l’unité nurserie comprend trois cellules individuelles, un espace commun pour le jeu, une cuisine ainsi qu’une petite cour extérieure. Les femmes intègrent la nurserie au maximum au septième mois de la grossesse. Les mères peuvent y rester jusqu’au 18 mois de l’enfant, âge où celui-ci doit quitter le milieu carcéral.
Dans le contexte particulier de l’incarcération, la sage-femme, les infirmières puéricultrices, l’auxiliaire de puériculture et le médecin de l’équipe proposent des consultations aux femmes enceintes détenues centrées autour de l’accompagnement à la naissance, ainsi que des consultations pour les nourrissons hébergés auprès de leur mère. Leurs objectifs sont de répondre aux questions et aux besoins des mères concernant leur santé et l’arrivée de leur bébé, de la santé de ce dernier, son éveil et son développement ; d’assurer un suivi médical de prévention ; de favoriser une continuité dans le parcours de santé et de socialisation de l’enfant à l’extérieur ; et, enfin, de préparer ainsi que d’accompagner une séparation éventuelle entre la mère et l’enfant.
Notre accompagnement vise également à permettre à la mère d’éprouver une relation de confiance, fondée sur l’écoute et la valorisation de ses compétences parentales. Nous collaborons avec les autres intervenants de la dyade mère-enfant, dans une approche pluridisciplinaire, afin de créer un maillage large de soutien pour sécuriser autant que possible la mère et lui permettre, à son tour, de sécuriser son enfant.
Devenir mère en détention
À l’image de la population carcérale, les femmes que nous accompagnons sont majoritairement des personnes en situation de précarité sociale, familiale ou psychique. Elles peuvent avoir connu des situations de violences intrafamiliales, être touchées par des mesures de protection de l’enfance (qui les ont concernées elles-mêmes ou leurs enfants) ou bien être dans un parcours migratoire (avec une situation variable quant au droit au séjour : situation régulière ou irrégulière, avec ou sans obligation de quitter le territoire français à l’issue de la période de détention). Ces femmes, souvent isolées, ont un réseau familial ou amical ténu ou éloigné sur lequel elles ne peuvent pas toujours s’appuyer et un parcours de vie marqué par des ruptures qu’elles ne souhaitent pas toujours aborder. Ces spécificités rendent souvent difficile l’élaboration d’une continuité dans leur parcours d’intégration sociale et de soins une fois à l’extérieur. A contrario, la prise en charge médicale et sanitaire de certaines femmes peut être facilitée par le milieu carcéral. En effet, en détention, elles accèdent à un suivi médical global (par exemple, sur le plan diététique, kinésithérapique et psychologique) ainsi qu’à une ou deux consultations mensuelles en lien avec leur suivi de grossesse. La grossesse est une période de grande sensibilité. L’anxiété des futures mères est accentuée par un contexte de privation de liberté qui isole les femmes de leurs familles, les confronte à l’absence de contact intergénérationnel, ne leur laisse que peu de maîtrise sur leur suivi de grossesse, et les empêche de préparer matériellement l’arrivée de leur bébé. La projection dans le devenir parent au sein de cet univers peut être complexe et ce seul horizon carcéral à offrir à leur enfant peut engendrer un sentiment de culpabilité chez ces femmes.
Notre relation d’accompagnement avec elles se construit en utilisant comme point de départ leurs références (familiales ou culturelles), ce qu’elles veulent bien nous dire de leur histoire, leurs connaissances autour de la parentalité et des besoins du nourrisson. Notre rôle est d’accompagner leurs angoisses, de centrer les entretiens mensuels sur la grossesse et de valoriser leurs ressentis afin de favoriser la projection dans la parentalité.
Valoriser le lien d’attachement, les liens parents-enfant et soutenir la parentalité
Dans l’objectif de permettre au nourrisson de rester auprès de sa mère dans les conditions les plus favorables possibles, nous assurons un étayage et une guidance auprès des mères à la nurserie. L’un des enjeux de notre intervention est de soutenir la relation d’attachement dont nous connaissons aujourd’hui les effets sur l’éveil et le développement physique et psycho-affectif de l’enfant. Nous accompagnons les femmes dans leurs réponses aux besoins de leur enfant selon leurs propres repères, tout en étant attentifs au développement harmonieux de celui-ci et à repérer des troubles éventuels. En parallèle, même si nous ne rencontrons pas l’autre parent et qu’il est exclu du parcours de grossesse, nous nous efforçons de l’inclure en interrogeant la mère sur son histoire, les liens qu’elle a avec lui et avec l’enfant ainsi que sa place dans son éducation et son développement.
Le milieu carcéral et son organisation nous confrontent, dans notre pratique habituelle, à ses référentiels « d’institution totale ». Cela signifie que nous devons accepter de jouer le rôle d’interface avec les surveillants et l’administration pénitentiaire. Cela demande une forte mobilisation et une coordination des intervenants. Par exemple, nous pouvons être amenés à faire des prescriptions aux mères afin qu’elles bénéficient des balais à manches longs pour qu’elles n’aient pas mal au dos, mais aussi aux enfants, pour qu’ils aient accès aux petits pots choisis par leur mère. Nous adressons également des demandes au service administratif afin qu’elles obtiennent des jeux et des jouets adaptés à leur enfant. Les délais de réponse ne sont pas immédiats. Répondre de cette manière, ce qui est inhabituel pour nous, aux demandes des mères, valorise leurs places, leur redonne prise sur la conduite de leur vie et la gestion du quotidien de leur enfant. Cela augmente leur estime d’elles-mêmes au regard de leurs capacités parentales.
Rester connectés avec l’extérieur
Notre intervention se fait dans le souci constant de l’articulation du dedans et du dehors. En effet, les mères sont dans l’impossibilité d’accompagner ou d’amener leur enfant à l’extérieur (lors de visites médicales spécialisées, à la crèche ou dans des espaces de découverte et de loisirs, par exemple).
Elles n’ont pas accès aux ressources que peuvent avoir les femmes à l’extérieur concernant des choses simples telles que le choix des vêtements, du matériel de puériculture et des jouets. N’ayant pas accès à Internet, l’équipe amène des documents papier pour qu’elles puissent les choisir. Ainsi, la mère reste la personne « en charge » de ce qui concerne son enfant à l’intérieur ou à l’extérieur de la détention.
Lorsqu’une sortie de détention est anticipée, nous mettons en place un travail à deux niveaux. Tout d’abord, nous intervenons auprès de la dyade à partir du projet du parent. En fonction, nous lui exposons des propositions et des préconisations. Enfin, un travail partenarial est également effectué afin de nous coordonner avec les équipes internes (tels que le service médico-psychologique régional ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, par exemple) et externes (comme le service de PMI du futur lieu d’habitation du/des parents ou de l’Aide sociale à l’enfance). Il nous importe de veiller aux conditions de vie de l’enfant à l’extérieur ainsi qu’aux capacités parentales des mères, en gardant toujours comme boussole la réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant, concernant sa santé, sa sécurité et son développement. En cas de séparation, un travail de coordination pour soutenir la mère, l’enfant et leur lien est engagé. Cette situation particulière suscite des questionnements : comment laisser une trace à la dyade de cette vie commune (par exemple, grâce à un album photos ou des dessins de l’enfant) ? Que souhaiterait transmettre la mère aux personnes qui vont s’occuper de son enfant (par exemple, ses habitudes de sommeil, ses préférences alimentaires ou alors ce qu’il aime ou non) ? Comment gérer les semaines qui précèdent ainsi que le moment de la séparation ? Des questions sur les conditions du nouveau milieu de vie de l’enfant se posent également en lien avec l’autre titulaire de l’autorité parentale ou les personnes-ressources identifiées.
Conclusion
La place de la PMI auprès des mères et de leur enfant en milieu carcéral est nécessaire afin d’accompagner et de promouvoir, dans ce contexte très particulier, la santé de ces femmes, ainsi que le développement et la sécurité de l’enfant. Malgré des ressources entravées pour la mère et son bébé dans ce milieu, nous savons combien permettre à l’enfant de bénéficier d’une relation d’attachement suffisamment sécurisante auprès de sa mère lui donne accès aux meilleures conditions possibles pour bien grandir.