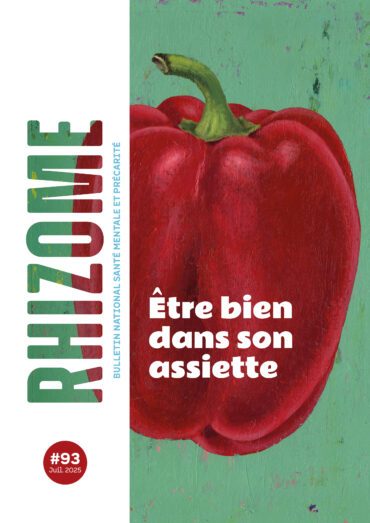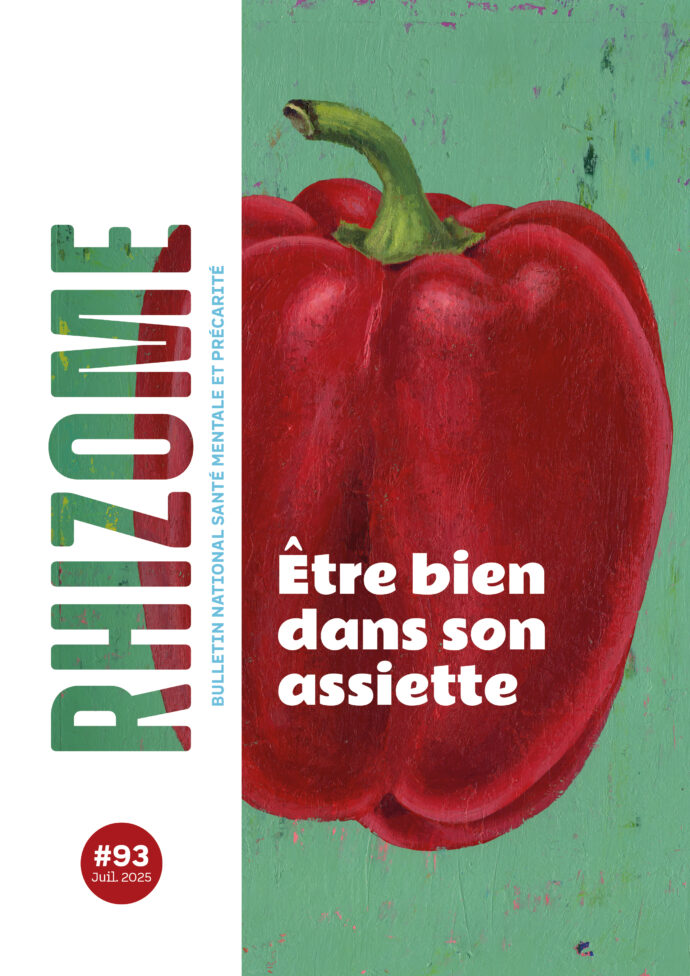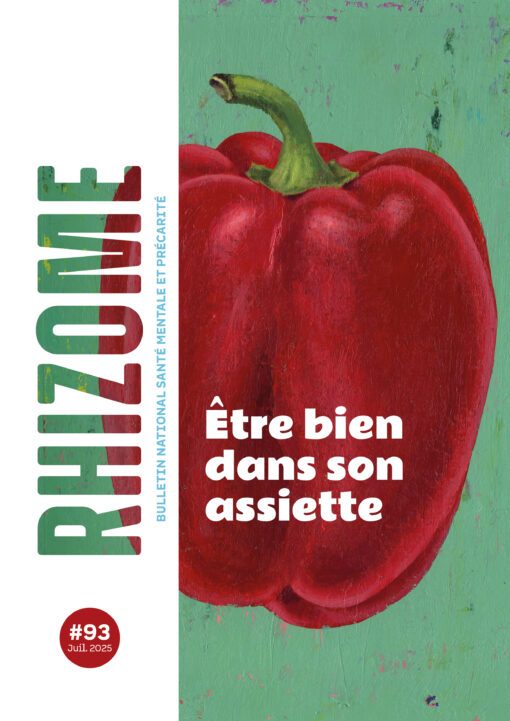Le partage du repas est considéré comme un trait social majeur des êtres humains ; nous retrouvons d’ailleurs des traces de nourriture autour des foyers les plus anciens, remontant à plus de 800 000 ans1. Dans la plupart des sociétés humaines, l’alimentation fait souvent l’objet d’un temps collectif défini et récurent. Le fait de partager le repas est désigné par le terme « commensalité2 », de co-mensa, ce dernier mot désignant en latin la table sur laquelle reposent les aliments. « Commensalité » désigne donc littéralement le fait de partager la table. Le terme est parfois confondu avec celui de « convivialité », qui désigne un contexte d’échanges positif et respectueux. Cette confusion est symptomatique d’ une tendance sociétale à percevoir le partage du repas comme immédiatement positif : manger ensemble serait systématiquement bénéfique pour les relations entre les participants et synonyme de bien-être.
À l’inverse, manger seul est considéré comme pathologique, synonyme d’isolement et de mal-être. Cette vision se retrouve, par exemple, dans la précédente version du Plan national nutrition santé (PNNS, 2019-2023) qui recommandait, au même titre que l’équilibre nutritionnel, le fait de manger ensemble, notamment dans le cadre familial3. Pourtant – et contrairement aux données purement nutritionnelles – ces recommandations ne peuvent s’appuyer sur un consensus scientifique, les rares études sur les bienfaits de la commensalité montrant plus des corrélations que des causalités4. D’une manière générale, une approche critique de la commensalité s’avère nécessaire dans ce contexte où elle a tendance à être parée de toutes les vertus sans prise en compte de son caractère multiple.
L’ambivalence des liens sociaux
Au cœur de cette réflexion critique sur la commensalité se trouve la question du « lien social », terme lui aussi souvent mis en avant comme immédiatement positif. Pourtant, des rapports de domination, de rejet ou de violence peuvent aussi constituer des formes de liens sociaux, dont le caractère est dès lors beaucoup plus nocif. De la même façon, Claude Grignon a, dès les années 1990, souligné la diversité des formes de commensalité, et notamment l’opposition entre une forme « ségrégative » et une forme « transgressive5 ». La première forme souligne le fait que manger ensemble, c’est de fait ne pas manger avec d’autres. Si cette dimension permet de solidifier les liens entre la communauté des parties prenantes au repas, elle contribue en même temps à générer de l’entre-soi et de l’exclusion. À l’inverse, une commensalité transgressive regroupe des personnes de communautés ou de milieux sociaux différents, qui normalement – au sens de conformité aux normes sociales – ne devraient pas manger ensemble. Toutefois, ne nous y trompons pas : si ces repas « transgressifs » peuvent contribuer à créer des liens entre groupes sociaux isolés les uns des autres, ils peuvent aussi générer un sentiment de mal-être lorsqu’ils sont subi. Les observations de Sonia Bouima6 lors de repas partagés organisés par des associations au bénéfice de personnes retraitées ont montré la difficulté à créer une atmosphère conviviale lorsque les différences sociales entre les participants sont trop importantes. Ces formes transgressives peuvent également renforcer des rapports de domination lorsque l’invitation vient du dominant et ne peut être refusée : Claude Grignon donne à ce propos l’exemple d’un homme politique mangeant avec des ouvriers à la cantine de l’usine. Dans ce cas, c’est bien la présence du dominant qui donne son importance au repas, renforçant symboliquement le rapport hiérarchique. Ces dimensions ambivalentes de la commensalité, effacées dans les incitations sociales à une commensalité perçue comme immédiatement conviviale, se retrouvent particulièrement dans deux contextes spécifiques : l’alimentation des personnes âgées et le repas de famille quotidien.
La commensalité à l’épreuve du vieillissement
Une étude menée dans le cadre de la thèse de Sonia Bouima avait permis de montrer comment la figure de la « personne âgée isolée et dénutrie » était une construction sociale qui recouvrait des réalités très diverses. Les représentations ont tendance à opposer une vision misérabiliste d’une personne qui mange seule, mal et voit peu de monde, d’une part, et une personne qui « sort », mange bien et partage ses repas, d’autre part7. Or les réalités et les vécus peuvent être très divers : des repas pris seuls peuvent être nutritionnellement corrects et ne pas conduire à la dénutrition, et le sentiment de solitude peut exister même dans le cadre d’échanges sociaux fréquents. Cela est encore plus marquant au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : les repas y sont quasi systématiquement pris collectivement, ce qui apparaît comme une dimension positive aussi bien pour les professionnels que pour les familles.
Pourtant, une part du plaisir du repas réside dans le fait de choisir ce partage et les personnes qui en font l’objet, la solitude pouvant même être parfois recherchée et salutaire. De plus, que penser de ces repas lorsqu’ils sont pris en présence de personnes en incapacité de respecter les codes sociaux, du fait de troubles physiques et cognitifs qui peuvent, par exemple, se traduire par des déambulations, de la salivation excessive ou des cris8 ? Alors que tout un chacun a déjà expérimenté des situations de repas partagés plutôt désagréables, et à l’in- verse de repas solitaires paisibles et ressourçants, cette pluralité des expériences semble disparaître lorsqu’il s’agit de penser l’alimentation des personnes âgées, probablement du fait d’une peur de l’isolement et de la difficulté à définir la place des aînés dans notre société.
Manger ensemble en famille : entre injonctions contradictoires et charge mentale
Autre situation intéressante, le repas de famille – ici entendu dans le sens du repas quotidien et ordinaire du noyau familial restreint – fait aussi l’objet d’incitations au partage. La commensalité permettrait de parfaire l’éducation des enfants, leur bien- être et leurs savoirs nutritionnels. Cependant, les observations ethnographiques menées par Fairley Le Moal ont mis en évidence une réalité bien plus nuancée9. L’atteinte de ces divers objectifs est fortement conditionnée aux ressources des parents, non seulement en termes financiers, mais également en termes de capital social, culturel, relationnel et temporel. De plus, il est souvent difficile d’atteindre ces objectifs en même temps : un repas équilibré et végétal génèrera parfois moins de convivialité qu’un menu plus plaisir (du type pizza ou burger), le fait d’insister sur l’apprentissage des normes du bien manger peut également générer des relations plus conflictuelles entre parents et enfants. Ainsi, dans les faits, ces injonctions apparaissent souvent contradictoires et viennent renforcer non seulement la charge mentale des parents – et particulièrement des mères qui restent souvent en charge des repas, ou a minima de leur organisation et planification – mais en plus générer un sentiment d’échec conduisant parfois au renoncement. Une solution serait de séparer les priorités, en privilégiant, par exemple, nutrition pour un repas, échange et partage pour un autre. C’est d’ailleurs souvent ce que font les familles, avec des moments du type « pizza-TV du vendredi soir ». Ces repas en apparence extraordinaires, mais souvent ritualisés et récurrents s’avèrent paradoxalement importants pour renforcer les normes qu’ils transgressent.
Finalement, l’intérêt des politiques de santé publique pour la commensalité ces dernières années pointe certes une dimension importante de l’alimentation dans les sociétés humaines, mais tend à réduire la complexité des relations sociales qui se tissent – ou ne se tissent pas – autour du repas. La prise en compte de la dimension subie ou choisie de la commensalité et de ses formes constitue notament une dimension importante et souvent négligée. Dans ce cadre, il semble nécessaire d’enrichir les recherches en sciences humaines et sociales visant à mieux comprendre les conditions dans lesquelles le partage du repas peut contribuer à la santé et au bien-être des individus et de la société.
Notes de bas de page
1 Walker, J. et al. (2016). Combustion at the late Early Pleistocene site of Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar (Murcia, Spain). Antiquity, 90(351), 571-589.
2 Jönsson, , Michaud, M., et Neuman, N. (2021). What Is Commensality? A Critical Discussion of an Expanding Research Field. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12), 6235.
3 Ministère des Solidarités et de la Santé. (2019). Programme national Nutrition Santé 2019–2023.
4 Le Moal, , Michaud, M., Hartwick-Pflaum, A., Middleton, G., Mallon, I., et Coveney, (2021). Beyond the Normative Family Meal Promotion: A Narrative Review of Qualitative Results about Ordinary Domestic Commensality. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 3186.
5 Grignon, (2001). Commensality and Social Morphology: An Essay of Typology. Dans P. Scholliers, Food, drink and identity: Cooking, eating and drinking in Europe since the Middle Ages (p. 23-33). Berg.
6 Bouima, (2019). Manger et cuisiner ensemble pour « bien-vieillir » ? Quand l’action sociale donne corps aux recommandations officielles [thèse de doctorat, Université Paris-Saclay].
7 Bouima, S , Michaud, M., et Gojard, S. (2019). La « personne âgée isolée dénutrie » : L’usage des discours du risque et du manque par les acteurs de terrain. Retraite et société, 82(2), 89-113.
8 Guérin, L. (2016). « Faire manger » et « jouer le jeu de la convivialité » en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). De l’intensification des contraintes de travail pendant le service des repas. SociologieS.
9 Le Moal, F. (2024). Mealtime emotion work: Gendered politics of care and power at the table. Journal of Marriage and Family, 86(4), 838-866.