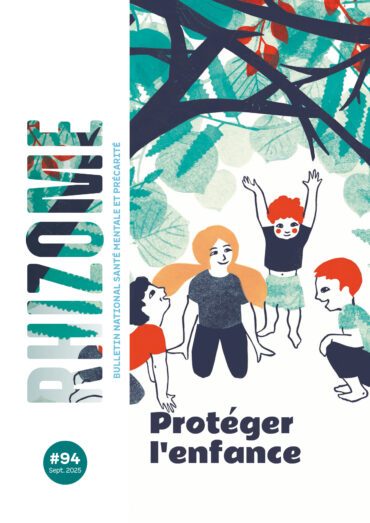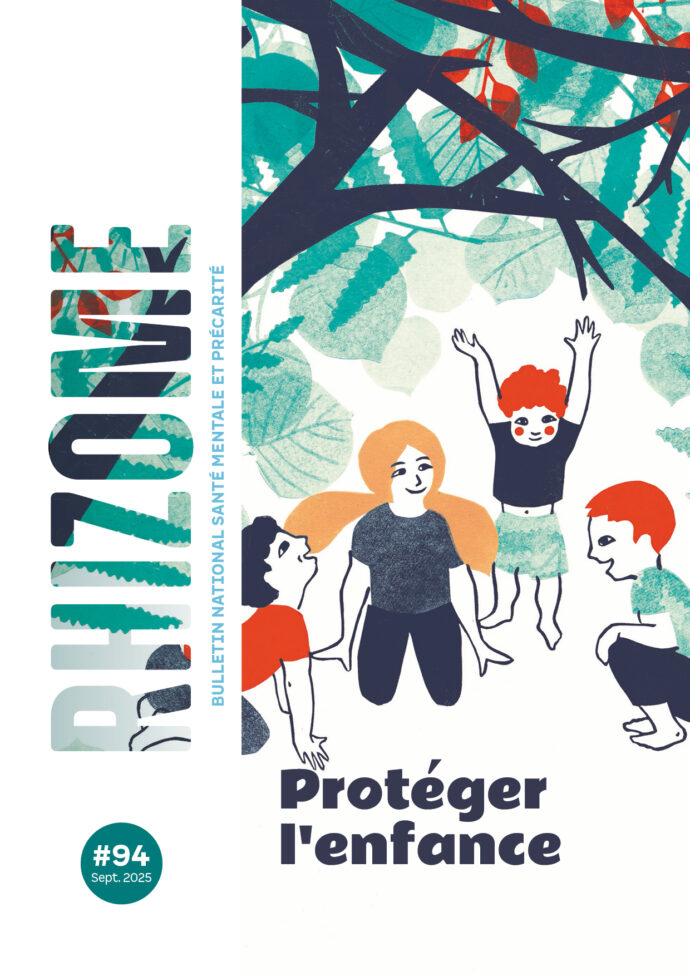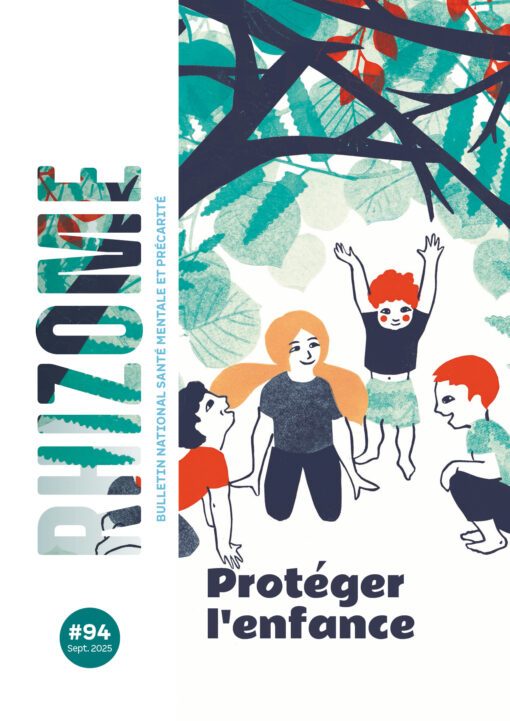Les quelques données disponibles sur la proportion des mineurs non accompagnés (MNA) en France donnent à voir l’ampleur du phénomène actuel : en 2023, 19 370 jeunes ont été reconnus comme nécessitant d’être protégés par l’Aide sociale à l’enfance1. C’est un nombre sans précédent. Ils tendent, par ailleurs, à être plus jeunes qu’auparavant et les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses2. Au sein de la métropole de Lyon, 1 086 jeunes ont été reconnus MNA en 2023, ce qui en fait le quatrième territoire français le plus concerné par leur accueil. Toutefois, ces données invisibilisent ceux n’ayant pas (encore) été évalués, mais aussi ceux qui, estimés majeurs en première instance, déposent un recours pour contester la décision3.
Une santé mentale à considérer
Leur statut d’adolescents, isolés, concernés par la migration et en situation de grande précarité, font d’eux des nouvelles figures de la vulnérabilité. Les données de prévalence des troubles psychiques chez ces jeunes, réalisées dans divers pays européens, confirment l’enjeu d’une préoccupation pour leur santé mentale. Pourtant, sur ce point, les données françaises sont à ce jour quasiment inexistantes. Ainsi, l’Orspere-Samdarra a mené une recherche auprès des jeunes migrants isolés de la métropole de Lyon, dont le versant clinique visait en premier lieu à explorer et quantifier les troubles psychiques des jeunes accompagnés par une équipe mobile santé mentale dédiée à ce public et, en deuxième lieu, à explorer leurs souffrances psychiques, leurs dimensions de santé mentale positive ainsi que les facteurs y contribuant4.
Dans le cadre de cette recherche, un échantillon représentatif de la population accompagnée par l’équipe a été sollicité pour la passation de la SCID-5, d’une part, et d’un entretien de recherche semi-directif, d’autre part. In fine, l’échantillon est composé de 20 jeunes hommes, de 14 à 17 ans, majoritairement originaires de Guinée-Conakry (60 %) et de Côte d’Ivoire (27 %). Une majorité des jeunes interrogés est en recours concernant l’évaluation de leur minorité isolée (73 %). En moyenne, ils sont en France depuis 7 mois et leur trajet migratoire a duré 3 à 6 mois.
Un environnement traumatogène
Au-delà des troubles de stress post-traumatiques, dont la prévalence est de 60 % dans l’échantillon de notre étude, c’est la proportion et le cumul d’événements à potentiel traumatique vécus qui méritent d’être soulignés. Le nombre d’événements de vie stressants (stressfull life events) fait partie des facteurs de risque psychopathologiques les plus robustes d’après les données scientifiques actuellement disponibles sur ce public5. Un seul des jeunes rencontré n’en rapporte aucun, les autres décrivent un à sept événements traumatiques tels que définis par le DSM-56. Parmi eux, tous sans exception ont été confrontés à une mise en danger de leur propre vie et 60 % de l’échantillon cumule au moins trois événements traumatiques au cours de leur vie. L’accroissement de la dangerosité des routes migratoires laisse supposer que ces proportions vont encore évoluer dans les mois et années à venir7.
Les données qualitatives nous permettent d’aller plus loin sur ces événements. Nous observons que des effets méthodologiques8 conduisent les jeunes à évoquer, lors des questions portant directement sur les événements traumatiques, quasi exclusivement les événements vécus dans le pays d’origine ou au décours du parcours migratoire. Toutefois, si l’on relève l’ensemble des événements à potentiel traumatique évoqués au décours des entretiens clinique, la part de ceux vécus en France est considérable. Leurs impacts sur la santé mentale et le quotidien des jeunes sont à souligner. À titre d’exemples, les violences vécues sur les lieux de distribution alimentaire conduisent certains jeunes à se priver de nourriture ; une attaque au couteau dans le métro, ayant blessé un jeune reconnu MNA, les conduits, par identification, à éviter les transports et les sorties non accompagnées, restreignant ainsi plus encore leur liberté de déplacement. Les violences diverses vécues dans le pays d’accueil ont sur eux un effet tout particulier, bouleversant à la fois leur sentiment de sécurité, mais aussi le sens de leur parcours ou plus largement de leur vie.
Un environnement dépressogène
Soixante pour cent des jeunes rencontrés présentent un trouble dépressif et la même proportion évoque des idées suicidaires actuelles ou passées. Parmi ceux-ci, 40 % indiquent que ces idées ont émergé à leur arrivée en Europe ou en France. L’un précise qu’elles ont débuté à son arrivée dans le campement où il dort. Leurs propos soulignent la désillusion à laquelle ces jeunes font face dans le pays d’accueil, liée aux conditions de vie dans lesquelles ils sont, à la temporalité et à l’incertitude des procédures supposées leur assurer une sécurité et plus particulièrement en lien avec leur non-scolarisation. Le sentiment de perdre du temps et de ne pas construire leur avenir remet en question la possibilité d’un avenir meilleur. L’attente de leur reconnaissance de minorité isolée suspend la possibilité d’une scolarisation. Par ailleurs, même les MNA reconnus et dont la loi prévoit l’obligation d’une scolarisation n’ont, dans les faits, pour la plupart pas accès à cette possibilité9. Pour 22 % des jeunes rencontrés, les idées suicidaires sont plus avant en lien avec le décès de leurs parents, ce qui attire l’attention sur la clinique du deuil pour ce public. À noter que 47 % des jeunes de l’échantillon ont au moins un parent décédé. Enfin, l’un d’entre eux nous invite à poursuivre le travail d’information et de déstigmatisation des soins psychiques, rapportant avoir développé des idées suicidaires à l’hôpital psychiatrique car il pensait ne jamais en sortir. Des outils informatifs pourraient être développés à leur intention et systématiquement proposés lors des hospitalisations, sans quoi celle-ci induit des effets iatrogènes non négligeables.
Le changement de lieu de vie a été évoqué à plusieurs reprises comme ayant permis l’atténuation ou la suppression des idées suicidaires ; ces lieux de vie se sont révélés soutenants soit par leur caractère plus sécurisant soit parce qu’ils ont permis de réduire leur isolement.
Si l’hébergement à l’hôtel est généralement soutenant par son aspect plus sécurisant à l’opposé des campements, il est associé pour certains à un éloignement des liens sociaux qu’ils avaient commencé à développer, contribuant à un isolement délétère à leur bien-être. Cela est particulièrement le cas lorsque la reconnaissance de la minorité isolée des jeunes les conduit à être hébergés dans un autre département au regard de la procédure des clés de répartition. Ainsi, malgré les conditions de vie particulièrement dégradées de ces lieux, certains jeunes ont pu étonnamment décrire un apaisement à leur arrivée sur les campements en rencontrant d’autres jeunes parlant la même langue qu’eux.
Un environnement anxiogène
Enfin, si 33 % des jeunes rencontrés remplissent les critères diagnostic d’un trouble anxieux, nous notons que 60 % rapportent des sujets d’anxiété les impactant quotidiennement. Ces derniers sont de trois ordres, soit la famille, la procédure de reconnaissance de leur minorité isolée et la méfiance envers les autres. Les inquiétudes pour la famille concernent des craintes pour leur état de santé et leur contexte de vie, mais aussi pour certains la crainte de les décevoir ou de les inquiéter au regard de leurs conditions de vie actuelles. Il s’agit ici d’une forme de double peine de la précarité dans laquelle ils sont plongés : la vivre et la raconter constituent deux éléments de souffrance cumulés. Cela conduit une partie d’entre eux à dissimuler tout ou une partie de leur réalité à leurs proches. Les impacts de ces dissimulations ou mensonges sont à considérer puisque ceux-ci peuvent créer une distance au sein de la relation avec leurs parents – pour ceux qui ont encore des liens –, relevés dans la littérature comme un facteur de protection important pour leur santé mentale10. Les impacts sur le développement identitaire des jeunes sont également à envisager.
En ce qui concerne la procédure, les données recueillies mettent du sens sur un élément a priori surprenant relevé dans la littérature scientifique : l’attente et le fait d’être débouté sont identifiés comme des facteurs de risque psychopathologiques11, mais l’obtention d’un statut résidentiel n’agit pas pour autant comme facteur de protection de la santé mentale12. En effet, parmi les jeunes rencontrés, même celui qui a obtenu la reconnaissance de sa minorité isolée en première instance exprime une inquiétude importante concernant sa procédure de régularisation future. En effet, s’ils sont protégés pour les quelques années à venir au regard de leur statut d’enfant, l’atteinte de la majorité s’accompagnera de la nécessité d’être alors réévalué dans leur droit au séjour au titre de leur statut de migrant. Par ailleurs, le contexte de saturation des dispositifs de l’ASE semble rendre les ressources octroyées légalement par ce statut plus difficiles à obtenir dans les faits13, impactant dès lors le potentiel rassurant de cette reconnaissance une fois obtenue. Quelques-uns des effets concrets de la procédure sur la santé mentale des jeunes sont perceptibles dans les entretiens. Le plus spontanément et fréquemment évoqué par les jeunes est la dégradation de leur santé mentale depuis la remise à la rue survenue dès le retour négatif de leur première évaluation. L’anxiété générée par la procédure est également palpable dans l’état d’agitation rapporté par l’un d’entre eux dans les jours précédant son évaluation. Enfin, ils nous donnent à voir la manière dont cela impacte leur relation aux autres jeunes, produisant de nombreuses comparaisons, sentiment d’injustice, jalousie et critiques des uns envers les autres au regard de cette demande de reconnaissance. Pour certains, chaque obtention du statut par un jeune de leur entourage les renvoie à leur propre incertitude ou échec vis-à-vis de cette demande, réveillant l’anxiété et le désespoir associés. Enfin, la méfiance envers les autres est tout autant un effet des événements traumatiques vécus sur le parcours migratoire qu’une stratégie de survie développée et maintenue au regard de l’insécurité liée à leur situation de précarité actuelle. Le racisme quotidien qu’ils décrivent les conduit à craindre les interactions avec des inconnus. La peur des autorités et des risques encourus pour leur procédure tend à les rendre méfiants envers toute personne exerçant un pouvoir, dont les contrôleurs des transports en commun. Le fait de ne pas connaître parfaitement les lois du pays rajoute de l’anxiété quotidienne et leur donne davantage de volonté pour apprendre au plus vite afin de s’intégrer et d’éviter tout risque de problème.
Évaluer pour protéger ?
Au-delà des souffrances, ces jeunes nous ont donné à voir la manière dont certaines ressources (telles que la pratique du football, la participation à des cours de français, le fait de faire de nouvelles rencontres ou de fréquenter des lieux comme la bibliothèque) leur permettent de maintenir certaines dimensions de santé mentale positive indispensables pour faire face à un tel contexte. L’espoir, le sentiment d’appartenance, la connaissance et le développement de leurs forces et valeurs notamment persistent malgré l’adversité. Il apparaît alors essentiel de tenir avec eux ces dimensions, en ce qu’elles constituent à la fois des facteurs de protection, de résilience et de rétablissement. Leurs récits nous alertent sur la manière dont la procédure de reconnaissance de la minorité isolée produit des souffrances, sans pour autant être en mesure de protéger leur santé mentale lorsque ce statut leur est enfin accordé. Se demander s’ils sont enfants ou migrants pour savoir comment et de quoi les protéger crée précisément les conditions d’un environnement dangereux pour leur santé et leur santé mentale.
Notes de bas de page
1 Mission nationale mineurs non accompagnés. (2024). Rapport annuel d’activité 2023. Le rapport 2024 n’est pas encore publié à ce jour, ce qui ne permet pas d’actualiser plus avant ces données quantitatives.
2 Les jeunes de 13 à 15 ans représentent 31,2 % des MNA en 2023 contre 23,92 % en 2022. En 2023, 1 613 jeunes filles sont concernées par un placement contre 1 012 en 2022.
3 Cela représenterait 1 000 à 1 800 jeunes sur l’année 2023 au sein de la métropole de Lyon. Forum Réfugiés. (2024). Rapport d’activité 2023. Forum Réfugiés.
4 La recherche, dont les données illustrent cet article, s’est déroulée entre 2022 et 2025 en appui de l’expérimentation d’une équipe mobile santé mentale dédiée aux jeunes migrants isolés de la métropole de Lyon, portée par la fondation OVE. Orspere-Samdarra. (2025). Projet d’équipe mobile en santé mentale de la fondation OVE à destination des jeunes migrants. OrspereSamdarra.
5 Daniel-Calveras, A., Baldaquí, N., et Baeza, I. (2022). Mental health of unaccompanied refugee minors in Europe : A systematic review. Child Abuse & Neglect, 133, 105865.
6 Risque de mourir ou témoin de la mort de quelqu’un, victime ou témoin d’agression, abus, menaces physiques ou sexuelles.
7 Mission nationale mineurs non accompagnés. (2024). Rapport annuel d’activité 2023. Ministère de la Justice.
8 La formulation et l’ordre des questions de la SCID-5, couplé aux effets de comparaison de gravité « objective » des événements produit cet effet.
9 Unicef (2023). « Je suis venu ici pour apprendre. » Garantir le droit à l’éducation des mineurs non accompagnés. Unicef.
10 Höhne, E., Van Der Meer, A. S., Kamp-Becker, I. et Christiansen, H. (2022). A systematic review of risk and protective factors of mental health in unaccompanied minor refugees. European Child & Adolescent Psychiatry, 31(8), 115.
11 Jakobsen, M., Meyer DeMott, M. A., WentzelLarsen, T. et Heir, T. (2017). The impact of the asylum process on mental health: a longitudinal study of unaccompanied refugee minors in Norway. BMJ open, 7(6), e015157.
12 Höhne, E., Van Der Meer, A. S., Kamp-Becker, I. et Christiansen, H. (2022).
13 Mission nationale mineurs non accompagnés. (2024).