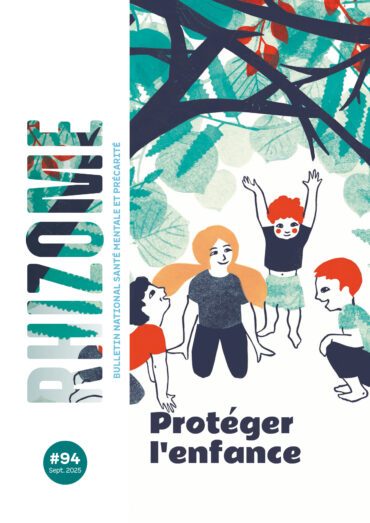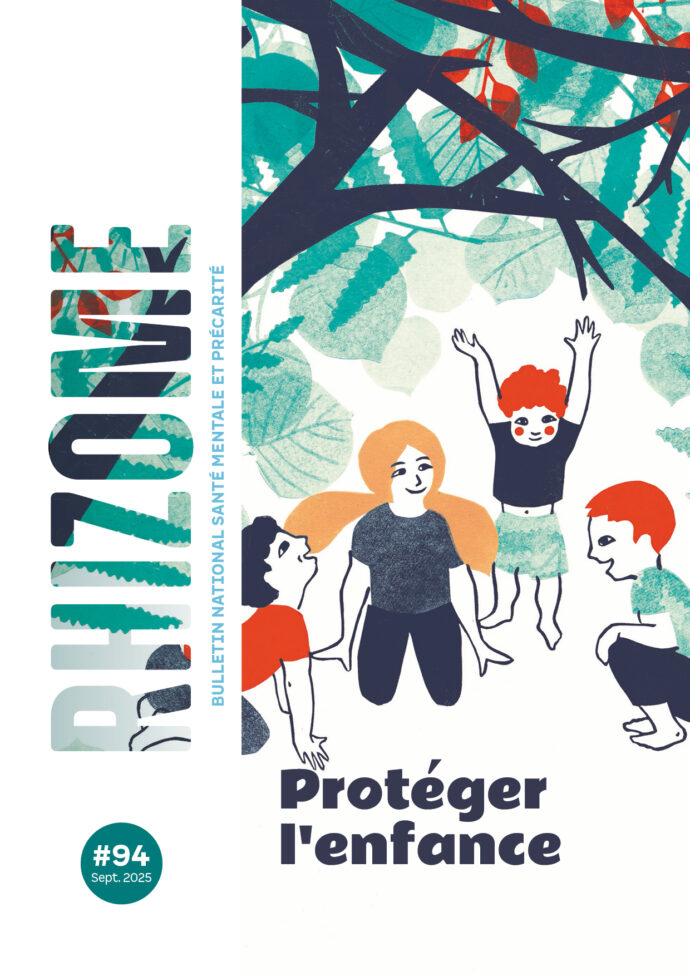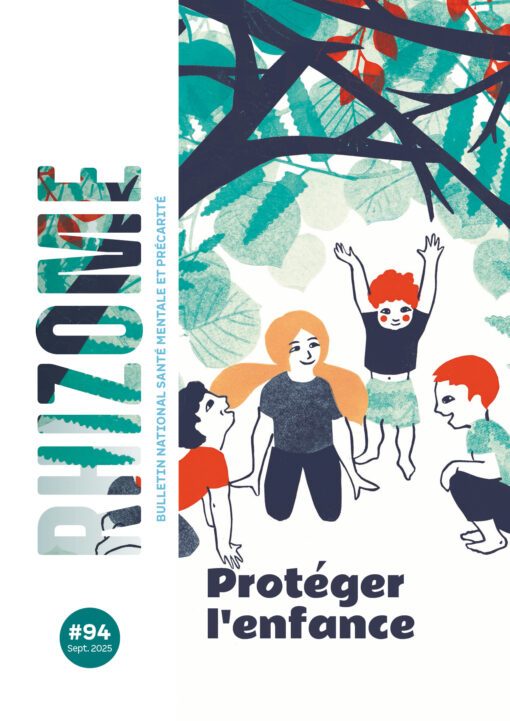Ce numéro de Rhizome est consacré non pas à la protection de l’enfance en tant qu’institution, mais bien plus largement à la protection des enfants. Qui protéger, qui protège et de quoi faut-il protéger ? Ce numéro porte une attention particulière à la diversité des âges et des jeunes concernés, à différents titres, par la précarité, la migration, l’accompagnement ou la sortie de l’Aide sociale à l’enfance.
Dénoncer les violences
Les connaissances sur le psychotraumatisme ont considérablement évolué. L’impact persistant des événements traumatiques sur le développement neurobiologique, émotionnel et relationnel est aujourd’hui bien documenté. Les risques sont notamment décuplés lorsque ces événements sont vécus dans les phases de développement de l’enfant et lorsqu’ils sont répétés.
Certaines théories et pratiques ont pu, par le passé, légitimer des comportements inacceptables en attribuant à l’enfant des désirs ou intentions d’ordre sexuel, projetant sur lui des représentations ou des désirs d’adultes. Il est essentiel de rompre aujourd’hui avec ces cadres de pensée et de reconnaître l’enfant comme un être à protéger de toute forme de sexualisation, qu’elle soit agie ou interprétée. Il est donc intenable de continuer à faire silence. Silence sur les violences qui traversent les institutions éducatives, sanitaires, sociales ou judiciaires. Silence sur les formes d’abus banalisées ou disqualifiées. Silence sur les complicités passives et les mécanismes de protection des adultes aux dépens des plus jeunes. Il est devenu urgent de ne plus justifier, ni minimiser, ni euphémiser la domination exercée par les adultes sur les enfants. L’autorité éducative, si souvent invoquée comme un cadre protecteur, peut tout autant servir de masque à des rapports de force inégalitaires, traversés par la violence. Car cette domination laisse des traces. Elle a des conséquences profondes et durables sur la santé mentale des enfants et sur ce qu’ils deviendront en tant qu’adultes. Les travaux sur les expériences d’adversité élargissent le spectre de ce qui peut faire violence au-delà des maltraitances explicites. Ils nous invitent aussi à considérer les violences psychologiques, le harcèlement scolaire, les assignations de genre ou les placements répétés.
Ces violences et leurs effets ne traversent pas seulement les enfants, elles affectent aussi celles et ceux qui, au quotidien, tentent de les protéger. Les professionnels de la protection de l’enfance, exposés à des situations de grande intensité émotionnelle, font face à un risque élevé de traumatisme vicariant. Reconnaître l’impact psychique de ces missions, c’est aussi une manière de soutenir leur engagement et de rappeler que prendre soin des enfants suppose aussi de prendre soin de celles et ceux qui les accompagnent.
Écouter les enfants
Protéger les enfants, c’est aussi les écouter. Cependant, dans les lieux de placement, leur parole est souvent jugée à l’aune de leur âge, de leur genre ou de leur vulnérabilité supposée, plus qu’elle n’est réellement entendue. Lorsqu’elle devient surplombante, la logique de protection peut également se retourner contre eux : elle invalide ce qu’ils disent de leur quotidien, de leurs besoins, de leurs désirs. Se placer à hauteur d’enfant c’est reconnaître leur dignité, leur capacité à faire expérience, mais aussi que leur parole éclaire autrement les failles du système de protection.
Toutefois, écouter les enfants ne suffit pas à les protéger. Il est tout aussi crucial d’ouvrir des espaces d’écoute pour les adultes en proie à des souffrances psychiques ou à des pensées violentes, y compris sexuelles. Penser la protection de l’enfance en termes de santé mentale, c’est reconnaître que certaines personnes cherchent à ne pas nuire, mais peinent à trouver un espace pour dire. La répression seule ne protège pas. Soigner les adultes en souffrance, c’est aussi protéger les enfants, et donc un enjeu de santé publique.
Penser des politiques de santé publique
La santé mentale des enfants et des jeunes ne relève pas seulement d’une approche clinique. Elle appelle une politique publique qui respecte leur rythme, évite les ruptures, stabilise les lieux de vie et reconnaît leurs capacités. Les situations d’enfants et de jeunes à la rue révèlent moins une défaillance logistique qu’une orientation politique : celle de hiérarchiser les droits de l’enfance au lieu de les garantir à toutes et tous. Gardons notre malaise et notre colère, c’est la preuve que nous résistons encore à l’insoutenable normalisation des enfants à la rue. Penser les procédures en ayant une attention toute particulière à leurs effets sur la santé mentale des individus permettrait de déplacer les lignes, cela engagerait à transformer les politiques migratoires, de l’enfance, mais aussi de lutte contre la précarité afin de les rendre davantage protectrices, stabilisantes et soucieuses du développement psychique des jeunes.
Reconnaître leurs ressources
Les enfants ne sont pas que vulnérables. Leur capacité à jouer, à apprendre, à créer du lien entre eux et à se projeter dans l’avenir témoigne de leurs ressources. Écouter l’enfance, c’est écouter ce qu’elle nous dit du monde que nous construisons : sa vulnérabilité nous oblige, sa force nous appelle et son avenir dépend de notre courage à la protéger.