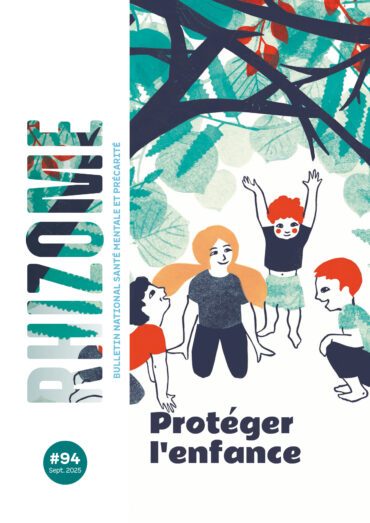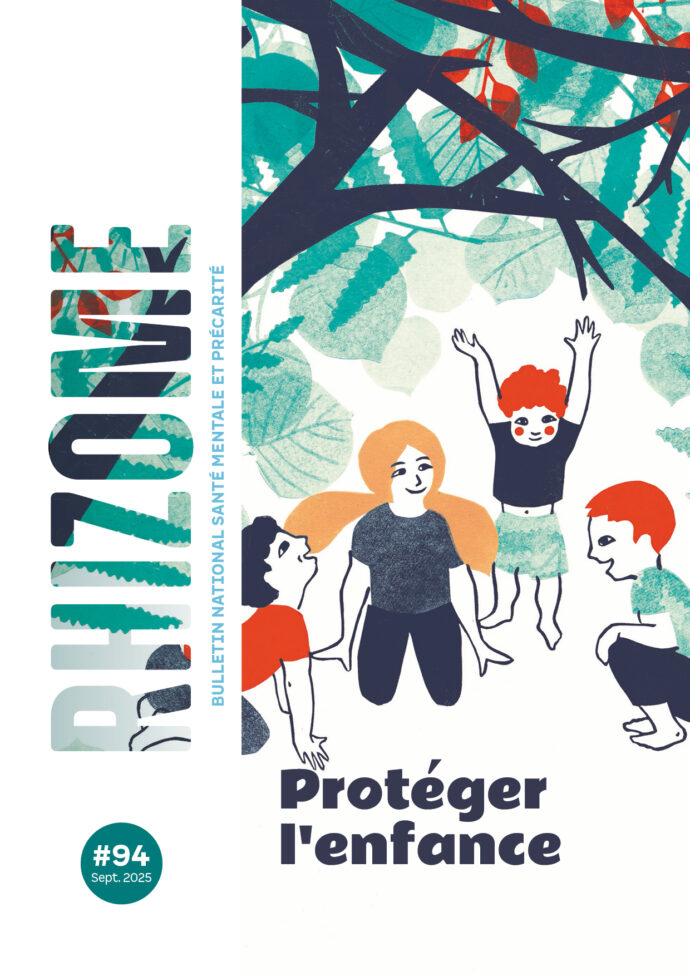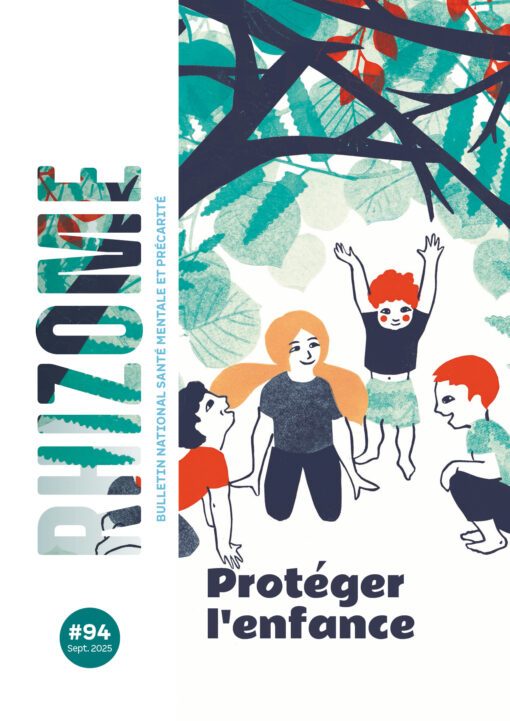La parole des enfants et des adolescents placés en protection de l’enfance peut facilement être confisquée au prétexte de la protéger. Qu’il s’agisse des adultes en charge de leur éducation dans les lieux de placement ou de ceux qui s’intéressent à la production de connaissances sur ces institutions, à l’instar de chercheurs, entendre la parole des jeunes sur ce qui les concerne en premier lieu, leur point de vue sur le quotidien institutionnel, leurs aspirations et désirs pour l’avenir, demeure difficile car de multiples contraintes pèsent sur les conditions d’une écoute attentive des récits d’usagers d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Cette problématisation est née d’une recherche sociologique menée entre 2021 et 2024, développée à partir d’une enquête ethnographique au sein de trois lieux de placement de la jeunesse dans le cadre d’une thèse de doctorat1. Cet article entend montrer la manière dont les voix des jeunes placés en protection de l’enfance peinent à se faire entendre par les adultes qui les entourent.
Accéder à la parole juvénile dans les lieux de placement de la protection de l’enfance
Pour les chercheurs en sciences sociales, enquêter auprès de mineurs protégés implique de mettre en œuvre une démarche méthodologique et éthique particulière, répondant aux impératifs habituels (tels que l’information des participants, le recueil du consentement nominatif ou la préservation de l’anonymat), en plus d’une exigence visant à recueillir l’autorisation des représentants légaux à ce que leurs enfants participent à une recherche. Cette exigence soulève une contradiction fondamentale : cela revient à conditionner la participation des jeunes à une recherche qui les concerne directement à l’accord de parents pour partie auteurs de violences envers leurs enfants. L’existence d’une telle exigence demandée par des comités d’éthique ou des délégués à la protection des données personnelles ne devrait pourtant pas conduire à invisibiliser des pratiques incarnées de longue date par les sociologies qualitatives, se référant à un ensemble de gestes et de réflexions conduits au plus près des enquêtés pour construire un cadre éthique in situ2. En outre, ce positionnement entend nourrir les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) en matière de production de connaissances sur l’expérience de la prise en charge de mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales. La faisabilité de ces travaux se heurte aujourd’hui à une contrainte majeure : l’obligation de recueillir le consentement des deux titulaires de l’autorité parentale avant tout entretien avec les jeunes volontaires. Pourtant, le double consentement parental s’avère contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, étant documenté qu’un parent impliqué dans des violences ne souhaite pas que ces dernières soient parlées et pensées avec des tiers. Cette exigence priverait alors les mineurs de la possibilité d’exprimer leur point de vue dans le cadre de recherches respectueuses de leur parole.
La parole d’adolescents « en danger »
Tout d’abord, ce ne sont pas n’importe quels jeunes qui voient leur parole remise en cause par des adultes, eux aussi issus de certaines catégories. Ces adolescents ont été placés par un Juge des enfants, en raison de « difficultés risquant de mettre en danger [leur] santé, [leur] sécurité, [leur] moralité ou de compromettre leur développement physique, affectif, intellectuel et social3 ». Ces difficultés peuvent provenir, d’une part, des adolescents eux-mêmes lorsque les professionnels de l’enfance en danger considèrent qu’ils se mettent en danger par leurs comportements (tels que des fugues ou la consommation de drogues, par exemple) ; d’autre part, de l’environnement familial des jeunes, et c’est alors leur famille qui est considérée comme la source principale du danger. Parmi les adolescents enquêtés, le (risque de) danger était caractérisé par la coexistence de plusieurs facteurs, soit la consommation d’alcool ou de drogues par leurs parents, des absences scolaires répétées, des difficultés d’accès aux soins et à l’hygiène, la maladie psychique d’une mère couplée à l’incarcération d’un père, ou encore le fait de s’être trouvé au cœur d’un conflit parental. La situation de danger était ainsi pleinement avérée lorsque les mineurs avaient des marques de coups et blessures sur le corps, lorsqu’ils faisaient état de violences conjugales au sein du foyer, de sévices corporels ou encore de violences sexuelles.
Ensuite, ce ne sont pas n’importe quelles dimensions de la vie de ces adolescents placés qui font l’objet d’une attention soutenue de la part des adultes qui les prennent en charge, mais bien celles caractéristiques d’une personnalité propre qui constitue singulièrement un individu. Soustraits à la garde de leurs parents, ces jeunes sont contraints par le pouvoir judiciaire à habiter les lieux du placement de manière exclusive, bien qu’a priori temporaire. Les paroles qu’ils y prononcent, les choix qu’ils y revendiquent et les gestes qu’ils y accomplissent sont alors ceux du privé, du domestique : ils ne peuvent exister ailleurs qu’entre ces murs, sous le regard quasi permanent des professionnels de l’enfance, mais aussi des autres jeunes placés.
Or, quotidiennement, des éducateurs spécialisés, des chefs de service, des directeurs d’établissement, des psychologues ainsi que, dans une moindre mesure, des infirmières, des maîtresses de maison et des surveillants de nuit prennent en charge, valident et discréditent le point de vue de ces adolescents sur leurs pratiques intimes, soucieux de les accompagner au mieux. Dans ces situations typiques du privé, les adolescents tentent alors de faire valoir leurs choix – s’habiller de telle façon, manger tel aliment, visiter tel proche, choisir telle orientation professionnelle – tout en faisant entendre leurs voix.
La parole des jeunes dans les décisions ordinaires qui les concernent
Ce sont les adultes – principalement des éducateurs – qui sont en position de pouvoir « agiser » les jeunes bénéficiaires, en les percevant comme des individus dont les capacités cognitives, physiques et affectives ne sont pas « encore » matures. Ce rapport asymétrique, fondé sur la minorité et la vulnérabilité, justifie un traitement différencié des aspirations des jeunes, de leurs besoins et, plus concrètement encore, de leur accès à des lieux, des objets, des goûts, au motif de leur âge. Celui-ci induit des représentations et des pratiques limitantes associées aux enfants : elles convoquent le manque, la faiblesse et l’incapacité tant juridique – le mineur est un incapable – que psychique et physique4. Il s’agit là, en effet, d’une caractéristique des
représentations sociales de l’enfance qui circulent dans les lieux de placement de la jeunesse : celle du caractère inaccompli de l’individualité de ces jeunes qui s’illustre dans le raisonnement socioéducatif à l’oeuvre, fortement structuré par une pensée psychologique et exclusive de l’enfance5. Ainsi, lorsque les adolescents veulent quelque chose, insistent pour adopter une pratique particulière qui s’inscrit dans leur quotidien immédiat, ils doivent
composer avec les impératifs d’éducation et de protection qui sont à la base du mandat d’intervention de leurs éducateurs. De l’hygiène corporelle jusqu’au choix des fréquentations, les pratiques éducatives auxquelles les éducateurs prennent part dans la prise en charge des jeunes placés sont inépuisables. Ce faisant, les éducateurs des lieux de placement fondent leur intervention sur la base de l’autorité que leur confère leur statut d’adulte face à des bénéficiaires mineurs. Or, si celle-ci est rarement revendiquée aussi clairement, elle se cristallise en fait au travers de gestes, de mots, de discours éducatifs énoncés et d’actions opérées à l’égard des comportements juvéniles, comme lorsqu’il s’agit de recadrer l’attitude d’une jeune fille de 17 ans qui, selon les termes de son éducatrice6 : « veut devenir femme trop vite » et qui a bien été « rappelée à son statut d’adolescente ». Les professionnels peuvent
également procéder à un contrôle accru de l’hygiène corporelle des garçons en comptant le nombre de sous-vêtements dans le panier à linge sale à la fin de la semaine pour vérifier s’ils se sont bien changés, au motif que, je cite un éducateur7 : « On part de loin avec eux. Il faut tout reprendre, comme des enfants ». Ou bien encore, ils peuvent interpréter l’intérêt ou le désintérêt des adolescents à l’égard des filles, comme dans les propos de ce chef de service du séjour de rupture à propos d’un jeune8 : « Il ne faut pas considérer que ces jeunes à 15 ans ont le même âge que des jeunes de 15 ans. Haroun, par exemple, il est très en retard pour son âge, physiologiquement et physiquement. Haroun ne s’intéresse pas aux filles. Les autres pensent que c’est parce qu’il serait homo, mais sincèrement, moi, au vu des observations que je fais, je ne crois pas. Il est seulement très en retard. » En somme, si l’âge est bien un opérateur pratique à travers lequel les comportements, discours et pratiques juvéniles sont interprétés, il est en réalité loin d’être le seul. Ce sont plus particulièrement les effets qu’il produit sur l’individualité des jeunes placés qui intéressent ce propos, à l’endroit précisément
des marges de manœuvre dont ces adolescents disposent pour construire et accomplir des
pratiques intimes engageant notamment leurs corps et les relations aux autres. Les professionnels mobilisent, en ce sens « des normes sociales définissant ce qu’il est convenable de faire selon son âge9 » et selon son sexe, mais également ce qu’il est convenable de dire ou d’entendre.
Conclusion
Historiquement suspecte10, la parole de ces enfants s’inscrit dans un régime fait d’un ensemble de normes, de règles et de représentations visant à régir sa portée, sa véracité, sa fiabilité et in fine, sa valeur. S’il s’observe à l’échelle d’un rapport de pouvoir de la parole des adultes sur celle des enfants, il est aussi perceptible dans l’accomplissement permanent et méthodique de gestes, d’attitudes et de jugements attribuant une valeur à la parole juvénile,
selon les situations et les acteurs en présence. Ce régime s’inscrit ainsi dans une configuration historique dans laquelle les adultes ont à juger des récits enfantins à l’endroit précisément de mineurs considérés comme étant vulnérables et en identifiant ce qui relève du dicible ou de l’indicible.
Notes de bas de page
1 Westeel, F. (2024). Intimités sous contraintes. Ethnographie d’une jeunesse placée en protection de l’enfance [thèse de doctorat]. École normale supérieure.
2 Cefaï, D. (2010). L’engagement ethnographique. École des hautes études en sciences sociales.
3 Article L. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles.
4 Piterbraut Merx, T. (2021). L’émancipation des mineur·e·s, une prise en main ? Délibérée, 13(2), 51-58.
5 Bresson, M. (2012). La psychologisation de l’intervention sociale : Paradoxes et enjeux. Informations sociales, 169(1), 68-75.
6 Extraits du journal de terrain du 24 novembre 2021, au sein d’une maison d’enfants à caractère social.
7 Extraits du journal de terrain du 9 mars 2021, au cours d’un séjour de rupture.
8 Extraits du journal de terrain du 28 avril 2021, au cours d’un séjour de rupture.
9 Rennes, J. (2020). Conceptualiser l’âgisme à partir du sexisme et du racisme. Le caractère heuristique d’un cadre d’analyse commun et ses limites. Revue française de science politique, 70(6), 725-745.
10 Blanchard, V. (2019). Vagabondes, voleuses, vicieuses : adolescentes sous contrôle, de la Libération à la libération sexuelle. Éditions François Bourin.