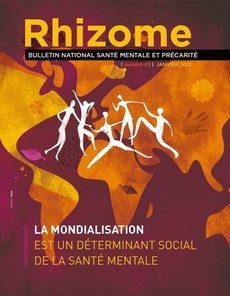Les organisations humanitaires interviennent dans un contexte marqué par la mondialisation et participent de fait à la diffusion de normes et de standards. Au Rwanda, la société post-génocide est marquée par la perte des repères et des valeurs fondatrices. Depuis 1995, plus de 160 ONG sont présentes puisque tout est à reconstruire ou à réinventer. Entre désir de venir en aide, obligation de réconciliation et propension à diffuser des modèles venant d’ailleurs, nous verrons que la relation entre ONG et population rwandaise ne se tisse pas sans ambiguïtés.
La question des humanitaires n’est pas aisée à aborder car les ONG constituent un monde divers. Entre ceux qui interviennent dans l’urgence, dans des situations de crises majeures pour sauver des vies, ceux qui agissent pour le développement qu’on espère durable, ceux qui œuvrent pour la démocratie ou pour les principes moraux, le discours ne peut être univoque.
Pour réagir à cette problématique je m’appuierai sur mon expérience de présidente-fondatrice de Subiruseke, association d’aide aux veuves et orphelins du génocide des Tutsi du Rwanda, de chargée d’appui en santé mentale d’un programme développé par Ibuka en partenariat avec Médecins du Monde. Ibuka Mémoire et Justice a, entre autres attributions, celle d’assurer une assistance psychosociale aux rescapés du génocide, et c’est dans ce cadre que ce programme intervient.
Je rappelle que les humanitaires dont il s’agit ici interviennent dans un contexte post-génocide. En 1995, le Rwanda est un pays figé dans l’horreur. Toutes les bases qui fondent la société sont détruites, les valeurs traditionnelles n’ont plus aucune fonction. La transgression des tabous les plus fondateurs à très grande échelle est ce qui a fait la fierté des génocidaires. On est dans un monde à l’envers : les liens familiaux, les alliances par le mariage n’ont plus aucune signification puisqu’un oncle ou une tante n’ont pas épargné les neveux, les nièces, sous prétexte qu’un des parents est issu de l’ethnie à exterminer.
Le contexte post-génocide est donc un contexte sans aucun repère, un contexte dans lequel les institutions dont la tâche primaire était de soigner, de protéger, y compris les églises, ont joué un rôle actif dans le génocide, en ont été les complices, ou sont restés à l’écart, indifférents au sort des victimes.
Le contexte demeure donc marqué par la destruction des rapports sociaux, la perte profonde de la confiance à tous les niveaux : interpersonnel, communautaire, institutionnel.
Tout est à reconstruire. On peut dire, non sans ambivalence, que le pays a besoin de l’aide des ONG. Il a besoin de « cet autre » dans lequel il ne croit plus, et que les humanitaires trouvent là un terrain pour se déployer. Certains vont jusqu’à dire que le Rwanda est un véritable laboratoire vivant. Effectivement les conditions sont réunies pour que tous trouvent là une possibilité d’expérimenter leurs méthodes dans différents secteurs. Cette constatation qui peut paraître cynique, n’enlève rien à la volonté et au désir réel de venir en aide à la population en souffrance.
En 1995, on recensait déjà 160 ONG intervenant dans tous les domaines. On était en situation d’urgence et chacun cherche à parer au plus pressé. Dans le domaine de la santé mentale, on verra fleurir une multitude de méthodes d’intervention, des formations sur la prise en charge de la crise traumatique données à la va-vite aux futurs conseillers en traumatisme. Il fallait faire quelque chose face à l’ampleur des dégâts et face à ce temps figé où seul fait écho le silence de la mort. Il fallait « l’Autre » de l’extérieur, en capacité de penser et de secourir ; l’autre différencié, ni bourreau ni victime, pour reprendre les mots de Janine Altounian. Les humanitaires eurent donc un rôle important. En 2009 on en dénombrait plus de 800. Seulement on constata très vite un décalage entre les attentes de la population qui, j’en conviens, n’avait pas la capacité de bien évaluer ce dont elle avait besoin, et les réponses apportées.
Ester Mujawayo, travaillait pour Oxfam, dans son livre « Survivantes : Rwanda dix ans après », elle nous donne deux exemples de sa rencontre avec les humanitaires :
● Des psychologues d’Oxfam sont envoyés pour un débriefing, qui pour une fois est offert aux nationaux (ce genre de service n’est habituellement réservé qu’aux seuls collègues expatriés). Les psychologues voulaient les écouter mais à leur manière : ils voulaient entendre leurs rêves et cauchemars. Ester et ses collègues avaient honte de dire qu’ils dormaient bien, qu’ils ne faisaient pas de cauchemars. Ils n’avaient peut-être pas encore eu le temps qu’il fallait pour en faire. De plus, ils avaient besoin qu’on écoute leur vraie demande du moment, à savoir qu’on leur prête la Jeep de l’équipe pour sillonner les camps à la recherche des éventuels membres de leurs familles survivants. Les psychologues d’Oxfam ont considéré que ces nationaux ne prenaient pas au sérieux leur travail. « Je ne voulais quand même pas m’inventer des rêves que je n’avais pas » ! dit Ester Mujawayo. On est là au cœur de l’incompréhension et de la non-rencontre avec l’autre.
● Dans un deuxième exemple, elle relate une réunion de coordination de l’UNICEF, où les ONG qui se sont partagé les différents domaines discutent de leurs méthodes d’intervention. L’UNICEF était chargé de la réhabilitation psychologique ; une responsable de l’action explique sa méthode : « écouter les enfants, les faire dessiner, repérer leur traumatisme puis traiter ce traumatisme par les entretiens psychologiques ». Ester, sociologue, n’est pas d’accord, elle pense qu’on ne peut pas évacuer les conditions sociales : ces enfants sont orphelins et ont faim. Elle propose donc qu’on prenne en compte les deux dimensions à la fois, car elle pense qu’un enfant qui a faim ne parlera ni de ce qu’il a vécu, ni de son traumatisme. La responsable lui demande alors quel est son métier, pour lui rétorquer l’instant d’après : « Excusez-moi Madame, mais vous n’êtes pas professionnelle, vous ne pouvez pas comprendre ». Tout le long de ces 17 ans qui nous séparent du génocide on réentendra souvent ce genre d’arguments : du côté des nationaux, on ne sera jamais assez ceci ou cela pour avoir un droit d’opinion. Pourtant, et c’est paradoxal, des responsables des ONG s’entourent toujours de nationaux sensés être leur homologues, voire les initiateurs des actions ayant une fonction de légitimation.
On constate combien il est difficile de se départir des logiques d’intervention et des modèles professionnels dont on est héritier. Mais faut-il s’en déprendre ? Je ne pense pas, car ces cadres à penser restent importants, particulièrement dans un tel contexte.
Il me semble qu’il faut surtout prendre le temps, de se poser des questions sur la manière dont on agit sur l’autre, – le pourquoi est souvent clair- ; ce qui l’est moins, ce sont généralement les effets pervers qui s’infiltrent dans les actions humanitaires, a fortiori quand on se retrouve dans des contextes où la culture ne peut plus faire contenant et où les idées véhiculées risquent d’être saisies par toute une société pour en faire de nouvelles croyances.
Prenons la notion de « sensibilisation » qui a été véhiculée et s’est bien implantée au Rwanda : sensibilisation des populations pour reconnaître les symptômes de la crise traumatique, sensibilisation des femmes victimes de viols quant à l’importance de témoigner, sensibilisation à la réconciliation, au pardon. Autant d’incitations qui prennent des allures de normes sociales pouvant s’avérer violentes pour les victimes… Il est certes essentiel d’avoir au sein de la population des personnes capables de repérer, aider et orienter les sujets en souffrance, que les femmes puissent sortir de la honte d’avoir été violées, qu’elle puissent en parler pour que justice se fasse, que la société qui a été divisée par le génocide travaille à sa reconstruction et à la réconciliation… Tous les acteurs s’accordent sur ces impératifs.
Mais que se passe-t-il quand ces modèles se généralisent et sont introjectés, lorsqu’ils ont été avalés tel quels, barrant toute possibilité de se penser autrement, provoquant ainsi des problématiques toutes aussi compliquées que la rupture des liens et la stigmatisation ?
Concernant le témoignage, je reprends les mots de Dr Naasson Munyandamutsa, psychiatre rwandais qui précise, au cours d’une formation des psychologues de l’association Ibuka, que témoigner est un risque, « même si partager sa souffrance peut être un soulagement, le témoin doit se situer sur un langage commun, cependant subversif, transgressif. Dans la vie banale, rappelle-t-il, une personne logique ne décrit pas dans le détail ce qu’elle voudrait oublier. Pour toutes ces raisons la société ne devrait ni sensibiliser ni appeler au témoignage. Il faudrait pouvoir témoigner quand le temps de chacun advient, il faudrait laisser le temps d’imaginer des mots écrans qui protègent le sujet et son auditoire ; trouver un lieu d’intimité pour déposer son témoignage ». Or au Rwanda les ONG, mais aussi les instances gouvernementales, n’ont eu de cesse d’appeler les femmes à témoigner, sans prendre en compte les conséquences au quotidien d’un tel acte. On a regardé le côté face de la médaille mais on a oublié son envers.
Il en va de même pour le mot trauma qui se trouve sur toutes les lèvres : on est très étonné de l’entendre jusqu’au fin fond de la campagne rwandaise. Alors qu’un conflit assez intense opposait une vielle dame et son fils, la réponse donnée fut : « c’est le trauma qui le fait parler, il faut le laisser, il ne faut pas l’énerver ». Les interlocuteurs avaient appris des formateurs d’une ONG réputée, qu’on devait en pareille situation repérer le déclencheur et l’éloigner de la personne en crise… Dans ce cas, c’était la mère qu’il fallait éloigner. Jadis, quand un fils adulte manquait de respect à sa mère, le recours était le conseil de famille. Aujourd’hui, ce vide familial est compensé par des mots et des actes creux, qui ne font pas forcément sens, mais ont au moins le mérite dans l’immédiat de déconflictualiser la situation, tout en élargissant les fissures de liens sociaux déjà assez ténus.
Suite à la réflexion de Guy Laval, (2002), qui écrit que « Le fonctionnement psychique du sujet s’éteint lorsque la société ne lui offre plus de conflictualité à l’intérieur d’elle-même », Marie-Odile Godard (2011) nous rappelle que ce qui s’est passé au Rwanda, c’est bien une déconflictualisation progressive de cette société par la colonisation. Les modalités de reconstruction devraient-elles suivre cette même voie de la déconflictualisation ? Cette question reste valable pour tous les acteurs humanitaires qui œuvrent pour la réconciliation et le pardon. Il est important de constater la façon dont ces valeurs modifient les rapports sociaux entre les ONG et leurs bénéficiaires. Ainsi pour prétendre à une aide, les associations adaptent leurs objectifs aux attendus de ces dites ONG, elles doivent faire apparaître ces mots qui sont le passeport ouvrant au financement.
Aujourd’hui plusieurs ONG rassemblent des familles des bourreaux et celles des victimes dans des projets communs par le biais de différentes méthodes sociales, thérapeutiques, communautaires etc. On constate que les bénéficiaires de ces programmes ne sont pas mus par l’adhésion à l’objectif, mais bien par la pauvreté. Ces programmes donnent accès aux projets générateurs de revenus ou dispensent une petite indemnité aux participants.
Dans les groupes de soutien psychologique des rescapés mis en place par Ibuka-Médecins Du Monde, nous entendons régulièrement un discours ambivalent des personnes qui disent « je suis en paix, j’ai pardonné aux bourreaux de ma famille, nous avons fait partie de tels projets, il a cultivé mon champ, j’ai cultive le sien, tout va bien entre nous ». Mais au cours de la même séance cette personne dira aussi : « de toutes les façons ils ne nous aiment pas, ou si seulement ils disaient où ils ont mis mes enfants ». On entend bien une réconciliation ou un pardon construit sur une absence de dialogue de fond et qui constitue une façade. Ce genre d’action donne aux humanitaires le sentiment d’avoir fait quelque chose, ce qui aide à faire taire les angoisses que génère la rencontre avec des situations aussi destructrices que celles du Rwanda.
On voit d’un côté des humanitaires avec des méthodes réunificatrices, de l’autre des humanitaires avec des méthodes isolatrices faisant souvent fi du groupe ou de la communauté d’appartenance : enfants des rues, femmes vivant avec le VIH sida…Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur les programmes qui refusent d’aider ces femmes au sein des associations auxquelles ils appartiennent, et qui leur demandent de se regrouper en fonction de ces néo-identités. On aurait aussi beaucoup à dire sur les exclusions provoquées par l’appât du gain au sein de ses associations dont les membres se chargent eux-mêmes de faire la chasse à ceux qui n’ont pas le droit de prétendre aux aides.
Faudrait-il pour autant ne pas mettre en place des dispositifs spécifiques ?
Je ne suis pas en train de dire qu’il y ait une façon de faire meilleure qu’une autre. J’insiste sur l’importance de disposer de temps pour penser les effets de ces dispositifs et pouvoir les réajuster au fur est à mesure ; sur l’importance du partage des valeurs : qui est une mise en commun et non pas une position de l’humanitaire qui se penche sur la culture de l’aidé dans une posture « ethno quelque chose » lui permettant de mieux tenir compte des usages locaux. J’insiste sur l’importance de laisser une place à l’essai, à la construction-déconstruction-reconstruction des programmes.
Il s’agit là d’une question de présence, être présent dans la situation, dans un face à face où chacun interroge et discute les valeurs. Il s’agit d’abord d’une coexistence, de l’acceptation de la différence, avant de se laisser dissoudre, transformer, pour co-créer ensemble de la nouveauté.
On voit bien là qu’on est dans une position qui porte en elle son lot de violence, car elle confronte à l’altérité, à la culture de l’autre ; elle confronte les valeurs propres à l’étrangeté de celles de l’autre. Elle propose de laisser une part à l’incertitude, à la déconstruction des présupposés qui conduisent souvent à confondre l’environnement et la représentation qu’on en a.
C’est, à mon sens, en laissant cet espace pour « l’agressivité créatrice », qu’on peut sortir des modèles qui canalisent des rapports historiques de domination, dans lesquels les uns, « ceux du Nord », imposent leurs valeurs, tandis que les autres, « ceux du sud », incorporent ce qui vient du nord comme une valeur absolue, souvent poussés par la précarité, parfois par opportunisme économique, validant ainsi ce proverbe rwandais qui dit : « celui qui ne sait pas faire autrement se contente d’être docile ».
Cette réflexion s’enrichit d’une expérience de six années au sein du programme Médecins Du Monde-Ibuka, où nous avons mis en place un comité de pilotage « double- culture » composé par les membres d’Ibuka et de Médecins Du Monde. Il s’agit d’un espace transitionnel dans lequel sont confrontées et discutées nos idées, nos positions, nos incohérences. Ce choix fait par Médecins Du Monde est très difficile, il étire le temps, nous amène à ajourner des projets, à faire face aux rapports de force. C’est au sein de ce comité de pilotage que les points de blocage sont cristallisés et traités. Cet espace devient un espace créatif si on arrive à surmonter les blessures narcissiques que cela inflige. C’est un travail long, forcément conflictuel, mais qui permet à chaque acteur de trouver sa juste place pour faire émerger une culture commune qui, pour autant, n’efface pas les différences.