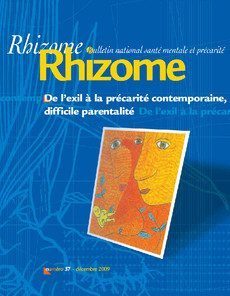En amont de toute définition positive, l’usage de la notion de parentalité notifie qu’être parent ne va plus de soi : on ne l’est plus seulement juridiquement et/ou biologiquement, mais on le devient ; avec un fort mouvement des politiques publiques pour soutenir, restaurer et protéger des capacités parentales émergeant sur fond d’impuissance, d’incapacité, voire de toxicité pour les enfants.
Dans ce contexte, la relation parent-enfant se présente souvent sous la forme paradoxale d’un monde à l’envers de celui auquel on s’attend.
Ainsi, le seul titre de Jacques Barou, déjà évocateur de cette inversion : désarroi des parents, compassion des enfants, indique la parentalisation des enfants : ils sont d’emblée intégrés dans une communauté scolaire, alors que les parents demandeurs d’asile se retrouvent plus isolés, moins aptes à l’apprentissage linguistique, comprenant moins bien les règles de la société d’accueil, fragilisés par leur propre parcours. Ainsi, saisissons-nous le sens de la « vocation » médicale de cette petite fille algérienne de cinq ans : « je voudrais devenir médecin, plus tard, pour soigner papa et maman. Maman pleure, Papa est triste ».
Mais pour rendre compte du désarroi parental, il est aussi nécessaire de comprendre le cadre juridique auquel les demandeurs d’asile sont soumis en tant que parents. Certes, le Conseil d’Etat, dans son célèbre arrêt GISTI du 8 décembre 1978, affirme pour les étrangers « le droit de mener une vie familiale normale », affirmation consolidée par le Conseil Constitutionnel en 1993, puis, en 1998, par le Droit des étrangers inspiré de l’article 8 dela Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cependant, surtout depuis ces dix dernières années, la législation française ne cesse d’insister sur une parentalité a priori suspecte de fraude et qui doit se justifier. A titre indicatif : le concubinage des étrangers ne donne aucune légitimité aux enfants qui en sont issus, contrairement aux ressortissants français ; et pour régulariser leur situation, les parents sans-papiers doivent apporter la preuve qu’ils contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant…, alors même que le sans-papiers n’est pas autorisé à travailler… Les juristes Christophe Daadouch et Zouhair Aboudahab insistent sur ce point : l’adoption étant prohibée par le droit musulman, la coutume de la « kafala », ou recueil institué d’enfants orphelins ou pauvres, n’est pas reconnue en ce qui concerne les prestations familiales ; si on peut comprendre la difficulté de ce dernier point, on en mesure aussi les effets.
Comment, dès lors, la situation de parentalité est-elle vécue subjectivement, et à quelles pratiques de soutien donne-t-elle lieu ?
Nicolas Meryglod et Valérie Colin, chercheurs cliniciens à l’Onsmp-Orspere, ont été sollicités par un groupe de bénévoles de RESF pour les aider…à aider des parents en situation de demande d’asile à rester parents. Pendant plus d’un an, seules des mères sont venues.
De fait, la place du père court tout au long de ce dossier : s’il ne disparaît pas nécessairement, sa place reste difficile à cerner selon les normes du pays d’accueil. Pour les parents, toute une panoplie de sentiments négatifs, tels la honte, la culpabilité ou les interdits de penser joue, en sus des problèmes de statut, jusqu’à renoncer, parfois, à une parentalité active, dans un paradoxe déchirant où le sentiment de toute impuissance prend la place de la toute puissance : pour être un bon parent, il faudrait ne pas s’occuper des enfants…qui se parentalisent ! Nos chercheurs ont aussi mis en évidence qu’une affiliation effective (possible, permise) au groupe social renforce les liens de filiation, d’où la pratique du soutien groupal en institution (Séverine Masson) ; on le comprend notamment à partir du cas d’une famille où la mère a été violée devant son mari et son fils, situation insoutenable qui attaque les liens d’affiliation, liens enchevêtrés et fondateurs des liens de filiation. On note, dans le cas raconté, que le père ne participe pas aux ateliers mais y dépose sa femme et son fils « comme son bien le plus précieux » : son absence aux séances n’est donc pas un désinvestissement..
Au contraire, dans le texte de Claire Mestre et al, on voit le père disparaître à l’aéroport, en provenance du Nigéria, et la jeune femme enceinte se retrouver seule. Elle sera abusée sexuellement au 6ème mois de la grossesse ; son bébé, inconsolable, pleurera les larmes de sa mère et vivra sa frayeur. Intervention exemplaire d’une équipe attentive à tous les aspects d’une situation complexe.
Sur un autre plan, Gilbert Coyer, par sa pratique des consultations familiales pour enfants africains et leurs familles, et Olivier Douville, par sa connaissance de l’errance des mineurs en Afrique de l’Ouest, insistent tout deux sur l’importance du passage et des passeurs : passage d’un trauma immobilisateur à un retour fluide du mouvement de la vie, grâce aux passeurs de symptômes (les enfants), grâce aux thérapeutes (éventuellement assistés de médiateurs culturels), et grâce aux passeurs profanes rencontrés sur les lieux du drame et de l’absence, dont les paroles résonnent comme des oracles prescrivant de retourner dans le monde des vivants. On lira à cet égard les exemples saisissants de Citseko et de l’adolescente de Bamako.
Ici, les connaissances en géopolitique et en anthropologie, évolutives et mouvantes, sont souvent indispensables, non moins que d’accepter de ne pas savoir, de soutenir en silence l’effroi du trauma qui revient, et d’être modifié par le savoir et la coutume de l’autre. Le voyage est dans les deux sens, et les mots sont importants.
On sait que tout travail sur les marges de la société travaille aussi pour le centre. C’est le sens du texte de J-P Durif-Varembont qui s’appuyant sur un contexte moins extrême, souligne l’ordinaire précarisation des liens de parenté pour le tout-venant contemporain. L’hyper investissement de l’enfant donne une inversion paradoxale: « l’autorité de l’infantile » à la place de l’autorité parentale. L’ordre générationnel en apparaît inversé : ce n’est plus l’alliance entre un homme et une femme qui légitime l’enfant, c’est la filiation qui crée l’union ; alors, « les enfants sont parentalisés et les parents infantilisés », disqualifiés comme les demandeurs d’asile…l’horreur du traumatisme en moins. Peut-on soulever l’hypothèse d’un trauma de déparentalisation, dans le cadre d’une psychopathologie ordinaire du lien familial contemporain ? A voir. Ajoutons tout de même pour ne pas traumatiser le lecteur, que tout enfant qui apprend plus facilement les langues et les nouvelles technologies que ses parents n’est pas parentalisé pour autant, s’il joue avec ses copains et se situe à sa place générationnelle !…
Ce numéro se termine sur les droits subjectifs que les pratiques de santé mentale peuvent soutenir, nous dit Christian Laval, dans un contexte d’essoufflement de l’Etat souverain. Si les droits objectifs sont du côté du contrat et des libertés essentielles, les droits subjectifs se situent sur un fond de non-droit, de non prise en compte des besoins subjectifs écrasés. C’est l’humain en capacité d’agir, ici comme parent, qui doit être protégé par le droit. Il s’agit, pour les institutions et les associations qui portent ces droits subjectifs, de contribuer à « fabriquer du droit contre certains agissement de l’Etat, dans un contexte où c’est l’Etat qui garantit ledit droit d’asile ».
Encore une fois, cette vision sur la marge nous incite à y regarder de plus près ant aux conditions d’exercice, d’expérience et de pratique de la parentalité ordinaire en société précaire. Comme le souligne Didier Houzel, elle interroge aussi les praticiens, eux-mêmes sollicités et confrontés à leur propre expérience de position générationnelle.