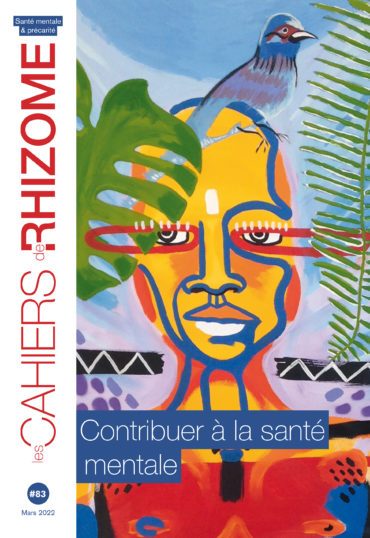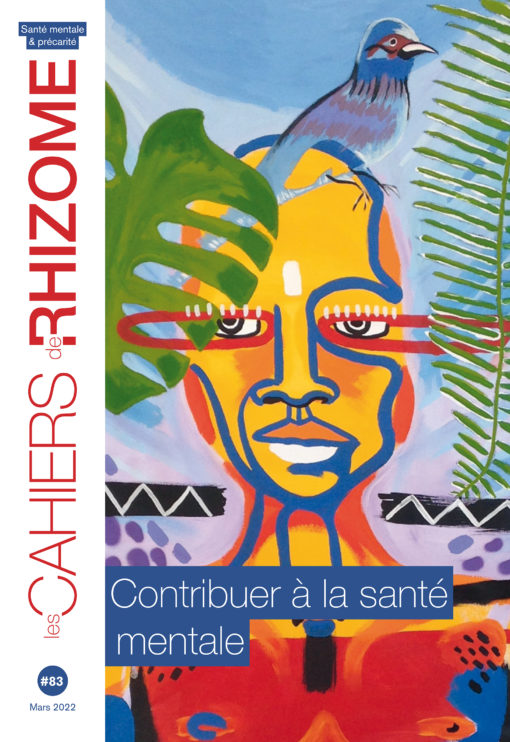Les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie se sont tenues en France en septembre 2021. Elles ont contribué largement à l’inscription de ces thématiques à l’agenda politique, avec son lot de controverses. D’un côté, nous pouvons nous réjouir du fait que la santé mentale soit devenue une préoccupation majeure. D’un autre, nous pouvons nous inquiéter de la confusion qui règne concernant les missions et les mandats de chacun dans ce domaine. Personne ne doute aujourd’hui de la nécessité et de l’urgence à agir, mais la question de la définition de la santé mentale ainsi que des prérogatives des professionnels des champs sanitaires, sociaux, des proches et des pairs reste à discuter.
L’extension de la santé mentale
Depuis le premier numéro de Rhizome, en 2000, l’impact de la précarité sur la santé mentale des individus a fait l’objet d’un consensus scientifique. L’évolution éditoriale de la revue et des missions de l’Observatoire qui l’édite convergent vers ce constat : nous sommes tous vulnérables ; par conséquent, ce qui relèverait d’un public spécifique (« les précaires », les « migrants », etc.) concerne finalement tout un chacun. À ce titre, il importe moins de concevoir un traitement spécifique de ces publics que de repenser l’activité. Ainsi, aujourd’hui, il est remarquable que la santé mentale se définisse de plus en plus dans une perspective environnementaliste. Autrement dit, l’expérience sociale inhérente à la vie, d’autant plus dans un contexte libéral, n’est pas sans effet sur la santé mentale, que l’on soit catégorisé socialement comme « précaire » ou non.
Les liens entre situation de vulnérabilité sociale et santé mentale sont devenus extrêmement ténus. La crise sanitaire de la COVID-19 a d’ailleurs rappelé à la population générale qu’être confiné loin de ses proches (craindre de), perdre son emploi, ne pas pouvoir se projeter dans l’avenir a des conséquences sur la santé mentale des individus. Inversement, connaître une crise psychotique, être soumis à l’anxiété ou encore faire une dépression sont des facteurs de vulnérabilisation sociale. Face à une personne confrontée à un cumul de difficultés psychiques et sociales, il est difficile de déterminer à quel point les conditions sociales influencent sa santé mentale et, inversement, combien sa santé mentale dégradée est responsable de sa précarisation sociale.
« La santé mentale est partout… et nulle part » pourraient rétorquer certains. Elle s’incarne de moins en moins dans un établissement (i.e. l’hôpital) et un métier (i.e. le psychiatre et le psychologue). En témoigne la plainte de professionnels nostalgiques de l’organisation sectorielle de la psychiatrie publique durant la seconde moitié du xxe siècle. La santé mentale s’émanciperait-elle de plus en plus de la psychiatrie ? Pour preuve, le nombre de professionnels qui viennent soutenir le bien-être – comme des esthéticiens qui intègrent des services d’accompagnement social de personnes en situation d’isolement, de handicap, de mal-logement – augmente continuellement. Cette extension du champ de la santé mentale élargit les territoires d’action de nombreux acteurs : travailleurs sociaux, policiers, enseignants, élus, bénévoles d’association, livreurs, techniciens… De nouveaux faisceaux de tâches sont également identifiés (travail de care, prévention, premiers soins d’urgence…).
Les conséquences d’une telle extension sont paradoxales : la définition de la santé mentale se complexifie davantage suivant les lieux, les métiers, l’histoire et les problèmes rencontrés. Indissociablement, elle échappe à la volonté de rationaliser le soin, au contraire des autres domaines de la santé.
Ainsi, l’offre de soins en santé mentale est illisible. Même les experts du champ, que nous sommes devenus, ont besoin de plusieurs heures de développement (ou de plusieurs dizaines de pages) pour l’expliquer à des novices. Les pouvoirs publics témoignent de leur difficulté à connaître ce secteur qu’ils financent pourtant. Qui appeler quand un proche est en crise pour la première fois ? Qui solliciter pour engager une démarche de soin psychothérapeutique ? Les réponses à ces questions qui se posent à de nombreuses personnes quotidiennement en France, somme toute assez simples et banales, varient d’un territoire à l’autre, d’un expert à l’autre, d’un service à l’autre. Face à ces difficultés, les centres d’orientation et d’information, comme les lignes d’écoute, se multiplient de part et d’autre et font croître le nombre d’interlocuteurs et les réponses proposées. Toutefois, la saturation des dispositifs vers lesquels ils sont censés aiguiller les personnes semble ne pas être prise en compte, celle-ci ne permettant pas de remplir, in fine, la mission d’orientation qu’ils portent.
Ces situations créent de nombreuses inégalités de traitement, d’autant que l’offre de soins en santé mentale est loin d’être suffisante. Les dispositifs et les professionnels qui prennent en charge la souffrance sociopsychique sont de plus en plus débordés, engendrant des situations d’incompréhension, voire de violence. Les centres médico-psychologiques (CMP) de secteur ne sont pas en mesure de répondre à l’ensemble des problématiques de souffrance psychosociale et voient leur file d’attente s’allonger inexorablement, notamment dans certains territoires dits « quartiers prioritaires de la politique de la ville » (QPV) au sein desquels on ne trouve aucun médecin généraliste et encore moins de psychiatre. Dans certaines zones rurales, l’offre de soins en santé mentale est même inexistante et les pratiques dites « innovantes » (notamment celles inspirées du rétablissement) se concentrent quant à elles majoritairement dans les grandes métropoles. Les psychologues libéraux n’arrivent plus à répondre à toutes les demandes surtout depuis la pandémie et certains services peinent à recruter ces spécialistes de l’écoute.
Face à l’importance des demandes, des régimes de priorisation des publics sont mis en place. Les parcours de soins varient, tantôt selon des critères pathologiques, à travers des centres experts, tantôt selon des critères sociaux ; dans ce dernier cas, nombreux sont les usagers qui fuient l’hôpital psychiatrique de secteur jugé stigmatisant par le public – « Nous ne sommes pas fous ! »
De plus, le contraste entre les diverses théories cliniques mobilisées par les professionnels rencontrés est saisissant (d’ailleurs la diversité des approches est largement défendue comme absolument nécessaire par les professionnels eux-mêmes, comme en témoignent les revendications récentes des psychologues1), et ce, sans que l’usager en soit pleinement acteur.
Quels mandats ?
La promotion de la santé mentale se fait de plus en plus en indexant son traitement hors des établissements et au sein de la « cité ». Le programme de l’inclusion, traité dans ce numéro, contribue aux activités de soutien en santé mentale au plus près de la préoccupation de l’ordinaire de vie. C’est le cas des groupes d’entraide mutuelle (GEM) dont les activités cherchent à retrouver les assises quotidiennes de l’existence. C’est également le cas de la politique de « Logement d’abord » où le souci de la santé mentale des personnes accompagnées est devenu l’un des cœurs de métier des professionnels. Chez l’ensemble des intervenants de ces dispositifs, un nouveau vocabulaire s’impose : sentiment de mieux-être ou bien-être, confiance, soutien social perçu, sentiment de pouvoir agir, valeurs, connaissances et déploiement de ses forces et capacités, espoir. Cette préoccupation pour la santé mentale et l’inclusion sociale des personnes participe à l’objectif affiché de réduire le recours au service de l’hôpital psychiatrique et plus particulièrement des hospitalisations en intrahospitalier. C’est par exemple un des arguments forts qui prévaut au soutien du dispositif « Un chez soi d’abord ». Les coûts évités par la durée des hospitalisations pour les personnes avec un logement permettent de justifier le soutien de la puissance publique à l’accompagnement intensif qui leur est dédié.
Pour autant, il serait illusoire et malvenu d’être dans la recherche et la promotion de tout de ce qui s’apparenterait à des « alternatives » à la psychiatrie. L’alternative a besoin de l’institutionnel pour exister. La question de savoir ce qui relève du mandat de l’hôpital psychiatrique aujourd’hui est en débat. La mission, essentielle, de répondre à l’urgence la met grandement en difficulté. La pénurie de médecins, mais aussi d’infirmiers, désorganise complètement l’hôpital et ses capacités à répondre à la demande. La souffrance des professionnels qui y interviennent n’a jamais été aussi importante, posant la question de son attractivité et mettant le focus sur les conditions de travail très dégradées dans de nombreux hôpitaux français.
Une clinique de l’autonomie
L’injonction à l’autonomie, à la responsabilité ou à l’autodétermination est une source centrale de problèmes « psys » : stress, fatigue psychique, perte de confiance en soi, anxiété… L’augmentation du nombre de psychologues dans le champ du travail social en est l’une des conséquences. En juin 2005, l’édito de la revue Rhizome s’interrogeait déjà sur l’identité de ces professionnels et sur le périmètre de leurs interventions. Plus de quinze ans après, la multiplication des types de publics et structures impliquant des psychologues a conduit aussi à une diversification de leurs rôles et missions qui contribuent à alimenter encore la difficulté à définir cette identité commune. Les débats actuels sur le remboursement des psychologues ont montré à la fois cet « éclatement » de la profession et leur attachement toujours fort à leur champ théorique, mais aussi, et peut-être surtout, leur capacité à se sentir confrères malgré tout.
Parallèlement, le souci des travailleurs sociaux pour la souffrance psychique participe de cette attention généralisée aux revers de l’autonomie. Le travail d’entretien relationnel des personnes, que l’on appelle l’accompagnement, s’impose partout. Il ne s’agit plus de travailler « pour » ou « sur », mais « avec ». Les dispositifs se sont démultipliés. D’un côté, ils sont censés épouser la singularité des situations les plus complexes. Cette individuation des interventions a largement favorisé le déploiement de réseaux interdisciplinaires d’aide difficiles à coordonner. De l’autre, devoir s’assurer de la bonne santé mentale des publics est devenu une consigne dans de nombreux secteurs. Il suffit de lire les recommandations de bonnes pratiques qui ont émané de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) puis de la Haute Autorité de santé (HAS). Elles peuvent alors être un « support » au « projet » si cher aux dispositifs de l’action publique aujourd’hui.
De la pathologie à la capacité
Nouvel esprit du soin (Ehrenberg, 2021), anthropologie capacitaire (Génard, 2009) : tous les champs sont aujourd’hui concernés par cet impératif de repenser les situations de fragilité à partir d’une lecture des capacités mobilisables pour y faire face. Ainsi, la psychiatrie a opté, sous l’influence des mouvements d’usagers, pour des rôles différents. Dans les services dits « de réhabilitation psychosociale », par exemple, il ne s’agit plus tant de traiter les troubles en agissant sur leur cause (par les traitements médicamenteux et la psychothérapie), qu’apprendre aux usagers à vivre le quotidien avec ou malgré eux. Par exemple, au sein de groupes d’éducation thérapeutique, les patients apprennent à repérer les signes annonciateurs des troubles, à élaborer un plan d’action en cas de crises, à agir dès les prémices de celles-ci… Indissociablement, ces apprentissages sont l’occasion de travailler l’affirmation et l’estime de soi, pour apprendre à dire non, à s’aimer… mais aussi à demander de l’aide, de manière adéquate et auprès des « bons interlocuteurs » (dont on a souligné précédemment la démultiplication). Il s’agit, in fine, de coproduire des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour « vivre dans la cité » et apprendre à traiter ses troubles autant que possible de manière autonome.
La place faite aux apprentissages confère une place particulière à l’expérience et plus particulièrement, en réalité, aux savoirs issus de cette (ces) expérience(s). Ceci explique aujourd’hui l’intérêt porté aux dits « savoirs expérientiels », incarnés notamment par la figure du pair. Il n’y aurait pas d’échec, seulement des expériences… La prise de risque est valorisée. Si l’intérêt de cette perspective est communément partagé, qui assure aujourd’hui les risques inhérents à ces initiatives ? Est-ce le rôle des pouvoirs publics ?
La santé mentale comme vecteur de solidarité ?
En 2011, l’Orspere, à travers la revue Rhizome (Furtos, 2012, p. 67), définissait une « santé mentale suffisamment bonne […] comme :
• la capacité de vivre avec soi-même et avec autrui, dans la recherche du plaisir, du bonheur et du sens de la vie ;
• dans un environnement donné mais non immuable, transformable par l’activité des hommes et des groupes humains ;
• sans destructivité mais non sans révolte, soit la capacité de dire « NON » à ce qui s’oppose aux besoins et au respect de la vie individuelle et collective, ce qui permet le « OUI » ;
• […] la capacité de souffrir en restant vivant, connecté avec soi-même et avec autrui. »
Si cette définition, proposée il y a une dizaine d’années, est toujours d’actualité, dans la mesure où elle souligne la dimension environnementale et politique du concept, elle n’éclaire pas les modalités de soutien favorables à la santé mentale. La santé mentale ne se décrète pas. Les modalités de soutien à une meilleure connaissance de soi, de son fonctionnement, de ce qu’il s’agit de respecter (ses besoins, ses valeurs…), ou au contraire de ce qu’il est possible, voire nécessaire de modifier ou de refuser (en soi et dans l’environnement) sont à créer dans tous les espaces de la vie sociale, que ce soit à l’école, au travail, lors d’activités sportives ou artistiques. L’attention et la créativité sont requises pour développer ces pratiques au-delà des structures dédiées ou institutions, dans le quotidien le plus ordinaire… La recherche d’une santé mentale suffisamment bonne ne doit pas exclure les personnes les plus concernées car les plus exposées, celles qui justement ne sont pas incluses dans ces lieux communs. Parallèlement, pour ne pas faire porter uniquement aux individus la responsabilité de leur propre santé mentale, dans une perspective libérale, individualiste et, in fine, solitaire, il s’agit de faire l’expérience de la diversité des autres, de leurs fonctionnements, besoins, valeurs, et de la valoriser.
En somme, et c’est peut-être là sa spécificité, la santé mentale est un territoire d’intervention qui invite à tous les déplacements, les agencements, les reconfigurations du rapport entre soin et société. Changer de société, repenser la société, ou comment en prendre soin ? Ce faisant, les pratiques de santé mentale nous obligent à redéfinir les frontières entre sanitaire et social, entre professionnels et usagers, entre savoirs experts et savoirs d’expérience, entre établissements de santé et domicile, entre normal et pathologique…
Dans une période où les revendications des uns à être reconnus dans leur singularité inquiètent ceux qui y voient jusqu’à un « chaos identitaire2 », le souci de la santé mentale des individus qui composent le corps social apparaît aussi comme un vecteur de solidarité. Nous revendiquons qu’elle puisse être une des réponses à apporter aux défis sociaux et environnementaux actuels.
Notes de bas de page
1 Site du Syndicat national des psychologues: https:// org/ profession-single/ mobilisation-generale/
2 Vous pouvez consulter le numéro no137 de la revue Écarts d’identité (2021) intitulé « Chaos identitaires et relation».
Bibliographie
Chambon, N., Gilliot, É. et Sorba, M. (2020). L’intervention sociale à l’épreuve d’une préoccupation pour la santé mentale. Mobilisation du rétablissement et politique de logement d’abord. Revue française des affaires sociales, 2, 97-116.
Ehrenberg, A. (2021). Les changements de l’esprit du soin : le potentiel, le handicap et la forme de vie. Cliniques, 21, 24-39.
Furtos, J. (2012). Mondialisation et santé mentale : La Déclaration de Lyon du 22 octobre 2011, Une présentation. Les Cahiers de Rhizome, 45, 62-70.
Genard, J. (2009). Une réflexion sur l’anthropologie de la fragilité, de la vulnérabilité et de la souffrance.
Dans T. Périlleux et J. Cultiaux (dir.), Destins politiques de la souffrance. Intervention sociale, justice, travail (p. 2745). Érès.