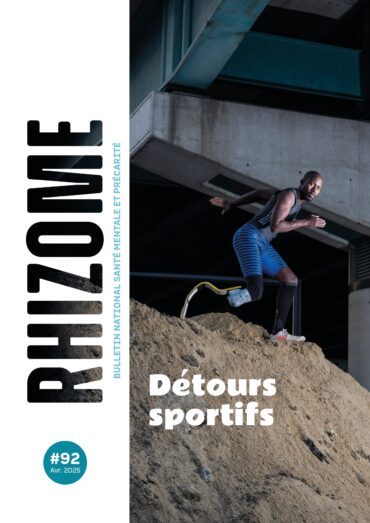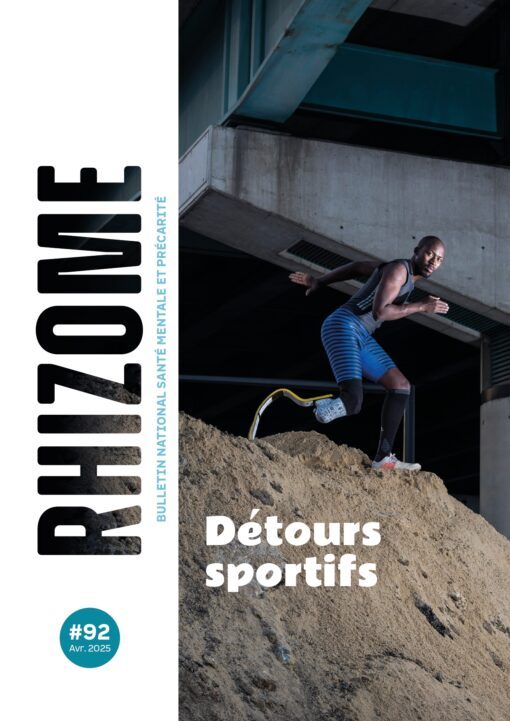Depuis 2022, à Marseille et dans sa région, le projet En passant par les Calanques (EPC) organise des randonnées avec des personnes concernées par les troubles psychiques ou l’exclusion sociale. En s’inspirant d’une méthode originale, l’intervention psychosociale par la nature et l’aventure (IPNA), ce projet soutient le mieux-être et le pouvoir d’agir des participant·e·s. Depuis 2023, c’est presque 60 jours d’activité en extérieur qui ont été proposés pour plus de 500 participations cumulées, avec des résultats probants et documentés en termes de rupture de l’isolement, de soutien des compétences psychosociales, de participation sociale, de bonne santé physique et mentale.
L’origine du projet repose sur la volonté de faire se croiser des personnes férues de sport de montagne avec des publics vivant des situations de handicap. Grâce à une convention avec le club alpin français (CAF), le projet bénéficie de l’encadrement de bénévoles formés aux activités de montagne et des assurances réservées aux membres du CAF. Dans un sens, cette organisation permet d’ouvrir des espaces naturels préservés, tels que le parc national des Calanques, à des personnes qui ne les fréquentaient pas ou plus. Elle promeut ce faisant la démocratisation de la randonnée pédestre, l’appropriation du territoire, le sentiment d’appartenance à un environnement partagé. Dans un autre sens, le projet œuvre à l’inclusion sociale et à la déstigmatisation des personnes concernées par les troubles psychiques en mêlant, sans les hiérarchiser, des personnes venues d’horizons très différents. Le mouvement et l’expérience sportive sont donc au cœur du projet, mais conçus d’emblée de façon inclusive et écologique. En effet, l’aspect élitiste des sports de nature se mélange parfois avec une vision elle-même élitiste de l’écologie, selon l’idée que l’expérience offerte par les sports de nature et les bienfaits qu’elle entraîne se mériteraient, réservés à ceux·elles qui ont la volonté (au sens de détermination, voire de courage) et les capacités d’y accéder1. Nous retrouvons ce genre de pensée lors des débats très concrets sur la création et l’accès au parc naturel des Calanques2. À rebours de cette logique, l’IPNA mise en œuvre par EPC sol- licite les compétences d’un groupe pour soutenir les capacités de chacun·e. Dans la logique de rétablisse- ment, le handicap n’est pas une propriété individuelle à dépasser par la seule compétence personnelle, la nature n’est pas un espace réservé à ceux·elles qui le méritent, et le sport n’est pas une affaire de per- formance et de compétition. L’écologie promue par le projet se conçoit comme la capacité à nouer des liens entre individus et avec les éléments de l’environnement non humain afin d’ouvrir des possibles. Ismaël3, participant, ne s’y trompe pas : « L’aventure avec EPC, pour moi, c’est une aventure humaine avec des personnes que je ne connais pas ou très peu. C’est m’obliger aux petits pas, aux randos qualifiées de “montagnes à vaches” [plutôt qu’aux grandes ascensions] alors qu’au détour du bois on trouve des paillettes de glace sous les feuilles, des crottes de loup et des sourires de belles personnes. C’est une aventure hors de la performance sportive habituelle. » L’aventure et le dépassement de soi sont bien recherchés et accompagnés comme des leviers de changement, mais hors d’une logique de performance4. Marius, participant, explique : « L’aventure, c’est l’inconnu, avancer avec autodétermination, avec un objectif de dépassement, éprouver des émotions fortes et en revenir avec satisfaction. »
Ainsi, les participant·e·s viennent bien chercher du « sport » dans notre projet, mais sans compétition et de manière sécurisée pour être « à pied d’égalité avec les autres et faire un sport doux », comme le dit Manon, participante. La majorité des personnes qui participent n’ont pas de pratique sportive régulière, du fait notamment de leur isolement ou de leur maladie, elles sont dans une démarche de « reprise d’activité ». Elles trouvent dans le projet une pratique sportive qui se vit sous l’angle de la bienveillance, un rapport à soi soutenu par le rapport aux autres, un rapport à l’environnement non humain lui-même renouvelé par l’aspect convivial de l’expérience vécue.
« C’est un projet pour ceux qui ne veulent pas être dans une structure, enfermés. Ce n’est pas seulement de l’occupationnel, il y a une dimension sportive, une finalité en soi. Le bien-être, la marche, la spontanéité », souligne une partenaire œuvrant dans le champ de la santé mentale. De fait, à côté des effets concrets et bien documentés de la marche sur la santé, En passant par les calanques défend une vision inclusive et écologique de l’activité physique vécue comme une mise en mouvement qui ouvre des possibles et dont le sens est travaillé collectivement et de façon continue : à chacun·e de faire de ce mouvement une dynamique et de s’en servir dans son parcours de rétablissement pour « sortir du quotidien, changer d’air, trouver de l’oxygène, aller vers les autres, sortir de sa zone de confort5 ».
Notes de bas de page
1 Ray, S. J. (2017). Risking Bodies in the Wild: The ‘Corporeal Unconscious’ of American Adventure Culture. Dans S. J. Ray et J. Sibara (dir.), Disability Studies and the Environmental Humanities: Toward an Eco-Crip Theory (p. 29-72). Lincoln & London, University of Nebraska Press.
2 Deldrève, et Deboudt, P. (dir.) (2012). Le Parc national des Calanques : construction territoriale, concertation et usages. Quae.
3 Les noms des participants cités dans cet article ont été anonymisés.
4 Rojo, et Bergeron, (dir.) (2017). L’intervention psychosociale par la nature et l’aventure. Fondements, processus et pistes d’action. Presses universitaires du Québec.
5 Propos de participant·e·s recueillis anonymement à la fin des journées grâce à un outil d’évaluation récurrent.