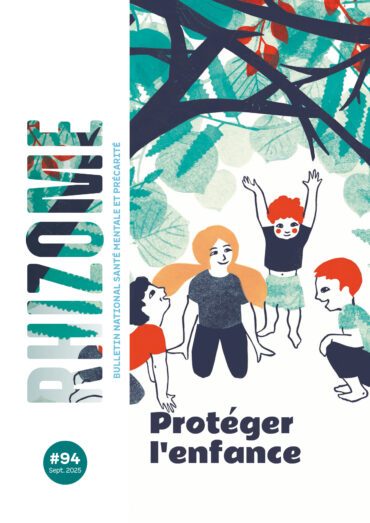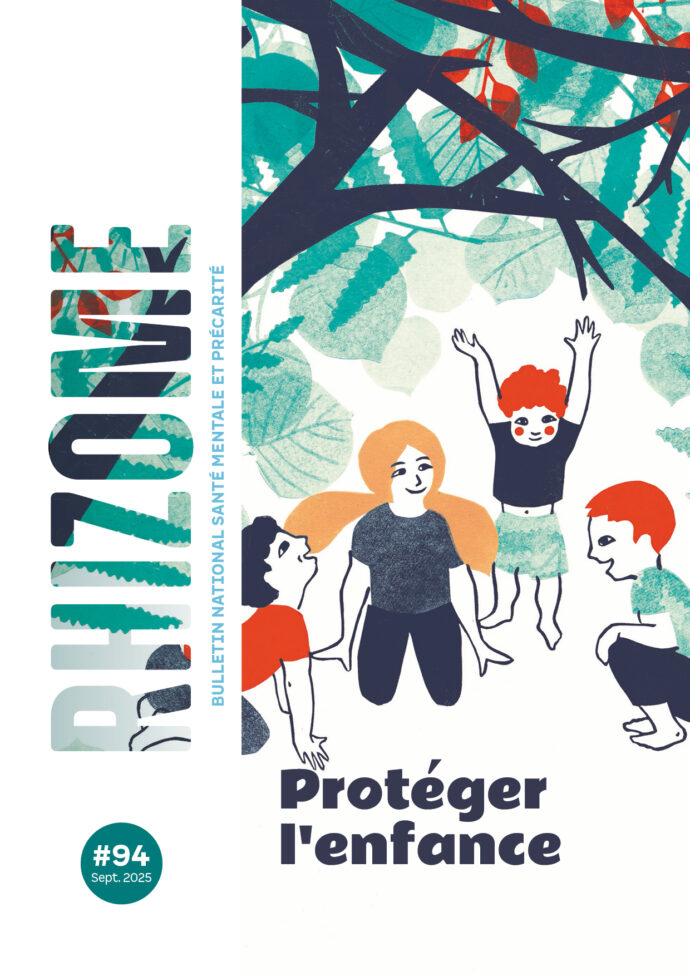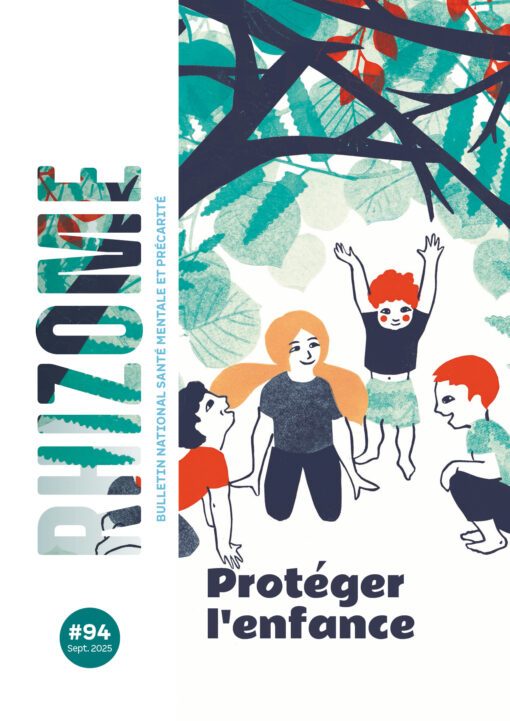Enfance et jeunesse ne sont pas seulement deux périodes qui se succèdent ou se chevauchent avec plus ou moins de précision, elles sont aussi l’objet de politiques distinctes. Bien que partageant des objectifs communs en matière de bien-être et d’accompagnement des plus jeunes, il existe une tension constitutive entre les politiques de jeunesse et celles de l’enfance. Ces dernières sont essentiellement abordées sous l’angle de la protection qui repose sur une approche centrée sur la vulnérabilité d’un public spécifique et la nécessité d’une intervention institutionnelle pour protéger les mineurs en danger. Les politiques de jeunesse, peu investies actuellement, adoptent une perspective plus universaliste, visant à accompagner les jeunes vers l’« autonomie » (soit le logement, l’emploi, la formation ou l’engagement citoyen).
Une logique de promotion de l’autonomie
Les foyers de jeunes travailleurs (FJT, ou encore « résidences Habitat jeunes » lorsqu’elles souscrivent au projet associatif du même nom) occupent une place particulière à l’intersection de ces politiques. Ils appartiennent à la famille plus large des résidences sociales et sont conçus comme une solution de logement temporaire pour les jeunes de 16 à 30 ans qui travaillent, sont en formation ou en insertion professionnelle. Ils accueillent des jeunes dits « en mobilité ». L’expression renvoie bien au lexique de capacités positives, présentes dès l’entrée dans le logement, ou à développer au long du séjour. Les FJT s’inscrivent donc dans une logique de promotion de l’autonomie, propre aux politiques de jeunesse, en offrant un cadre de vie semi-collectif avec un accompagnement socio-éducatif adapté à ce moment particulier de transition vers l’âge adulte qui constitue de manière intrinsèque une période de fragilité. Nous parlons alors même de « socialisation par l’habitat ».
Un cadre protecteur
Toutefois, d’autres caractéristiques de ces établissements offrent un cadre favorable à l’accueil d’une certaine fragilité sociale. Ainsi, les redevances payées par les jeunes sont réglementairement celles du logement social et incluent les charges locatives. Deux tiers des jeunes logés ont des revenus mensuels en dessous du seuil de pauvreté (moyenne nationale), soit une forte précarité économique, susceptible d’en entraîner d’autres. Mettre à l’abri de la grande pauvreté, permettre l’ouverture des droits et la mobilisation d’aides à travers la gestion locative sociale, ou encore permettre l’accès à des dispositifs intégrés, comme des épiceries solidaires, protège.
Les FJT sont également des établissements sociaux1, et ont à cet égard une attention particulière à la vulnérabilité, tant à travers leur référentiel d’évaluation que par la culture professionnelle de leurs salariés. Une partie des jeunes logés2 sont orientés par l’Aide sociale à l’enfance ou la protection judiciaire de la jeunesse, qu’ils soient mineurs ou majeurs, et parmi eux, une part non négligeable a connu un parcours d’exil : les « mineurs non accompagnés (MNA) ». Ces trajectoires peuvent induire des difficultés particulières en matière d’accès aux droits, de choix réel d’études, et avoir des effets graves sur la santé mentale. Rappelons que 25 % des personnes sans domicile fixe ont eu un parcours en protection de l’enfance3.
S’émanciper ensemble
Si pour toutes ces raisons le réseau ne récuse pas la notion de protection pour qualifier ses pratiques, son inspiration philosophique et ses logiques d’intervention ne procèdent néanmoins pas de cette unique dimension. Il propose un paradigme différent, celui de l’éducation populaire. Cette manière de faire et de penser ne contredit pas les principes et approches de l’action sociale ciblée, mais peut entretenir des zones de frictions avec ceux-ci. Dans un contexte de grave crise du logement, qui loger d’abord ?
Issus de l’idéal de cohésion sociale de l’après-guerre, les FJT font le pari de la « mixité des publics » comme vecteur d’émancipation des individus et de transformation sociale. Nous parlons d’ailleurs plus volontiers de « brassage social » car la simple juxtaposition de personnes ne produit pas nécessairement d’effets sociaux favorables : il faut animer ce voisinage pour qu’il devienne le terreau vivant du développement de tous. Les équipes socio- éducatives encadrent un collectif favorisant la rencontre d’autres que soi, de trajectoires vues comme singulières avant tout. Il s’agit de poser un cadre qui permette, en plus d’être protégé, de construire un projet commun, aussi humble soit-il, entre ceux qui s’établissent et ceux qui se rétablissent.
La précarisation de la jeunesse, la pression des réservataires de logement en temps de crise, la spécification grandissante des dispositifs et des publics rendent le projet de plus en plus difficile à mener. La capacité des FJT à protéger autant qu’à autonomiser tient pourtant sur cette ligne de crête.
Notes de bas de page
1 Ils sont régis par le Code d’action sociale et des familles, en plus du Code de la construction
et de l’habitation.
2 Unhaj. (2023). Les parcours des jeunes protégé·e·s par l’Aide sociale à l’enfance en Habitat jeunes. Unhaj.
3 Fondation Abbé Pierre. (2019). L’État du mal logement en France 2019. Aux portes de la rue :
quand l’État abandonne les personnes sortant d’institutions. Fondation Abbé Pierre.