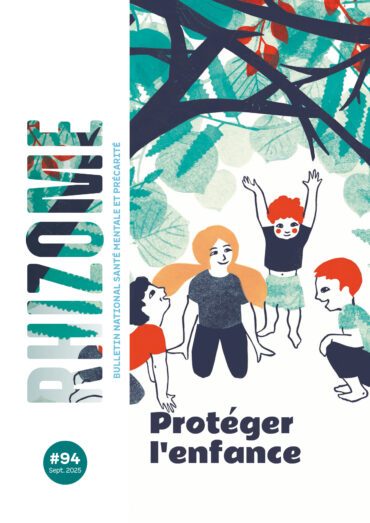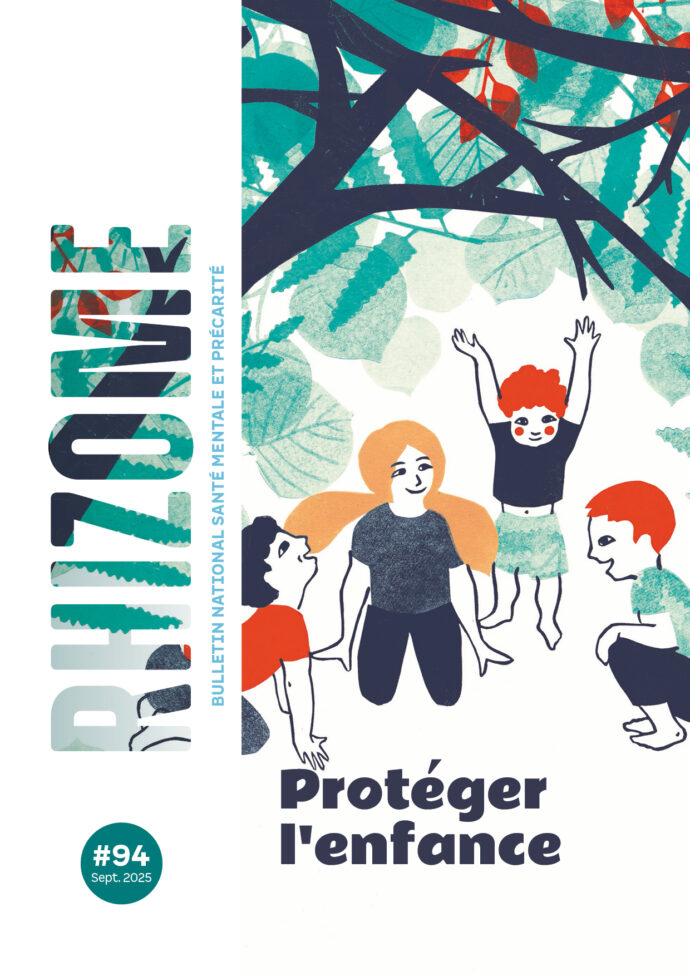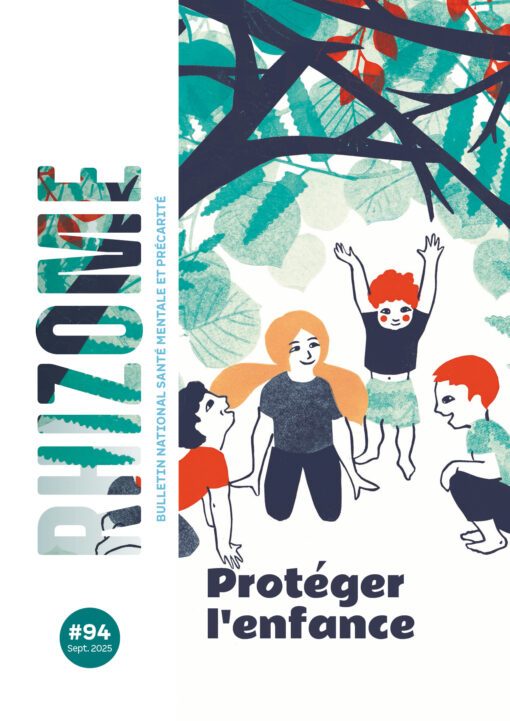Le 15 juillet 2024, la métropole de Lyon suspend toute nouvelle mise à l’abri, que ce soit à l’hôtel ou au sein de ses sites expérimentaux d’hospitalité. Aucune nouvelle prise en charge ne sera actée avant que la collectivité ne revienne finalement sur sa décision un mois et demi plus tard. Pendant ce laps de temps, plusieurs femmes enceintes et sortant de maternité avec leurs nouveau-nés se retrouvent à la rue. Ces mères isolées étaient pourtant jusqu’à présent protégées et prises en charge pour une majorité d’entre elles sur le territoire. Reconnues comme vulnérables au titre de la protection de l’enfance, elles bénéficiaient d’un « avantage sous contrainte1 » leur permettant tout à la fois d’accéder plus facilement à une mise à l’abri à l’hôtel et d’être hébergées dans de meilleures conditions2. Ce constat de femmes se retrouvant à la rue avec leur nourrisson, fait dès l’été 2018 en Île-de-France, avait amené les services de l’État à créer, en 2021, des places dédiées « femmes sortant de maternité » que l’on retrouve au sein du Relais des femmes3, structure dont il sera ici question.
Toutefois, qu’est-ce qui justifie l’apparition de ce nouveau public cible des « femmes sortantes de maternité » ? Comme me l’explique Caroline, chargée de mission au service intégré d’accueil et d’orientation, ces places ont été pensées comme une alternative à l’hôtel « parce qu’à l’hôtel le suivi n’est pas là. Il y a besoin, quand on accueille son enfant, d’avoir une équipe derrière ». Une équipe qui puisse épauler ces femmes et être là en support, l’arrivée d’un enfant étant un moment de vulnérabilité particulièrement important. Cette vulnérabilité est d’ailleurs centrale dans l’accompagnement.
Cet article s’appuie sur une enquête ethnographique menée dans le cadre d’une recherche doctorale au sein du Relais des femmes entre octobre 2022 et décembre 2024. L’équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels de l’intervention sociale et de la petite enfance, accompagne au sein d’un hébergement dit en « diffus regroupé », composé de studios individuels, un peu plus de 120 personnes, dont 25 mamans avec leur bébé et le père de l’enfant, quand ce dernier est présent. Pendant plus de deux ans, en immersion, j’ai partagé le quotidien de cette équipe, en menant à la fois des observations in situ de l’accompagnement « en train de se faire » ainsi que des entretiens semi-directifs auprès des professionnels (n=12) et des partenaires institutionnels et associatifs de la structure (n=14).
Prévenir de potentiels risques de santé pour la mère et l’enfant
Notons tout d’abord qu’héberger ces femmes et ces enfants leur évite des problèmes de santé éventuels et répond ainsi à leur vulnérabilité sanitaire. En effet, plusieurs études montrent que les femmes enceintes en grande précarité sont confrontées à des risques plus importants de complications pendant la grossesse et à des maladies cardiovasculaires4. Elles sont également éloignées du système de soin et souffrent d’une insuffisance de suivi de grossesse, les problèmes du quotidien – administratifs et financiers – prenant le pas sur le suivi médical. Ces femmes font également face à des refus de soins fréquents, ce qui accentue leur non-recours. Le fait d’être mises à l’abri en hôtel est également un frein à une bonne prise en charge médicale en raison de l’« hypermobilité » et de l’« instabilité résidentielle » que cela impose5.
Il s’agit donc de lutter contre « la fabrique programmée des inégalités de santé6 ». Comme le stipule la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement dans le cahier des charges concernant ces nouvelles places, les travailleurs sociaux, outre leurs missions habituelles, doivent veiller à faciliter le suivi sanitaire de ces mères. C’est ce qu’explique Laurence, référente petite enfance quand elle me présente ses missions : « Ça commence déjà au moment de la grossesse, c’est-à-dire de façon très pratique, quand une femme est enceinte, c’est déjà de savoir si elle est suivie par un médecin, si elle est inscrite dans une maternité. Est-ce qu’elle a un médecin traitant ? Est-ce qu’elle a déjà eu d’autres enfants ? Est-ce que sa grossesse se passe bien ? Est-ce qu’elle a besoin de rencontrer d’autres spécialistes en parallèle ? […] C’est faire le point de là où elle en est, faire le lien avec la protection maternelle infantile (PMI), pour qu’il y ait une sage-femme de la PMI qui vienne voir madame à domicile. […] Et puis après, si c’est une dame qui vient avec son bébé, c’est un petit peu la même chose : le suivi de grossesse, le suivi pour l’enfant, donc de nouveau avec la PMI, pour prévoir des visites, pour les vaccinations, pour le suivi du poids… Faire le lien avec les puéricultrices de la Maison de la Métropole qui viennent à domicile. Et puis, expliquer déjà tout ça aux dames : qu’il y a des visites qui sont obligatoires, qu’est-ce que c’est qu’un suivi PMI pour l’enfant. Il y a toutes les séances post-accouchement avec la sage-femme, toutes les séances de rééducation, ça peut être du kiné… Voilà. Et puis donc, après, il y a tout ce qui concerne le soutien plus moral, c’est-à-dire pouvoir répondre à des questions sur pleins de choses : sur l’allaitement, le sommeil, l’alimentation, le jeu, le développement psychomoteur de l’enfant… Toutes ces angoisses qui jaillissent au moment de l’arrivée d’un enfant. » Cette mission de coordination de parcours de soin consiste également pour elle, en tant que référente petite enfance, à soutenir et conseiller ces mères en répondant aux nombreuses questions qu’elles se posent.
Protéger la mère pour prendre soin de l’enfant et de son « bon » développement
Les travailleurs sociaux du Relais des femmes – et en particulier les référentes petite enfance – ont également une mission de soutien à la parentalité qui transparaît dans ce « soutien plus moral » qu’évoque Laurence. Ils sont là pour rassurer ces mères, mais aussi pour répondre à leurs interrogations et préoccupations. Cette réassurance passe notamment par le fait d’être à l’écoute de leurs craintes, de leurs peurs et de leurs angoisses. Les professionnels sont donc là pour rassurer ces femmes et pour leur apporter des conseils, les outiller et les guider, en les aidant notamment à mieux comprendre leur enfant, ses besoins, ses ressentis et ses réactions. « Nous, qu’est-ce qu’on fait ? On verbalise en permanence les besoins des enfants, ce qu’on voit. Et c’est surtout ça qu’on fait. Et parfois les parents, ils les voient les besoins de leur enfant, parfois ils ne les voient pas du tout. Mais du coup, ça peut les aider à mieux comprendre le bon fonctionnement de leur enfant ou ses réactions », m’explique Murielle qui anime le temps parent-enfant de la structure.
La création de ces places d’hébergement répond à un objectif de lutte contre les inégalités sociales de santé, mais elles ont également une visée préventive en matière de protection de l’enfant puisque c’est « avant tout au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant que les actions auprès de ces femmes sont menées7 ». Les professionnels sont donc attentifs à la façon dont mère et enfant se comportent l’un envers l’autre, mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser a priori, leur attention n’est pas uniquement tournée vers les nourrissons. Au contraire, les professionnels sont plutôt vigilants à l’égard des mères, de leur état de fatigue, de leur isolement et sont alertes vis-à-vis d’un potentiel épuisement parental. C’est ce souci et cette attention portée aux mères qui transparaît dans les propos d’Estelle, référente petite enfance, lorsqu’elle évoque la fatigue qu’elle a repérée chez Samara, une des mères qu’elle accompagne qui, selon elle, « n’en peut plus de son petit garçon ». « Tu vois, la famille dont on a parlé en analyse de la pratique professionnelle… On a parlé de Samara, avec Naïm. Du coup, elle interpelle beaucoup parce qu’elle a l’air en déprime totale. Elle n’est pas réactive, elle n’est plus du tout actrice de son projet personnalisé, de son boulot, de rien. [Les collègues] sont très inquiets et ils ont très envie de l’amener voir la psychologue. Et donc moi, j’interviens en disant : “Oui, et Naïm d’ailleurs, il est bougon, il est très ceci mais, en fait, il donne un peu l’impression d’avoir envie de secouer sa maman.” C’est une super maman, elle fait le job : il est propre, il est bien nourri, il dort quand il est fatigué, il mange quand il a envie de manger, elle le sort quand il a envie de sortir. Mais, en fait, il n’y a plus de tendresse. C’est une maman qui te dit qu’elle est épuisée […]. Et, en fait, tu te rends compte qu’elle n’arrive plus à passer du temps avec lui. C’est trop compliqué. […] Et donc moi, j’ai ça en tête parce que je trouve que le lien devient problématique. Cette maman n’en peut plus de son petit garçon. Ce petit garçon est de plus en plus agité, il a de plus en plus besoin d’attention et, à un moment, il va y avoir rupture. Il y a un moment où elle ne pourra plus répondre parce qu’elle sera trop épuisée, parce qu’il sera dans un état beaucoup trop exacerbé et ça ne va plus se rencontrer. Et là, on sera sur des choses où on se dira : “Mince, on n’a pas fait de prévention, c’est trop tard.” »
L’enjeu de l’accompagnement est donc clair : aider Samara à améliorer sa relation avec Naïm avant qu’il y ait une difficulté plus sérieuse pour sa santé psychique, la rendant incapable de s’occuper de son petit garçon et ce, en « reconnai[ssant] à la fois la fragilité de la situation familiale et la capacité du parent à y faire face. Le parent ne voit pas sa fragilité sanctionnée, au contraire il est accompagné de sorte à pouvoir luimême dégager des mécanismes permettant d’y pallier8 ». Ainsi, soutenir la mère revient in fine à protéger l’enfant. L’action des travailleurs sociaux rend compte du souci qu’ils ont de ces mères, qu’il ne s’agit pas de contrôler mais bien de soutenir dans une approche capacitaire, l’objectif étant de les reconnaître comme des sujets à part entière et non uniquement sous le prisme de leur maternité et de leur « si gros ventre9 ». En ce sens, l’accompagnement mené par ces professionnels du social relève d’une forme d’éthique du care10, d’une forme de sollicitude qui transparaît dans les propos d’Estelle et dans son inquiétude vis-à-vis de Samara et de Naïm, qu’elle tente de partager avec le reste de son équipe. Au même titre que ses collègues, elle est détentrice d’une connaissance fine des personnes qu’elle accompagne et a une appréciation sensible de la situation qui lui permet de « reconnaître des signaux d’inquiétudes à partir de seuils de vigilance individuels11 ». Leur inquiétude commune, leurs émotions et leur attachement vis-à-vis des personnes qu’elles accompagnent au quotidien sont autant de preuves de leur engagement.
Notes de bas de page
1 Marpsat, M. (1999). Un avantage sous contrainte : le risque moindre pour les femmes de se trouver sans abri. Population, 54(6), 885-932.
2 Loison, M. et Perrier, G. (2019). Les trajectoires des femmes sans domicile à travers le prisme du genre : entre vulnérabilité et protection. Déviance et Société, 43(1), 77-110.
3 Le nom de la structure ainsi que les prénoms des différentes personnes rencontrées dans le
cadre de la thèse ont été anonymisés.
4 Coulm, B. (2020). La précarité, un impact majeur sur l’état de santé des femmes enceintes. Sages-Femmes, 19(1), 12-17.
5 Gasquet-Blanchard, C. et Sahnoun, L. (2021). La précarisation des femmes enceintes primo-arrivantes comme indicateur du creusement des inégalités sociales de santé en Île-de-France.
Dans Atlas collaboratif de la mégarégion parisienne. Université de Rouen Normandie.
6 Gasquet-Blanchard, C. et Moine, R. (2021). Une fabrique programmée des inégalités sociales
en santé périnatale. Les limites actuelles de la prise en charge des femmes enceintes mises
en situation de précarité. Revue française des affaires sociales, 3, 225.
7 Virole-Zadje, L. (2016). Devenir mère, devenir sujet ? Parcours de femmes enceintes
sans-papiers en France. Genre sexualité & société, 16.
8 Pothet, J. (2024). Parentalités incertaines. Ethnographie et sociologie des dispositifs de soutien aux parents. Presses universitaires de Rennes, p. 119.
9 Froideveaux-Metterie, C. (2023). Un si gros ventre. Expériences vécues du corps enceint. Stock.
10 Tronto, J. C. (2009). Un monde vulnérable. Pour une politique du care. La Découverte.
11 Vives, L. (2023). Loger d’abord les sans-abri. Ethnographie de l’implémentation d’un modèle de réponse au sans-abrisme en France [thèse de doctorat], p. 359. Université Jean