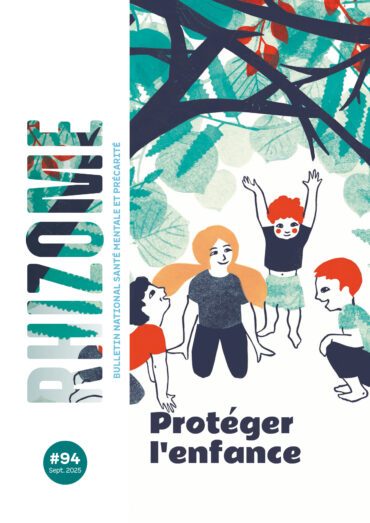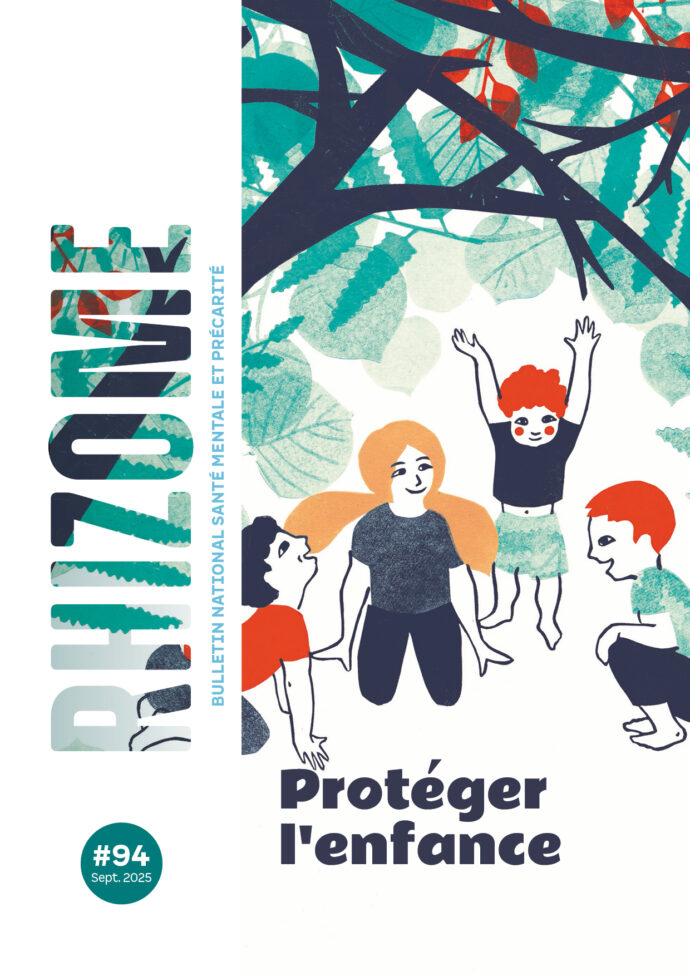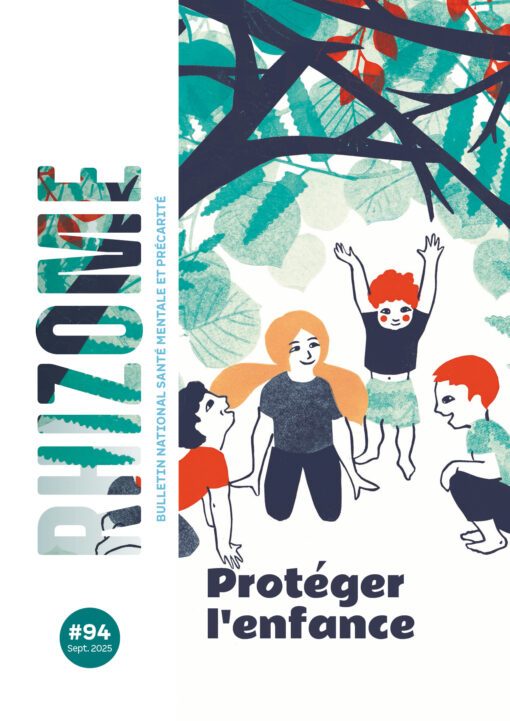En mars 2021, Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, me confiait la mission de recueillir la parole des enfants protégés par l’Aide sociale à l’enfance. L’enjeu de cette mission, qualifiée d’inédite par la Convention nationale des associations de protection de l’enfant (Cnape), était d’appréhender la perception qu’ont les enfants protégés de leur accompagnement et de formuler des propositions d’amélioration de cette politique publique complexe qui soient issues des paroles des enfants. Au cours de cette mission, plus de un millier d’enfants furent entendus dans leurs différents lieux d’accueil. En lien avec les départements sélectionnés, la mission s’est déplacée dans des pouponnières, des lieux d’accueil d’urgence, des lieux de vie, des maisons d’enfants et des familles d’accueil.
Concernant le recueil de l’expression des enfants, la méthodologie ne comportait pas de questionnaires précis afin de ne pas orienter leur expression. Adaptables à tous les âges de l’enfance, des questions d’ordre général étaient posées aux mineurs, telles que : « Qu’est-ce qui te fait du bien dans ton accompagnement et qui, de fait, pourrait être une bonne idée pour les autres enfants ? Qu’est-ce qui ne te fait pas du bien et que l’on doit, selon toi, arrêter de faire ? » Les enfants et les adolescents pouvaient être rencontrés préalablement au cours d’un repas collectif avant de débuter des entretiens plus personnels ou au cours d’activités diverses. Ils pouvaient aussi utiliser leur environnement ou des objets personnels qu’ils détenaient dans leur chambre (à l’instar d’un doudou) pour s’exprimer. Par ailleurs, nombre d’entre eux ont pu être interrogés au cours d’activités diverses (par exemple, l’équitation, une balade à vélo ou un temps d’expression avec des dessins). Enfin, certains ont aussi été interrogés collectivement au ministère de la Santé, ces moments prenant la forme d’un débat démocratique et se terminant par des visites culturelles.
De façon générale, l’ensemble des mineurs protégés ont exprimé un souhait de normalisation. D’apparence anodine, de nombreux détails de la vie quotidienne altèrent leur qualité de vie. Les mineurs ont formulé le souhait que ces détails puissent évoluer, certains n’ont aucun coût pour les finances publiques et procèdent de l’organisation du service public. À titre d’exemple, les mineurs expriment pour certains un malaise et pour d’autres une grande souffrance face au fait d’être conduits chaque jour à l’école dans une « grosse camionnette blanche » sur laquelle est apposé le logo de l’institution. Les mineurs souhaiteraient que ces logos disparaissent. Ce sujet n’a pas été révélé par la mission alors qu’il est, depuis bien longtemps, récurrent. Cependant, les camionnettes continuent de porter de ces logos. Cet exemple, ainsi que tous ces détails anodins – pour les adultes – partagés par les enfants nous enseignent la nécessité de se placer aussi souvent que possible à hauteur d’enfants afin de questionner le fonctionnement d’une institution à travers la manière dont les enfants et les adolescents perçoivent ses modalités d’organisation. Ceux-ci n’ont jamais manqué de justesse et d’authenticité, cette posture à leur hauteur, en plus d’être une déclinaison du droit d’expression des mineurs, ne doit pas inquiéter, elle ne peut qu’être vertueuse. Elle nécessite également de donner aux acteurs du quotidien une capacité d’action. À ce sujet, la mission a pu constater qu’une meilleure acceptation du risque éducatif permettrait aux acteurs du quotidien de l’enfant de s’adapter à l’unicité de chaque mineur et des besoins qui en découlent. Cela implique d’accepter le risque, risque qui devrait être partagé entre l’éducateur et la direction. Il a également été constaté que certaines organisations hiérarchiques paralysaient l’action d’acteurs de terrain.
Sans en minimiser l’importance, la mission a fait le choix de placer une recommandation comme plus importante que les autres, il s’agit de la nécessité de réinvestir de façon éducationnelle le temps de la nuit. En effet, pour des raisons d’organisation du service et, très certainement, budgétaires, la nuit a presque partout été désinvestie du champ éducatif. Les personnels qui veillent sur les mineurs ne sont pas des professionnels de l’éducation. Or aucune journée ne peut correctement bien se dérouler si la nuit ne s’est pas bien passée, puisqu’une bonne nuit est préalable à une bonne journée. La nuit est un moment de la vie déterminant dans la croissance des mineurs et pour la structuration du cerveau. Une différence notable et constante de bienêtre a été constatée sur l’ensemble du territoire national entre les mineurs qui vivent dans des institutions où un acteur éducatif du quotidien est présent la nuit et ceux qui sont veillés par un autre professionnel.
Bibliographie
Arnaud-Melchiorre, G. (2021). À (h)auteur d’enfants. Rapport de la mission La parole aux enfants.