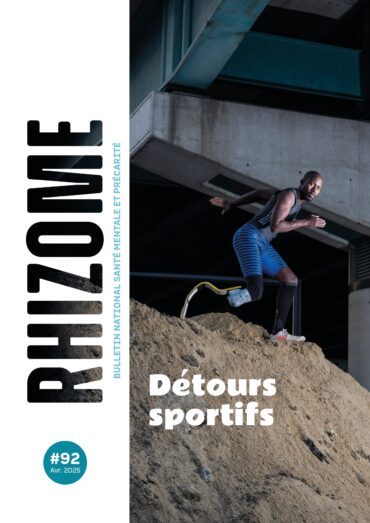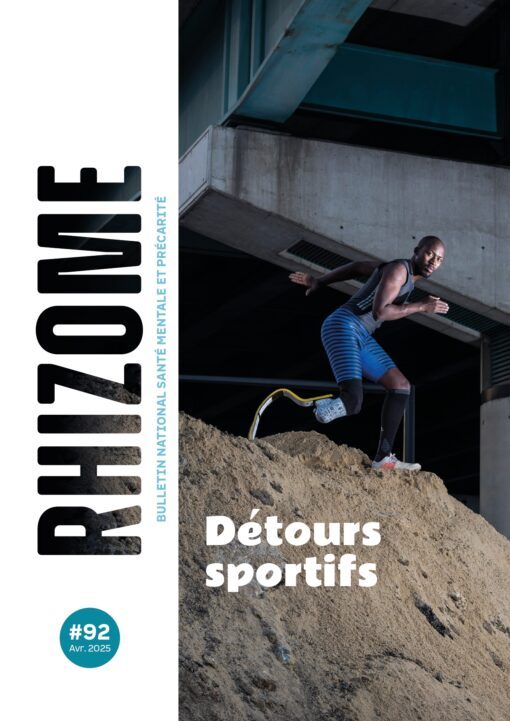En 2021, 20,9 % des réclamations adressées au Défenseur des droits concernant les discriminations portaient sur le handicap. Le domaine du sport en faisait partie : les taux de pratique sportive des personnes en situation de handicap sont deux fois inférieurs à la moyenne nationale1. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a rapporté que, fin 2022, seul 1,4 % des clubs se disaient en capacité d’accueillir des personnes en situation de handicap2. Certes, toutes les discriminations ne sont pas intentionnelles. Elles peuvent résulter d’un déficit d’accessibilité de la pratique sportive entendue dans un sens large, tenant, par exemple, à son éloignement géographique, à l’inadaptation des infrastructures, à un personnel d’encadrement insuffisamment formé, à la nature de l’activité sportive ou à un niveau d’exigence inadapté. Intentionnelles ou non, les discriminations font obstacle à une émancipation qui dégagerait les personnes en situation de handicap du statut d’incapables auquel elles sont trop souvent assignées, ouvrant ainsi des opportunités de développement personnel et de participation sociale.
Une discrimination accrue envers certaines catégories de personnes
Parmi les personnes en situation de handicap éloignées d’une pratique sportive, celles avec une déficience motrice, puis celles qui présentent des troubles psychiques sont les plus touchées. Ces dernières sont celles qui pratiquent le moins dans un cadre structuré, que ce soit au sein d’un club ou d’une association3.
Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, comme lors des Jeux précédents, les athlètes ayant des troubles psychiques n’étaient pas acceptés, pas plus que ceux avec une trisomie 21. La déficience intellectuelle y a trouvé une place, mais très réduite. Ainsi, 6 personnes parmi les 237 Français sélectionnés la représentaient, ce qui est sans commune mesure avec le nombre de personnes concernées dans la société. Si leur présence sur le terrain était discrète, elle l’était aussi dans les médias, comme elle l’est à l’occasion d’autres événements sportifs d’envergure. Du visionnage des émissions de télévision sportives au troisième trimestre 2023, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) conclut à « une visibilité quasi nulle des handicaps mentaux malgré les Global Games, la plus importante compétition internationale4 ». Cette dernière a eu lieu à Vichy à cette période pour les sportifs de haut niveau avec une déficience intellectuelle, dont certains sont porteurs d’une trisomie 21, de troubles du spectre de l’autisme, ou encore de schizophrénie. La France s’est pourtant classée première en nombre de médailles parmi une soixantaine de pays.
Pour comprendre le peu de visibilité accordée aux personnes avec des troubles intellectuels ou psychiques à l’occasion des Jeux paralympiques et d’autres grandes rencontres internationales, nous pouvons avancer l’hypothèse qu’elles ne correspondent pas à l’image valorisée et source de profits pour les sponsors et les médias. Ainsi sont mis sous les projecteurs des athlètes héroïques, voire surhumains de par leurs performances et leurs prothèses, aussi résilients que supposément inspirants. De plus, ils sont capables de raconter leur parcours de vie, ce qui représente une part importante du temps consacré au parasport dans les médias, selon l’Arcom. Or, les capacités de communication sont souvent diminuées dans le cas d’une déficience intellectuelle et, parfois, de troubles psychiques.
Bien avant que leur participation à des compétitions au niveau mondial soit envisagée, les personnes ayant ce type de déficience ou de troubles ont été davantage discriminées que celles relevant d’autres catégories inscrites dans le champ du handicap. La Fédération française du sport adapté (FFSA), qui leur est dédiée, n’a été reconnue qu’en 1999 par le ministère chargé des Sports, alors que la Fédération française handisport (FFH), pour les personnes avec une déficience motrice ou sensorielle, l’a été dès 1983. Auparavant, il était avancé que les personnes touchées par le « handicap mental » relevaient d’abord d’une prise en charge médicale. C’est dans ce sens que Joseph Comiti, secrétaire d’État chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a répondu à la demande d’agrément de la Fédération française des sports pour handicapés mentaux en 1971. Ainsi, il a approuvé les activités sportives aux personnes « malades » qui ne sont pas « guéries » « à des fins thérapeutiques » uniquement. Lorsqu’elles sont « guéries […] elles rentrent alors dans le circuit normal5 ».
Selon l’article 225-1 du Code pénal, il s’agit bien là d’une discrimination, définie comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille […], de leur handicap […] ». Les articles 225-2 1° et 4° du Code pénal précisent que le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou de le subordonner à une condition fondée sur l’un des éléments listés à l’article 225-1, dont le handicap, constitue une discrimination. Nous pouvons voir aussi dans ce refus une manifestation de validisme, c’est-à- dire d’une attitude qui fait de la personne valide une norme sociale qui ouvre, ou ferme, des droits.
Déconstruire des stéréotypes dévalorisants, condition d’une émancipation optimale
Les discriminations entravent le parcours vers une émancipation optimale à laquelle une pratique sportive peut contribuer. Il importe donc qu’une personne en situation de handicap puisse, avec un accompagnement si besoin, s’affranchir des dépendances liées à ses incapacités, réelles ou ressenties, et soit en mesure de s’engager dans une activité physique et sportive. Nous pouvons en attendre des bénéfices en termes de santé, physique et mentale, et une participation sociale accrue, revendiquée avec force par les personnes concernées, afin qu’aucune d’entre elles ne soit exclue du droit commun et de pratiques sociales normalement ouvertes à toutes et tous. C’est, notamment, la possibilité de s’adonner, lors de ses loisirs, à une activité physique et sportive au sein d’un club ou d’une association. Pour que ce soit une réussite, certaines capacités et compétences sont bienvenues. Cela suppose de l’entraînement, des apprentissages et donc un personnel encadrant qui parie sur des capa- cités possiblement masquées par des idées reçues. Ainsi, dans le cas de troubles intellectuels ou psychiques, l’image trop souvent véhiculée des personnes qui en sont atteintes est marquée par l’incapacité, les préjugés et des stéréotypes contraires à un principe fondamental des politiques d’inclusion, soit l’attention donnée à la diversité des individus. Il s’agit donc de déconstruire les portraits types des personnes rassemblées sous une même étiquette nosographique. Celle-ci masque les différences interindividuelles et des potentialités méconnues.
De fait, les personnes atteintes de troubles de l’efficience intellectuelle constituent un ensemble très hétérogène, regroupant celles dont la déficience, moyenne ou plus conséquente, dessert l’autonomie et nuit considérablement aux apprentissages scolaires ainsi qu’au langage, et d’autres qui, guère éloignées de la norme, poursuivent des formations diplômantes, voire témoignent, dans un sport d’opposition mobilisant des tactiques, d’un niveau et d’une intelligence de jeu remarquables. C’est notamment le cas de Léa Ferney, médaillée d’argent en tennis de table aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.
Pour sa part, la catégorie « troubles du syndrome autistique » réunit des individus dont les manifestations cliniques varient beaucoup de l’un à l’autre en matière de troubles associés, de langage et de niveau de fonctionnement intellectuel. L’un peut présenter une déficience intellectuelle profonde et un autre, une intelligence supérieure à la moyenne.
Quant aux personnes touchées par des troubles psychiques, elles pâtissent d’une forte stigmatisation, en particulier « les schizophrènes, des criminels », pour reprendre les propos d’un article récent qui dénonçait cette association6.
Un stéréotype infamant, démenti par l’exemple de Pascal Pereira-Leal, qui témoigne au contraire du rôle émancipateur que peut jouer le sport. Atteint d’une forme de schizophrénie, il a cumulé, en 2012, trois médailles d’argent aux championnats du monde de tennis de table pour athlètes présentant une déficience intellectuelle ainsi qu’une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Londres (auxquels il a pu participer en raison de ses troubles intellectuels). Son parcours et ses propos questionnent les clichés stigmatisants qui s’attachent à cette maladie et soulignent le rôle du sport dans sa reconstruction. Ayant passé trois ans dans un centre fermé, à partir de son année de terminale, il a connu des maisons thérapeutiques avant de reprendre le tennis de table, qu’il pratiquait auparavant. Après ses exploits, il déclarait, en 2012 : « J’espère vous montrer qu’il y a différents chemins pour aller mieux et qu’il est possible d’améliorer sa vie grâce au sport […]. Le sport et mon entourage m’ont permis de contenir ma maladie7. »
À travers une activité physique et sportive, se reconnaître et être reconnu capable d’accomplissements
Pour se délier de ses dépendances, oser exprimer des choix et s’engager dans des activités sans être toujours assuré de réussir, il faut avoir suffisamment confiance en soi et donc se reconnaître des capa- cités. C’est là une condition de l’émancipation qui « consiste à se rendre capable de quelque chose dont on n’est pas censé être capable, dont on ne se sen- tait pas capable soi-même8 ». L’image de soi-même, en d’autres termes l’« identité pour soi », est liée à l’« identité pour autrui9 », c’est-à-dire qu’elle appelle un regard extérieur, sollicité lors du parcours de la reconnaissance tracé par Paul Ricœur10. Les capacités perçues par autrui peuvent particulièrement donner lieu à une reconnaissance lorsqu’elles s’exercent dans des activités qui relèvent de pratiques sociales valorisées et potentiellement valorisantes, comme les activités physiques de nature sportive. Un engagement dans de telles activités est proposé au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Nice. Mathieu Lestel, enseignant en activité physique adaptée, y conduit régulièrement, sur prescription médicale et avec d’autres professionnels, une pratique d’escalade auprès d’un petit groupe de patients. C’est pour eux l’occasion de s’émanciper de leur identité négative qui paralyse tout projet et de briser leur isolement social. Évoquant leurs difficultés, l’enseignant évoque des patients qui s’autostigmatisent11. Avant même d’essayer, certains hésitent : « je ne suis pas capable ». Décrivant les objectifs de l’atelier escalade et ce qui s’y passe, il parle du fait que les personnes dépassent leurs propres limites, restaurent leur estime d’elles-mêmes, trouvent un espace de responsabilité en assurant d’autres patients, prennent et suscitent de la confiance, nouent des interactions sociales nourries d’échanges, de conseils, de blagues et envisagent même la poursuite de cette activité hors de l’hôpital.
Toutefois, la reconnaissance des capacités ne suffit pas à ouvrir totalement le chemin vers l’émancipation. Encore faut-il que l’environnement soit capacitant12, c’est-dire favorable à un pouvoir d’agir. Ce dernier est certes conditionné par la capacité d’agir, mais aussi par des conditions externes au sujet, qui lui permettent de pouvoir faire, ainsi que par un vouloir-faire impulsé par un désir d’agir13 convoquant le sens que le sujet attribue à son activité.
Notes de bas de page
1 Les dénominations « activité sportive » et « activité physique et sportive » sont employées indifféremment dans l’article. Nous ne retenons pas une définition connue du sport qui ne comprendrait que des activités institutionnalisées et compétitives. De cette manière, nous suivons aussi la position de l’enquête nationale de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), publiée en octobre 2024, soit le fait que l’activité sportive recensée comprend également des activités comme le fitness, la marche sportive ou le vélo de ville. Mauroux, A., Raffin, V. et Zimmer, C. (2024). La pratique sportive des personnes en situation de handicap. État de la connaissance statistique. Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire.
2 Conseil économique, social et environnemental. (2023). Développer le parasport en France : de la singularité à l’universalité, une opportunité pour toutes et tous.
3 Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) et Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors). (2023). Enquête nationale sur la pratique des activités physiques des personnes en situation de handicap vivant à domicile en France.
4 Arcom. (2023). La représentation du parasport dans les programmes télévisés.
5 Lettre de Joseph Comiti, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, à la présidente de la French american volunteer association (Fava), cité par Henri Miau. Miau, H. (1991). Le Sport adapté : un cadre institutionnel simple pour un champ d’action complexe. Dans F. Brunet et G. Bui-Xuan, Handicap mental, troubles psychiques et sport (p. 79-90). Afraps.
6 Hennebelle, I. (2024). Santé mentale : des jeunes psychiatres militent contre la stigmatisation. Le Monde.
7 Hernandez, A. (2012). Sport adapté : Pascal Pereira-Leal réussit le triplé. Le Monde.
8 Delorme, É. et Rancière, J. (2018). La Fabrique de l’émancipation. Dialogue. Conservatoire national de danse et de musique de Paris.
9 Goffman, E. (1975). Stigmates. Les usages sociaux du handicap. Éditions de Minuit.
10 Ricœur, P. (2004). Parcours de la reconnaissance. Stock.
11 Entretien avec Mathieu Lestel réalisé par Nathalie Pantaléon. Pantaléon, N. (2017). Entretiens et témoignages. Dans I. Caby et R. Compte, Sport et handicap psychique : penser le sport autrement (p. 123-128). Champ social.
12 Falzon, P. et Mollo, V. (2009). Pour une ergonomie constructive : les conditions d’un travail capacitant. Laboreal.
13 Leplat, J. (2011). Mélanges ergonomiques : activité, compétence. Octarès.