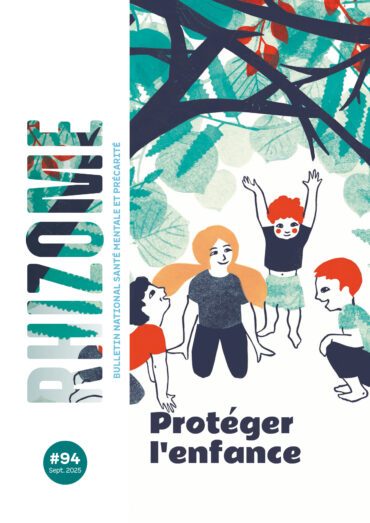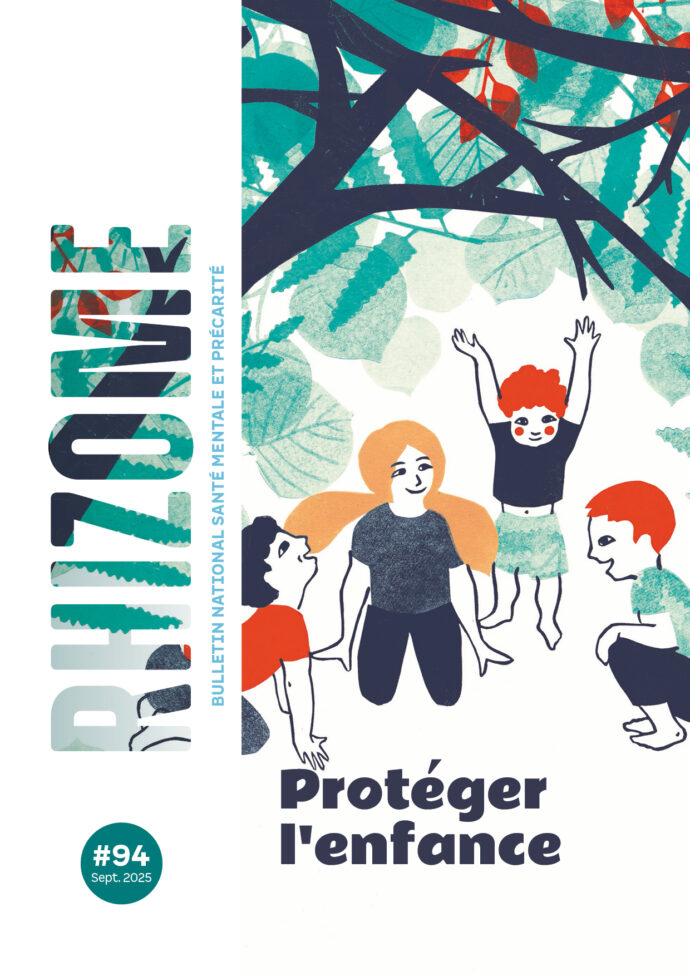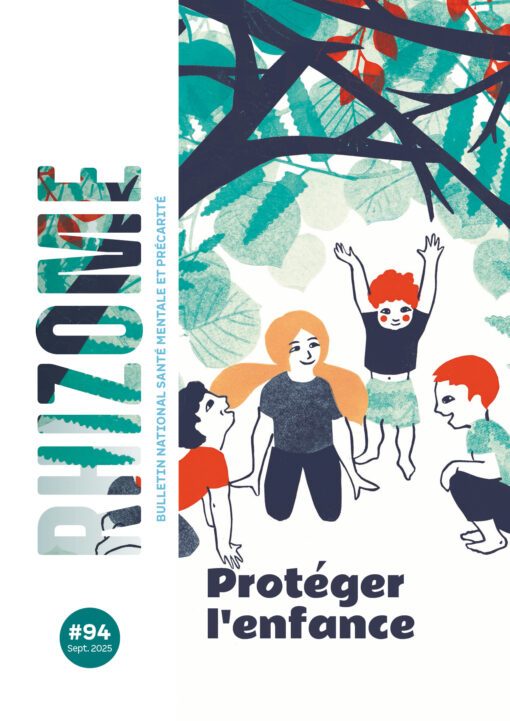Évoquer le « déni » et le « silence » autour de l’inceste et déplorer le classement de 73 % des plaintes pour inceste1, laissant entendre la complicité d’une justice patriarcale comme le font nombre de commentateurs dans l’espace public depuis quelques années, ne permet pas de comprendre précisément pourquoi l’inceste est si courant et si peu repéré malgré sa réprobation apparemment unanime. Pour cela, il faut observer les situations précises où il est question d’inceste. Qu’en est-il donc, par exemple, en protection de l’enfance, quand un inceste est suspecté ?
Depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, les informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en risque de l’être sont regroupées dans les cellules de recueil des informations préoccupantes (Crip) – il en existe une par département. Dans chacune d’elles, une équipe de travailleurs sociaux évalue les situations familiales qui lui sont exposées et orientent les familles soit vers la voie de la protection de l’enfance (éducatif), soit vers la voie pénale, ou les classent2.
Si l’information préoccupante annonce des faits passibles d’un traitement pénal – violences physiques, violences sexuelles –, les professionnels de la Crip la transmettent au substitut du procureur afin qu’il saisisse un service enquêteur (soit la police ou la gendarmerie) et prononce éventuellement le placement provisoire de l’enfant. L’enquête consistera à établir les faits et leur auteur. Néanmoins, les professionnels de la Crip sont là pour « filtrer » les suspicions pour le substitut qui ne peut pas ouvrir une enquête de police pour toutes, au risque sinon de surcharger les services concernés et de rendre leur action inopérante. Ce dispositif, qui a vocation à mieux saisir la maltraitance à enfant, institue ainsi des places et une division des tâches, et conduit à la délégation de la responsabilité du traitement de l’inceste à un autre professionnel toujours plus éloigné de la famille concernée, ce qui minimise les chances de repérer les incestes perpétrés.
Suspicions d’inceste et évaluation de leur pertinence
Ainsi, quand, à partir de propos ou d’attitude de l’enfant le plus souvent, les professionnels de terrain (soit les travailleurs sociaux, les médecins, les enseignants ou les psychologues) suspectent des faits d’inceste, ils transmettent une information préoccupante aux professionnels de la Crip qui, eux, vérifient, en matière pénale, les éléments sur lesquels reposent ces suspicions. Les premiers rapportent les éléments qui leur font craindre une agression sexuelle ou un inceste – qui laisse rarement des traces et sur lequel ils n’ont aucun moyen d’enquêter –, les seconds évaluent la pertinence de leur inquiétude. Les professionnels de la Crip ne portent donc pas leur attention sur l’abus craint par le rédacteur de l’information préoccupante, mais sur les éléments à partir desquels ils peuvent ou non transmettre la « situation » au substitut : « Que décrit l’information à partir de quels éléments ? » et « Respecte-t-elle les critères de saisine de l’autorité judiciaire ? » Ainsi, pour les professionnels de la Crip, les éléments susceptibles de révéler un inceste sont ceux qui permettent d’ouvrir une enquête de police.
À chaque transmission au substitut, les professionnels de la Crip jouent leur crédibilité professionnelle et celle du service. Ils sont ainsi pris entre des professionnels de terrain inquiets pour un enfant et des substituts exigeants sur la nécessité, la faisabilité et la chance de réussite d’une enquête de police. Ils décident de transmettre la « situation » à partir de l’idée qu’ils se font de sa réception par les substituts qu’ils n’ont jamais rencontrés, mais dont ils connaissent les attentes par expérience. Ils prennent également en compte la difficulté des enquêteurs de police à établir des faits d’inceste sans révélation et le nombre important de classements sans suite. Notons qu’en 2020, dans la Crip concernée, les suspicions de violence sexuelle (inceste compris) ont donné lieu à un traitement judiciaire dans près de 87 % des dossiers3.
Les éléments permettant la transmission de la suspicion au substitut
Une information qui rapporte des propos d’enfant tenus à une « autorité » ou à un camarade, éventuellement repris par une personne extérieure à la famille, est immédiatement transmise au substitut. Ces propos décrivent des actes ou des gestes précis commis sur eux ou qui pourraient l’avoir été, et le contexte de la suspicion est clair et bien délimité.
Le « 119 – Allo enfance en danger » envoie par exemple une information préoccupante après l’appel d’un père qui relaie ce que sa fille a entendu d’une camarade : « Papa me force à toucher son zizi tous les jours. » Le professionnel transmet comme une évidence l’information préoccupante au substitut. Il m’explique : « Ça part direct au Parquet pour information. C’est allé vite, parce qu’il n’y avait que trois lignes à lire et que c’est systématique. » Les propos de deux jeunes enfants, et d’un père étranger à la famille, crédibilisent la suspicion. Ce qui ne présage pas de la croyance du professionnel que la petite fille est abusée : « C’est courant, ces situations ! Là, on va peut-être découvrir que la petite est en garde alternée, alors “tous les soirs”… » À ce stade, il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire, mais de suivre une procédure. Une information rédigée
par un psychologue auquel une enfant a confié les gestes que lui demande de faire son père – « caresses sur tout le corps » et sur le « zizi » –, ainsi que son « dégoût » et « sa peur de perdre son cheval si elle le dit », est aussi transmise sans hésitation au substitut.
Lorsque aucun propos d’enfant n’est rapporté, les professionnels interrogent plus longuement la qualité des éléments d’inquiétude présentés. Les comportements sexualisés de jeunes enfants, possibles révélateurs d’abus sexuels pour les professionnels de terrain, sont par exemple souvent rapportés au développement normal d’enfants de leur âge par ceux de la Crip. Le vocabulaire employé dans la description des faits concernant un jeune enfant peut sembler inadapté et décrédibiliser l’inquiétude du rédacteur. Un professionnel s’étonne ainsi à voix haute de l’information d’un directeur d’école qui signale un enfant qui en a « sucé » un autre : « Attention, il n’a que trois ans, quand même, alors “sucé” ! »
Dans ces cas-là, le professionnel saisit son téléphone et demande des renseignements complémentaires au chef de service qui a cosigné l’information préoccupante : la nature et le contexte des conduites observées, l’attitude des parents s’ils ont été prévenus, les éventuels suivis médicaux… Si les réponses lui semblent de nature à enrichir le dossier, il lui propose de les lui envoyer par écrit. Parfois, il soulignera l’absence de spécificité de la situation décrite et le dossier sera classé.
La « situation » peut aussi être très discutée au sein de l’équipe. C’est le cas lorsque des signes manifestés par un enfant – masturbation excessive, sexualité « débridée », mimes d’actes sexuels, approches sexualisées d’autres enfants, voire même accusations d’agression par un camarade – peuvent être tout aussi bien des symptômes autistiques ou d’une pathologie mentale, que des signes d’une agression subie.
Des psychologues rédigent également des informations préoccupantes dans lesquelles ils rapportent les réminiscences ou ressentis de jeunes patients, à propos de gestes passés d’un père, d’un grand-père, parfois d’un oncle ou d’une tante… Les « faits » rapportés – gestes, auteurs, dates – et leur contexte d’énonciation – moment de la thérapie, après quelles paroles énoncées, par qui – ne sont pas suffisamment précis pour permettre aux professionnels de la Crip d’envisager une enquête de police et donc une transmission au substitut. Ils expliquent alors aux rédacteurs leur impossibilité à agir à partir de leur « écrit » et leur proposent d’essayer d’en savoir plus, voire de poursuivre leur travail avec l’adolescent, et de revenir vers la Crip « quand les souvenirs seront plus précis ».
Ces informations préoccupantes placent dans l’embarras des professionnels qui savent que ces réminiscences se basent presque toujours sur des faits réels, et qui sont dans l’obligation de transmettre au substitut une information
concernant un fait relevant du pénal, mais avec des éléments précis qu’ils n’ont pas. Ils se rappellent alors que le substitut ne pourra pas se saisir de cet écrit et qu’une enquête de police est vouée à l’échec : « Si on présente ça au parquet, il va dire : “Le dossier, il est vide !” » ou « Une enquête de police, ça donnera quoi ? Rien ! » L’inévitable classement du dossier par le substitut pourrait bien causer un « traumatisme supplémentaire aux victimes », car « là, y a rien, hein ! » D’un commun accord, ils décident de ne pas transmettre l’information préoccupante au substitut.
La suspicion d’inceste, hors d’action des travailleurs sociaux de terrain
Alors que dans le cadre d’une suspicion de maltraitance physique les professionnels de la Crip demandent très souvent, en parallèle à leur transmission de la « situation » au substitut, une évaluation sociale de la famille à un service dédié, ils ne le font jamais dans le cas d’une suspicion d’inceste. Les professionnels de la Crip et les travailleurs sociaux de terrain rencontrés s’accordent sur le fait que l’inceste ne doit être interrogé que par des enquêteurs de police, perçus comme des « spécialistes qui savent faire parler l’enfant ». Tous considèrent aussi que l’évaluation sociale perturberait l’enquête qui commence souvent tardivement : mis au courant de la suspicion à son encontre, l’auteur présumé pourrait en effet préparer son audition et faire taire l’enfant.
Surtout, contrairement aux coups dont ils supposent qu’ils proviendraient presque toujours d’une posture éducative inadaptée, les professionnels de la Crip considèrent l’inceste comme une « maltraitance dénuée de toute volonté d’éduquer » et donc impossible à « reprendre » d’un point de vue éducatif : « [L’inceste], c’est de l’agression pure et simple. […] On n’est plus dans une question de relations parent/enfant, dans la relation affective. Il se passe quelque chose, il y a une coupure très nette, on ne peut pas le travailler, ça ! » m’explique l’un d’eux. L’inceste est trop destructeur pour être un élément de la vie familiale.
Certes, le substitut du procureur peut demander une évaluation sociale, soit en parallèle à une enquête de police, soit après sa clôture. Mais dans ces deux cas, les travailleurs sociaux évaluateurs seront déchargés de la suspicion d’inceste : si une enquête est menée, elle est prise en charge par les services de police, et n’aura pas à être abordée lors de l’évaluation sociale ; si l’enquête est clôturée, la suspicion n’existe plus et l’inceste est définitivement écarté. Les évaluateurs peuvent travailler.
Ainsi, dans ce dispositif mis en place pour mieux appréhender les maltraitances contre les enfants, la prise en compte d’un possible inceste est entravée par une division des tâches stricte qui conduit les regards de chacun sur la suspicion : les uns, dans l’impossibilité d’enquêter, suspectent et s’inquiètent pour l’enfant, les autres s’inquiètent, en matière pénale, de la qualité de la suspicion.
En outre, les travailleurs sociaux de la Crip et leurs collègues de terrain qui réalisent les évaluations sociales, tous pourtant spécialistes de la famille, considèrent l’inceste comme un acte factuel déconnecté des relations familiales. Ils l’excluent de leur champ de compétence et en abandonnent l’enquête aux inspecteurs de police. Le risque, déjà éminemment important, de passer à côté d’incestes dont les enfants victimes ne parlent pas est ainsi décuplé.
Notes de bas de page
1 Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. (2021). Ciivise.
2 En 2020, j’ai réalisé un travail de terrain de près de six mois dans une cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) d’une grande agglomération, et un autre de six semaines dans un service social de la même ville, qui réalise des évaluations sociales demandées par la Crip. Recherche Dire, entendre et restituer les violences incestueuses (Dervi), 2019-2024, financée par l’Agence nationale de la recherche.
3 Crip (2020). Rapport d’activité. Crip. Il n’est malheureusement pas possible de distinguer la part de celles qui ont fait l’objet d’un traitement pénal et d’une enquête de police, de celles qui ont été transmises à un juge des enfants dans le cas de familles déjà suivies. Difficile aussi de savoir de quelle « violence sexuelle » il s’agit et quand elle a été ainsi établie (par le rédacteur de l’information préoccupante ou celui qui l’a reçue), et, plus encore, à quel moment la « violence sexuelle » est considérée comme avoir été « suspectée ».
Bibliographie
Doyon, J. et Le Caisne, L. (2024). Inceste(s). Représenter, juger, suspecter. Presses universitaires de France.
Le Caisne, L. (2024). Itinéraire d’une suspicion d’inceste. La « situation Amrich ». Dans A. E. Demartini, J. Doyon et L. Le Caisne, Dire, entendre et juger l’inceste. Du Moyen Âge à nos jours (p. 315-350). Seuil