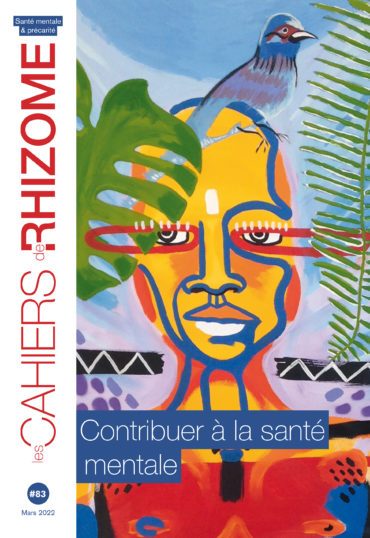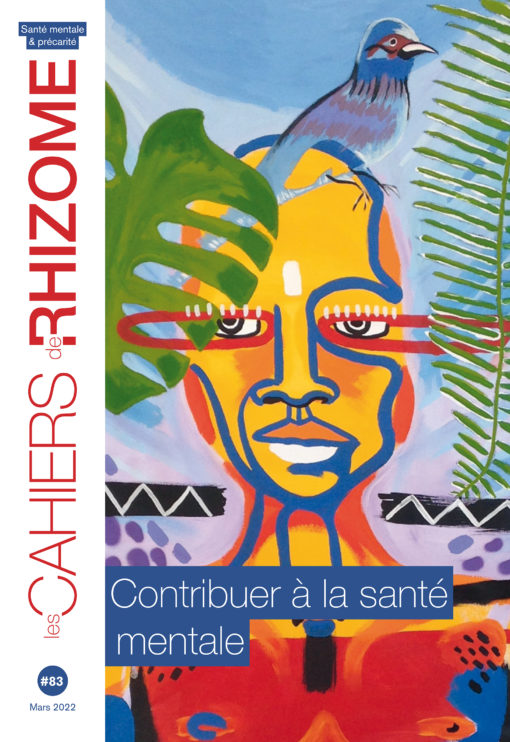« Dans ma définition de mon job, c’était évident qu’il ne fallait pas que les patients se scarifient quand moi j’étais infirmier dans le service, ce n’était pas possible. Donc les deux sentiments c’étaient : l’impuissance et la culpabilité. » (Michel, soignant)
Depuis 2013, une nouvelle pathologie intitulée non suicidal self injury1 est apparue dans la catégorie « Affections proposées pour des études supplémentaires » de la 5e édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). Cette nouvelle entité nosographique ne se limite pas aux pratiques d’incisions cutanées, mais cite explicitement ces dernières comme premier exemple de lésion possible (American Psychiatric Association, 2013). En parallèle, depuis quelques années, les discours scientifiques et médiatiques se multiplient sur les coupures cutanées superficielles et répétées effectuées par la personne elle-même, pratiques que je désignerai dans cet article sous le terme de « scarifications ». Concernant les discours médiatiques, un groupe de chercheuses a notamment montré à l’aide de l’outil de recherche LexisNexis que le nombre d’articles de journaux américains mentionnant des scarifications est passé de 106 entre 1966 et 1985, à 1 750 entre 2001 et 2005 (Whitlock et al., 2009). Concernant les discours scientifiques, une recherche bibliométrique sur les bases de données PubMed, Google Scholar et Science Direct montre que la prévalence d’articles psychiatriques évoquant les pratiques de scarification a été multipliée par 10 entre la période 1960-1970 et la période 2010-2020 (Cascarino, 2020).
L’intérêt pour les pratiques de scarification a donc particulièrement augmenté ces dernières années dans l’objectif, selon le discours explicite de nombreux discours psychiatriques, de « soigner » les personnes qui se scarifient, notamment en les aidant à arrêter de se scarifier, comme le montre bien le titre d’un ouvrage fréquemment cité : Treating Self Injury: A practical guide (Walsh, 2005). Nous pouvons aussi citer Matthew Nock, directeur du laboratoire de recherche clinique et développemental d’Harvard depuis 20 112, qui déclare sans détour que « l’objectif ultime de la recherche sur la scarification, c’est de l’empêcher de se produire3 » (Nock, 2012, p. 257).
Si de nombreuses personnes qui se scarifient déclarent être en grande souffrance psychique, une partie de ces personnes présentent la scarification comme un moyen efficace de réduire cette souffrance (Adler et Adler, 2011 ; Chandler, 2016 ; Cresswell, 2005 ; Inckle, 2007 ; Steggals et al., 2020). Le discours d’une patiente rapporté par la psychologue Sarah Shaw illustre cette représentation de la scarification comme pratique permettant de diminuer une souffrance psychique : « La coupure n’est pas le problème, c’est la solution […]. Je ne suis pas allée voir un psychologue parce que je voulais arrêter, j’y suis allé parce que je voulais comprendre ce qui n’allait pas4 » (Shaw, 2006, p. 162).
Cette présentation de la scarification créée souvent une tension avec les professionnels de la santé mentale qui insistent pour que la personne qu’ils accompagnent arrête de se scarifier. Sarah Shaw explique ainsi que « souvent, le traitement débute avec la promesse de l’instauration d’une relation de confiance puis évolue vers une lutte de pouvoir pour mettre fin à la pratique [de scarification] » (Shaw, 2002, p. 200), les personnes qui se scarifient étant « physiquement contraintes et menacées d’être abandonnées par leur thérapeute si elles continuent de se scarifier » (Shaw, 2002, p. 200).
Cette nécessité d’empêcher les scarifications peut alors entraîner des stratégies punitives où les blessures sont « suturées sans anesthésie ou “traitées par l’application d’alcool méthylique » (Turp, 1999, p. 310), celles-ci pouvant aller jusqu’à voir l’abrasion de plaies à l’aide d’éponges chirurgicales (Shaw, 2002, p. 200) ou l’application méthodique de sel sur les plaies à l’aide d’une brosse à dents (Ross et McKay, 1979, p. 3). De manière moins extrême, mais similaire, et afin de diminuer efficacement les comportements sacrificatoires, Matthew Nock recommande les médicaments qui « éliminent les effets potentiellement agréables du comportement du fait de la libération d’endorphines » (Nock, 2010, p. 356), c’est-à-dire ceux qui augmentent la douleur ressentie lors des scarifications. La nécessité d’arrêter la scarification peut être suffisamment pressante pour passer avant le choix du patient et ce qu’il considère être une source temporaire de bien-être physique et psychique sans que cette imposition du désir du soignant soit explicitement justifiée ni méthodiquement argumentée. Dans cette logique, certains hôpitaux psychiatriques conditionnent ainsi l’hospitalisation du patient à la signature d’un contrat dans lequel ce dernier s’engage à ne plus se scarifier (Conterio et Lader, 1998).
À partir de ce constat, j’ai voulu mieux comprendre pourquoi la pratique des scarifications dérangeait autant les professionnels de la santé mentale et quels pouvaient être les moyens possibles pour diminuer cette relation d’emprise qui pouvait se nouer avec les patients qui se scarifient. Dans cet objectif, j’ai effectué une enquête de terrain ethnographique de septembre 2018 à juin 2019 en me rendant trois jours par semaine dans une unité psychiatrique d’hospitalisation longue pour adolescents5. Durant ces neuf mois, en sus de mes observations de terrain, j’ai conduit des entretiens individuels d’environ une heure chacun avec 22 soignants (infirmiers psychiatriques, mais aussi psychiatres, internes en psychiatrie, art-thérapeutes…)6, 7 parents et 7 patients. Avec leur accord, les entretiens ont été enregistrés, retranscrits puis analysés en m’appuyant sur la méthodologie de la théorie ancrée, développée par les sociologues Barney Glaser et Anselm Strauss dans les années 1960 (Glaser et Strauss, 1967/2010).
Je propose donc dans cet article de rendre compte d’une partie des résultats de cette recherche en montrant tout d’abord comment les scarifications pouvaient remettre en cause l’identité professionnelle des soignants7 et provoquer des ressentis d’agressivité, d’impuissance et de culpabilité, puis j’étudierai les stratégies mises en place au niveau institutionnel et individuel pour sortir d’une relation d’emprise avec les adolescents autour des pratiques de scarification.
Se sentir responsable de l’intégrité physique du patient
Lors de la durée de ma recherche, les soignants cherchaient souvent à empêcher les scarifications, notamment en interdisant explicitement aux patients de se scarifier et en fouillant régulièrement leurs chambres pour récupérer des objets coupants qu’ils avaient dérobés ou introduits dans le service psychiatrique. Une des raisons majeures pour lesquelles les soignants mettent en place ces procédures de contrôles était qu’ils se sentaient responsables de l’intégrité physique du patient :
« Je me suis un peu affolée… et j’ai eu l’impression à ce moment-là d’être un peu responsable ou garante de l’intégrité physique de cette patiente. » (Elsa, soignante)
Les soignants évoquent souvent la crainte que les scarifications laissent des marques irrémédiables sur le corps des adolescents. Garantir l’intégrité physique du patient, ce n’est pas donc pas seulement empêcher la mort de la personne, mais plus largement que son corps garde les traces de son passage à l’hôpital :
« Je me disais qu’elle aurait ces marques à vie […], toute sa vie de… elle était jeune, elle devait avoir 12, 13 ans, et toute sa vie elle allait être marquée par son expérience hospitalière8. » (Maelle, soignante)
Lorsqu’un adolescent est hospitalisé, les soignants se considèrent, et sont considérés par les parents, responsables de l’intégrité physique du corps de l’adolescent. Si le corps de l’adolescent est « endommagé » lors de l’hospitalisation, c’est-à-dire si cette hospitalisation laisse des marques corporelles, cela signifierait qu’ils ont échoué dans leur rôle et il n’est dès lors pas surprenant de voir se multiplier les dispositifs de contrôle pour empêcher l’adolescent de se scarifier. Les scarifications, transgressant de manière particulièrement visible les règles de l’institution psychiatrique deviennent un enjeu de maîtrise entre soignants et soignés et remettent en question les soignants dans leur rôle professionnel :
« La répétition des scarifications nous renvoie justement à l’impuissance qu’on a à avoir cette maîtrise-là sur eux et fatalement, comme on est… souvent les soignants, on est quand même avec une image de notre fonction qu’est… qu’est très protectrice quoi, enfin vraiment voir un gamin blessé, ça active tous les signes d’alarme du soignant. » (Michel, soignant)
Ce dernier extrait d’entretien met en évidence l’apparition chez les soignants d’un sentiment particulièrement difficile à supporter : le sentiment d’impuissance. Décrire plus précisément ce sentiment ressenti par les soignants confrontés aux scarifications nous permettra de mieux comprendre l’urgence qu’ils peuvent parfois ressentir à vouloir les empêcher.
Osciller entre impuissance et culpabilité
Les soignants et les parents reconnaissent leur impossibilité à pouvoir empêcher les adolescents de se scarifier malgré tous leurs efforts (ils ne peuvent pas cacher tous les objets dangereux, ni voir toutes les scarifications, ni « les attacher toute la journée »). Cela entraîne parfois un soulagement – en se déresponsabilisant de ce que l’adolescent peut faire – ou une angoisse, car ils se demandent jusqu’où l’adolescent va aller, avec la crainte de devoir assister à la dégradation de son corps ou, pire, à son suicide9.
Ce sentiment d’impuissance se manifeste particulièrement lorsque les patients décrivent leurs scarifications comme étant la seule pratique qui leur permet de soulager leur souffrance psychique. Dans ce cas, les soignants se retrouvent face à une impasse : comment justifier tous les efforts qu’ils font pour empêcher le patient de se scarifier si, pour ce dernier, les scarifications sont la seule chose lui permettant d’aller mieux ?
« Il y a que ça qui te soulage, bon… Mais et moi alors, qu’est-ce que, qu’est-ce que je peux, enfin, je te soulage pas, je t’aide pas… mais j’suis là pourtant, j’suis là, je t’accompagne, on est tous là, on est tous là pour toi, mais nous non, on est insuffisant… » (Lisa, soignante)
En parallèle de ce sentiment d’impuissance apparaît aussi un sentiment de culpabilité. Les infirmiers se demandent aussi souvent « ce qu’ils ont fait », ou manqué de faire, pour que le patient se scarifie : s’ils n’ont pas « loupé quelque chose », s’il n’y a pas un signe qu’ils n’ont pas perçu, un regard du patient qu’ils n’ont pas vu, une parole qu’ils n’ont pas prononcée et qui aurait pu le rassurer et éviter ce type de conduite :
« Peut-être que des questions qu’on n’a pas posées ou des choses qu’on n’a pas vues […] ça me renvoie à quelque chose que j’ai pas vu, je me dis : “Zut, j’ai été mauvaise, là”. » (Maelle, soignante)
Le sentiment de responsabilité peut aussi aller jusqu’à considérer que le patient s’est attaqué la peau à cause des soignants. L’infirmier peut alors se sentir responsable parce qu’il est « allé trop loin » dans les questions qu’il a posées, qu’il a « creusé trop profond ». Le cadre institutionnel peut aussi être décrit comme favorisant l’apparition de comportements de scarification, soit parce que les patients ne sont pas assez surveillés et contraints, soit au contraire, parce qu’ils le sont trop.
Par ailleurs, lorsque le patient arrête de se scarifier, les raisons avancées ne sont jamais liées au travail individuel d’un soignant, mais plutôt à la prise en charge collective : travail institutionnel, traitement médicamenteux, médiations corporelles ou encore « prise de conscience » du patient. Pour expliquer ce paradoxe (se sentir responsable personnellement de l’apparition d’un comportement de scarification, mais pas de son arrêt), un infirmier a pu dire, lors d’une restitution collective d’une partie des résultats en avril 2019, que le sentiment de culpabilité ne servait en fait qu’à masquer et à rendre supportable l’impuissance :
« Se dire qu’on a loupé quelque chose, qu’on a foiré, c’est aussi se dire que peut-être que la prochaine fois on réussira à empêcher les scarifications et ça, c’est rassurant. C’est pas tant que les scarifications nous agressent que notre propre impuissance qui nous est insupportable. » (Michel, soignant)
La culpabilité aurait comme bénéfice de conserver l’illusion de maîtrise, la croyance que les soignants pourront un jour maîtriser suffisamment le corps de l’adolescent jusqu’à l’arrêt de toute scarification10. Cet idéal transparaît de manière critique dans le discours des soignants qui (se) répètent souvent qu’il est normal que le corps de l’adolescent leur échappe en partie :
« Après, on ne peut pas… voilà, on ne peut pas tout maîtriser, on n’est pas tout-puissants, on n’est pas des surhommes, on n’est pas [grande inspiration], mais c’est vrai que… » (Clémence, soignante)
Dans ces discours, la passivité est considérée comme insupportable, mais aussi inévitable, puisque soignants comme parents insistent, certes, sur leur incapacité à maîtriser le corps de l’adolescent, mais surtout sur la nécessité de reconnaître et d’accepter cette incapacité. Pour mieux supporter cette incapacité, les soignants l’imaginent temporaire et espèrent pouvoir « un jour » trouver les bons gestes, les bons mots, la « bonne réaction », qui entraîneraient l’arrêt total des scarifications. En conservant l’illusion que la maîtrise du corps de l’adolescent reste possible, le sentiment de culpabilité permet de supporter l’échec actuel de cette maîtrise : se fustiger d’avoir perdu une bataille permet de se croire encore capable de gagner la guerre.
Le passage d’un questionnement individuel à un questionnement collectif
Une alternative à cette oscillation entre impuissance et culpabilité est alors de considérer ses actions non pas en tant qu’émanant d’individu isolé, mais du membre d’une équipe soignante et de questionner de manière collective le rôle professionnel que l’on doit prendre. Plutôt que de se remettre en cause en tant qu’individu qui ne parviendrait pas à faire son travail de manière suffisamment efficace, les soignants s’interrogent sur le rôle professionnel d’un « soignant » : plutôt que de se comparer à un idéal et de s’évaluer personnellement en fonction de leur distance à cet idéal, ils en viennent à questionner collectivement cet idéal :
« Finalement quand on n’arrive pas à maîtriser le patient, c’est, peut-être se dire ben je n’arrive pas à l’aider en fait, comme s’il fallait que le patient arrête toute scarification… ça signerait sa guérison. Alors que… c’est une idée qui est un peu instinctivement présente, mais en fait qui ne résiste pas longtemps quand on en discute en groupe. » (Michel, soignant)
Passer d’une impression d’impuissance individuelle à un questionnement collectif sur le rôle professionnel d’un soignant permet de considérer l’impossibilité d’empêcher les scarifications autrement que sous l’angle de la passivité et de la défaillance. Supporter le manque de maîtrise sur le corps des patients peut être vécu non pas comme une expérience passivante et insupportable, mais plutôt comme une compétence active et nécessaire qui s’acquiert avec l’expérience et grâce à une réflexion commune avec le reste de l’équipe soignante :
« Toute l’équipe finalement pour nous dire, mais qu’est-ce que t’aurais dû, t’aurais rien pu faire, ceci, cela enfin toujours, voilà on se remonte bien les uns les autres et puis après… ben voilà, ce soulagement apporté permet aussi de penser, de repenser différemment la situation… » (Lisa, soignante)
Renoncer au désir de toute-puissance et de maîtrise totale du corps de l’adolescent est alors considéré par les soignants comme un apprentissage professionnel. Envisager ce renoncement comme une décision et un signe de maturité professionnelle que l’on acquiert par l’expérience personnelle ou au travers des échanges avec d’autres soignants permet alors de supporter la passivité associée au sentiment d’impuissance et de dépasser le sentiment de culpabilité.
Une présence suffisamment défaillante
Les tentatives acharnées pour contrôler le corps et l’environnement de l’adolescent et l’empêcher de se scarifier s’appuient en partie sur une représentation omnipotente et idéalisée du soignant. De nombreuses théories des scarifications décrivent cette pratique comme une manière de lutter contre la passivité et de conserver une impression de contrôle sur son corps et sur son environnement (Dargent et Matha, 2011 ; De Luca, 2011 ; Favazza, 1987/2011 ; Le Breton, 2003). La difficulté à supporter l’impuissance telle qu’elle est décrite chez les adolescents qui se scarifient se retrouve ainsi fortement chez les soignants qui les côtoient. L’enjeu de la rencontre clinique qui se joue autour des scarifications serait alors peut-être de supporter l’impuissance plutôt que d’en triompher. Pour paraphraser Donald Winnicott, plutôt que de développer chez l’enfant la capacité d’être seul en présence d’un « être-humain-proche » (Winnicott, 1958/1989), il s’agirait de développer chez l’« être-humain-proche » la capacité de rester présent avec un adolescent seul, certains soignants décrivant ainsi une aptitude à une « présence suffisamment défaillante » comme un signe de maturité professionnelle. Lors d’un entretien avec la mère d’une patiente, cette dernière me dit, après avoir déclaré avoir été « anéantie » par les scarifications de sa fille car elle ne les avait pas vues et « n’avait rien pu faire pour éviter ça » que la seule chose qu’elle peut faire, c’est « d’être là et de tenir bon ». Il semble que dans ce « tenir bon », il ne s’agit pas de réussir finalement à « soigner sa fille », mais plutôt de réussir à rester auprès de sa fille malgré son impuissance, relative, à l’aider.
Ces réflexions rejoignent celle d’une infirmière qui, s’interrogeant sur ce que serait la réaction la plus adaptée face aux scarifications, insiste sur le fait qu’avant d’essayer de comprendre et de se demander comment réagir, il faut déjà prendre le temps d’être là, et d’assumer peut-être une fonction de Nebenmensch, d’« être humain proche » (Freud, 1895) :
« Finalement, ce n’est pas tant un entretien… dont elles auraient besoin dans ces moments-là, je pense… juste de la présence, peut-être. » (Julie, soignante)
Ce qui évite aux scarifications de se répéter sans fin n’est alors pas la résolution de leur énigme, mais plutôt le renoncement à un idéal de toute-puissance et l’assomption du manque, tant du côté des supposés soignants que des adolescents.
Une certaine partie de la psychanalyse et de la psychiatrie, représentant les patients sous un jour déficitaire, insiste sur la nécessité pour les parents ou pour le thérapeute de se constituer en « bon objet » qui pourra ensuite être introjecté par le patient. Les résultats de cette enquête semblent plutôt montrer que les soignants doivent aussi savoir se montrer suffisamment défaillants et supporter cette défaillance. Cette aptitude à une présence suffisamment défaillante aiderait alors l’adolescent, dont ils tentent de prendre soin, à mieux supporter sa propre impuissance relative face au monde qui l’entoure et à son corps en transformation.
Notes de bas de page
1 Ce terme est traduit dans la version française parue en 2015 par « lésion auto-infligée non suicidaire ».
2 Matthew Nock n’est donc pas psychiatre, mais ses écrits sont abondement cités dans la littérature psychiatrique (Favazza, 1987/2011) sur les scarifications et il publie régulièrement dans des journaux
3 Nous ne développerons pas ce point, mais nous pouvons noter le paradoxe d’une recherche qui viserait à éliminer l’existence de son objet puisque, comme le souligne Butler, « la régulation est toujours génératrice, produisant l’objet qu’elle déclare seulement découvrir » (Butler, 1996, 64).
4 Traduction de ma part, pour cette citation et pour toutes celles de cet article.
5 Cette recherche a été approuvée le 20novembre 2018 par le Comité d’éthique de la recherche de Paris Descartes (CER-PD) no 2018/83.
6 Précisément: 12 infirmiers, 3 internes en psychiatrie, deux psychiatres, une étudiante infirmière, une infirmière vacataire, une art-thérapeute, une socio-esthéticienne, une agente des services Étant donné la faible proportion d’entretiens que j’ai effectués avec des soignants autres que des infirmiers, et afin de préserver l’anonymat des participants, je ne précise la fonction précise du soignant (médecin, interne, infirmier, art-thérapeute…) que lorsque celle-ci est particulièrement importante pour contextualiser la parole.
7 Une analyse des réactions des parents a aussi été faite dans le cadre de cette recherche, mais je me limiterai ici à celle des professionnels de santé.
8 Certains patients commençant en effet à se scarifier lors de leur
9 Dans les faits, les participants de l’étude affirment n’avoir presque jamais vu de tentatives de suicide par phlébotomie et le risque morbide de la pratique des scarifications en elle-même est extrêmement faible.
10 Après avoir écrit ce paragraphe, j’ai découvert par hasard une citation du psychanalyste René Roussillon qui décrit exactement le même processus en évoquant les tentatives de maîtrise d’expérience traumatique, non pas des soignants, mais plutôt des patients : « Le sujet préfère se sentir coupable, mais donc responsable et actif, maître, que retrouver l’impuissance et la détresse du vécu » (Roussillon, 1999, p. 28)
Bibliographie
Adler, P. A. et Adler, P. (2011). The tender cut. Inside the hidden world of self-injury. New York University Press.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5. APA.
Butler, J. (1996). Sexual inversions. Dans S. J. Hekman (dir.), Feminist interpretations of Michel Foucault (p. 59‑75). Pennsylvania State University Press.
Cascarino, A. (2020). Regards croisés sur les scarifications adolescentes. Une approche réflexive entre psychanalyse et sociologie [Thèse]. Université de Paris.
Chandler, A. (2016). Self-Injury, medicine and society. Authentic bodies. Springer.
Conterio, K. et Lader, W. (1998). Bodily harm. The breakthrough healing program for self-injurers. Hyperion.
Cresswell, M. (2005). Psychiatric « survivors » and testimonies of self‑harm. Soc Sci Med, 61(8), 1668‑1677. Repéré à https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.03.033
Dargent, F. et Matha, C. (2011). Blessures de l’adolescence. PUF.
De Luca, M. (2011). Les scarifications comme après coup féminin. Les vicissitudes d’un masochisme bien mal tempéré. Évolution psychiatrique, 76(1), 75‑95.
Favazza, A. R. (2011/1987). Bodies under siege. Self-mutilation, non suicidal self-injury, and body modification in culture and psychiatry. JHU Press.
Freud, S. (2006). Projet d’une psychologie. In F. Kahn & F. Robert (Trad.), Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904 (p. 593‑693). PUF (Original work published 1895).
Glaser, B. G. et Strauss, A. L. (2010/1967). La découverte de la théorie ancrée. Stratégies pour la recherche qualitative (M.‑H. Soulet & K. Œuvray, Trad.). Armand Colin.
Inckle, K. (2007). Writing on the body? Thinking through gendered embodiment and marked flesh. Cambridge Scholars Publishing.
Le Breton, D. (2003). La peau et la trace. Metailié.
Nock, M. K. (2010). Self‑injury. Annu Rev Clin Psychol, 6(1), 339‑363. Repéré à https:// doi.org/10.1146/annurev. clinpsy.121208.131258
Nock, M. K. (2012). Future directions for the study of suicide and self‑injury. J Clin Child Adolesc Psychol., 41(2), 255‑259. Repéré à https://doi.org/10.1080/1537 4416.2012.652001
Ross, R. R. et McKay, H. B. (1979). Self-mutilation. Lexington Books.
Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. PUF.
Shaw, S. N. (2002). Shifting conversations on girl’s and women’s self‑injury: An analysis of the clinical literature in historical context. Feminism & Psychology, 12(2), 191‑219.
Steggals, P., Lawler, S. et Graham, R. (2020). The social life of self‑injury. Exploring the communicative dimension of a very personal practice. Sociol Health Illn, 42(1), 157‑170. Repéré à https://doi. org/10.1111/1467-9566.12994
Turp, M. (1999). Encountering self‑harm in psychotherapy and counselling practice. Br J Psychother., 15(3), 306‑321. Repéré à https://doi. org/10.1111/j.1752-0118.1999.tb00455.x
Walsh, B. W. (2005). Treating self-injury. A practical guide. Guilford Publications.
Whitlock, J. L., Purington, A. et Gershkovich, M. (2009). Influence of the media on self‑injurious behavior. Dans M. K. Nock (dir.), Understanding non-suicidal self-injury. Current science and practice (p. 139‑156). American Psychological Association Press.
Winnicott, D. W. (1989/1958). La capacité d’être seul. Dans J. Kalmanovitch (Trad.), De la pédiatrie à la psychanalyse (p. 325‑333).