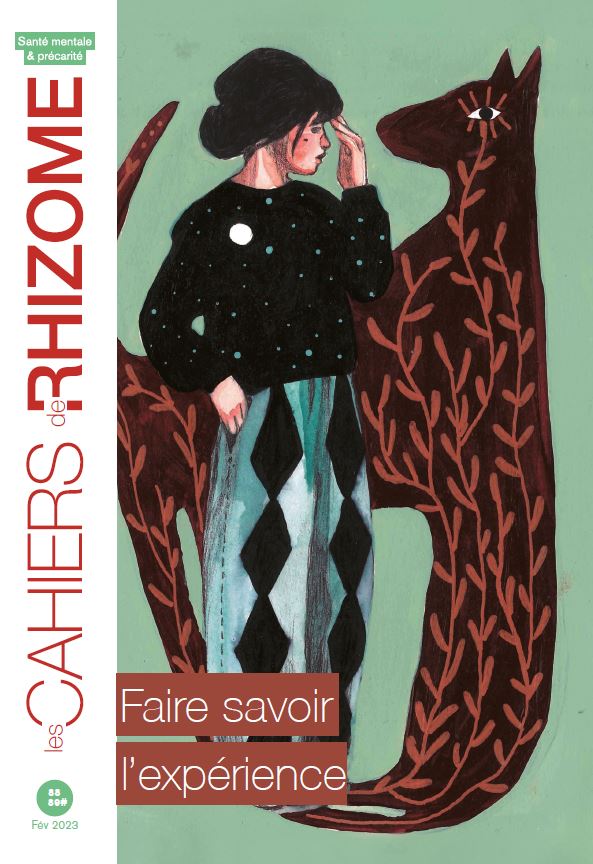Qu’attendons-nous de l’expertise ? L’expert est étymologiquement celui qui a fait ses preuves : l’expertus en latin. Cette origine renvoie par ailleurs à la notion d’« essai ». L’expertise, en tant que savoir éprouvé, est considérée comme un garde-fou censé nous préserver des jugements hâtifs, des illusions, des préjugés qui surgissent lorsque la connaissance et l’expérience sont trop indigentes pour évaluer une problématique ou pour agir en vertu de ce que nous estimons être dans un contexte précis le bien. L’expertise est fondée sur un ensemble de connaissances ainsi que sur un savoir-faire considéré comme excellent (du latin excellere, surpasser) dans une culture professionnelle et une société donnée. De fait, elle se présente comme une analyse qui se veut objective d’une situation.
Pourtant, dans les métiers de l’humain – que nous appellerons « métiers du care » (du soin, de l’accompagnement, de l’enseignement) –, il n’est pas rare qu’un expert anéantisse la vie d’un élève ou d’un patient, non par défaut de connaissance, mais par une utilisation exclusive d’un savoir institutionnel dont il détient la prérogative, étanche à la variabilité humaine. Ces cas infirment la croyance en une expertise supérieure à la vie elle-même dans ce qu’elle a de chaotique et d’imprévisible. Le système du pouvoir-savoir – pour reprendre un terme foucaldien – qui conditionne les modalités de la connaissance se révèle comme cadre idéologique et non objectif de la pensée. En agençant le vivant a priori, et selon ce pouvoir-savoir institutionnel et cumulatif, l’expertise institutionnelle et individuelle n’annule-t-elle pas le rapport à l’expérience immédiate, au corps vécu et au savoir profane ? Sans oublier que l’expert n’est pas uniquement représentant d’un savoir institutionnel, mais il se saisit lui-même de son propre vécu de représentation, avec une intentionnalité qui lui est propre et qui diffère de celle du sujet (par commodité, nous désignerons ici le terme « sujet » comme étant le destinataire d’une profession du care).
Dans cette perspective, l’expertise apparaît dangereuse et assujettie à un dogme. En effet, un « gouvernement des experts » ne désigne-t-il pas un gouvernement de technocrates aguerris, certes, mais à un savoir-faire et à des pratiques déterminées, institutionnalisées, fermées à l’expérience, piégées dans l’habitus et la subjectivité de ses représentants ? Cette expertise, que nous nommerons « expertise institutionnelle », rationalise un ensemble d’expériences passées, mais reste impuissante face à l’expérience immédiate. Cette dernière échappe en effet aux catégories et aux nomenclatures, et exige des dispositions que les connaissances cumulatives ne peuvent constituer. La figure d’un expert indépendant, objectif, suffisamment prudent pour congédier légitimement les autres sources de savoir, s’avère de fait être une figure mythologique. Pour prétendre à l’excellence, l’expertise comme recherche ne peut se constituer sans une complémentarité des perspectives, en particulier dans le champ du care, de l’expérience vécue des personnes concernées.
L’expérience nous libère-t-elle de l’expertise ?
L’expertise institutionnelle détermine, évalue et prédit dans un processus dépourvu de réflexivité pourtant nécessaire à toute approche du savoir. D’un phénomène, elle déduira des conséquences qu’elle évalue nécessaires en s’appuyant sur le savoir institutionnel, étayé par ses normes et ses statistiques. L’expertise institutionnelle s’appuie sur une langue, une culture et des catégories professionnelles.
Le diagnostic, par exemple, résulte d’investigations antérieures, d’un vécu de représentations, d’une perspective sur le monde propre au soignant, mais il conditionne également les investigations et les évaluations postérieures. D’un diagnostic de maladie génétique, l’expert institutionnel déduit, et c’est également ce que l’on attend de lui, la perte d’une faculté à un âge précis, ou la durée de vie d’un individu, grâce à un tableau clinique. Il se prononce également sur les aptitudes et l’éducabilité du sujet dans une perspective conditionnée par sa profession et son vécu de représentation.
L’expérience se produit dans un contexte de régulation des corps et, malgré les récentes évolutions, il est rare que l’hégémonie du médical soit renversée au profit du savoir expérientiel. Aussi, la détention du savoir est corrélée au maintien d’un cadre d’interprétation qui rejette le savoir expérientiel. Sous le joug de l’expertise institutionnelle, le vivant est captif de la taxophilie humaine qui range, catégorise et détermine. Cette expertise institutionnelle modifie le vivant et ses perspectives tout en l’évaluant : ainsi, en présumant des capacités de l’autre, je les altère. La complexité du vivant , a fortiori humain, se voit réduite à une nosologie incompatible avec son caractère imprévisible et avec la diversité des vécus.
L’expert diagnostique, enseigne, soigne et accompagne selon ses représentations, forgées tout au long de sa vie, et plus précisément lors de sa formation, mais aussi de son expérience. Ainsi, on pourrait supposer que toute expérience serait à même de briser un cadre trop restrictif qui occulterait des données précieuses à l’appréhension du vivant dans sa diversité. En effet, le care n’est-il pas le domaine du souci de l’autre et de sa singularité ? « Une médecine soucieuse de l’homme dans sa singularité de vivant ne peut être qu’une médecine qui expérimente », écrivait le philosophe Georges Canguilhem (1983, p. 389), selon qui l’expérience doit nécessairement assouplir le concept du normal statistique (Ryle et Canguilhem, p. 201). L’expérience ne surgit-elle pas dans le réel pour le modifier, pour élargir le champ de vision du professionnel et y introduire la variabilité du vivant ? L’expérience est aussi le lieu où l’enseignant, le soignant, se constitue en tant que tel : « le devoir du médecin est tissé par son expérience » (Le Blanc, p. 105). « Soigner, c’est faire une expérience » (1983, p. 389), l’éthique s’actualise dans l’expérience, en tant que nécessité d’évaluer une situation nouvelle et d’affronter un risque nouveau. Selon le philosophe Guillaume Le Blanc, Georges Canguilhem définit un « Kairos de l’expérience ». Toutefois, cette expérience fonde-t-elle pour autant le statut d’expert, perpétuellement remis en jeu ? Le temps, les rencontres, les erreurs lui permettent de réajuster son savoir et sa pratique au réel. Mais de quel réel parlons-nous ? S’agit-il d’une réalité objective ou du réel d’une fonction, d’une corporation ? L’homme est-il en mesure de percevoir un réel étranger à son « phénomène du monde » ? Quid des erreurs, qui, parce qu’elles dépassent notre champ de connaissance, nos catégories, passent inaperçues ? Dans ce contexte, les pires erreurs, les pires offenses, ne seraient- elles pas celles dont nous ignorons la possibilité même ? Aussi, malgré l’extension du savoir par l’expérience, nous pouvons supposer que le savoir du professionnel reste limité par une perspective unique, une « vue du ciel » qui ne refuse pas, mais ignore le vécu des concernés.
Par ailleurs, l’intersubjectivité est empêchée par différents freins relatifs au caractère insubstituable du vécu. Dans le cas de la souffrance, que Paul Ricœur distingue de la douleur, une incommunicabilité laisse l’expert démuni : « Une déchirure s’ouvre entre le vouloir dire et l’impuissance à dire » (Ricœur, 1992, p. 2). Le monde de l’autre n’est pas le même que le mien, le monde de l’autre souffrant est « dépeuplé » (Ricœur, 1992). Je n’ai aucun accès à la douleur de l’autre, de l’unicité du souffrant à « l’enfer du souffrir » (Ricœur, 1992). Dans le cas d’une situation évaluée « de handicap », les normes d’une société, d’une culture médicale ou éducative vont orienter notre perception de ce qui est sain et valable, mais également du vécu du sujet.
Par ailleurs, par l’expérience de la différence, selon Pierre Ancet, philosophe (2014, p. 7), nous sommes « mis en demeure de réfléchir à nos propres affects, à nos propres difficultés, et à ce que nous croyions évident, comme la motricité de notre corps : comment définirions-nous l’expérience de la motricité pour l’expliquer à quelqu’un qui en est dépourvu ? » Cette difficulté peut expliquer une résistance spontanée à épouser l’expérience de l’autre.
Ainsi, chaque sujet a ses expériences « à soi », son « phénomène du monde » propre (Husserl, 2000 dans Huisman et Malfray, 2000). Alors, s’interroge Georges Canguilhem (1966, p. 8), « Comment expliquer que le clinicien moderne adopte plus volontiers le point de vue du physiologiste que celui du malade ? » Selon ses hypothèses, les symptômes morbides subjectifs et les symptômes objectifs « se recouvrent rarement ». En outre, le médecin va généralement tenir l’expérience pathologique directe du patient pour négligeable. C’est la raison pour laquelle certains médecins peuvent nier l’existence de certaines pathologies (dans ces cas, la sentence de Georges Canguilhem [1966] prend tout son sens : « il n’existe pas de pathologie objective ») ou certains enseignants peuvent nier les besoins d’un de leurs élèves, voire estimer certaines vulnérabilités qui leur semblent absurdes, ou plutôt, qui n’existent pas dans leurs représentations (un exemple fréquent en est la fatigabilité) et transposer leurs désirs sur les projets du sujet. Dans cette expérience, c’est l’aspect institutionnel additionné à une expérience – une expérience certes, mais qui reste subjective et relative à une intentionnalité – qui prévalent par rapport à la complexité des phénomènes, au vécu et à la normativité du sujet (soit la capacité du sujet à produire ses propres normes).
L’expert comme figure mythologique
Concernant le champ du care, l’expert n’a de légitimité que dans la mesure où notre lecture de l’homme s’opère à travers une anthropologie de l’homme normal. L’avis des experts est ainsi tributaire de leur cadre de pensée. Toutefois, tant qu’ils saisissent leur patient ou leur élève en tant qu’objets, les experts échouent dans leur propre raison d’être : soit une connaissance réflexive apte à précéder une décision éthique. Aussi, personne n’est expert. L’expert ne désigne pas une personne, mais une posture. D’un point de vue institutionnel, la posture de l’expert consiste à pré- server l’autorité du sachant face au savoir profane et à dicter l’action juste dans cette objectivité-subjectivité incarnée par l’expert. La qualité de « pathologique » est un « import d’origine technique » (Canguilhem, 1966, p. 214) et ne retranscrit pas l’expérience singulière et primitive. L’élève en échec ne l’est que selon des grilles académiques qui occultent des compétences n’ayant pas objectivement une moindre valeur que les autres. « L’invalidité du jugement du malade » (Canguilhem, 1966, p. 52) peut être étendue à l’invalidité du jugement du sujet. En effet, dans le champ de l’éducation, le vécu subjectif est sacrifié sur l’autel d’une expertise institutionnelle fondée sur le modèle de l’élève abstrait.
L’expert se fait l’émissaire d’une réalité considérée comme un « bien », le garant du souhaitable et du normal. Cependant, en tant que sujet institutionnalisé, l’expert est démuni lorsque la variabilité humaine s’échappe dans les interstices des catégories. Il doit donc faire appel à la mythologie de l’expertise pour asseoir son statut fébrile. La figure de l’expert, en tant que détenteur d’un savoir objectif, se heurte à l’excellence que nous attendons dans l’idéal du sachant-agissant, soit une approche relationnelle, réactive et éthique qui s’inscrit dans la réalité de l’expérience. Dès lors que l’enseignant, le praticien ou le soignant abandonnent ce statut d’expert et s’ouvrent au vécu de l’autre, leur posture est tout autre : ils ne sauraient être que des chercheurs conscients de la labilité de leurs normes professionnelles, ils ne peuvent qu’adopter une posture critique et réflexive quant à ces dernières. C’est ce nouveau paradigme que renforcent le modèle social du handicap et le mouvement de la neurodiversité, une infinie variabilité ainsi qu’un ressenti subjectif et contextuel, une reconnaissance des normativités subjectives indépendamment de toute hiérarchisation. Du point de vue du professionnel, la nécessité de normes pour soigner, éduquer et accompagner s’articule avec la possibilité que ces normes soient renversées.
Le chercheur, loin de se constituer représentant de l’objectivité, s’oppose à la figure de l’expert en refusant de représenter une objectivité dont il connaît la vanité. Il se situe dans une restructuration permanente de son cadre axiologique et pense ses propres concepts relativement à des options normatives. De manière générale, pour prétendre à une quelconque efficacité, l’épistémologie doit, selon les analyses critiques de Gaston Bachelard et Georges Canguilhem, s’interpréter non pas selon une histoire cumulative, mais selon une histoire normative. « L’épistémologie est ainsi la capacité de juger des normes internes aux sciences », résume Guillaume Le Blanc (2008, p. 122). Si l’ouvrage Le normal et le pathologique (Canguilhem, 2013) prend pour objet d’étude la médecine, il questionne plus largement la neutralité scientifique et le rôle des dogmes politiques ou sociaux dans la science. Il permet également d’interroger toute prétention à l’expertise, y compris dans les métiers de l’humain tels que l’enseignement et les métiers du soin. Il n’existe pas de professionnel en mesure de percevoir ce qui est juste, sain et valable objective- ment, soit hors de son cadre épistémologique et normatif. Pour prévenir le dogmatisme en pédagogie et dans le soin, la réflexivité axiologique a nécessairement plus d’efficacité que l’accumulation des savoirs. Le soignant/enseignant se constitue ainsi en tant que sujet éthique qui saisit le kairos au sein de l’expérience. L’expert, dans le champ du care, est donc une figure mythologique, un dépassement chimérique de celui qui cherche. Comment chercher, c’est-à-dire articuler les normes arbitraires de la connaissance et l’éthique en tant qu’effort vers le juste, sans l’intervention du savoir expérientiel ?
L’expérience vécue comme condition de possibilité de la recherche
L’infraction, nous dit Georges Canguilhem (1966), est l’origine de la régulation. Concernant notre sujet, toute normativité singulière est potentiellement une infraction face à des normes scientifiques et professionnelles. Or, ces normes scientifiques et professionnelles sont inaptes à constituer seules les conditions de possibilité d’une posture éthique et réactive du chercheur. Aussi, à l’expérience perçue vient s’adjoindre la nécessité de l’intervention de l’expérience vécue. Le savoir et l’expérience perçue des métiers de l’humain, la mise en évidence du rôle des normes dans le discours des experts sont opérés par des savoirs profanes, mais, surtout, par des savoirs vécus. Si la figure de l’expert est un mythe, celle du chercheur apte à conseiller les pratiques locales comme les grandes orientations politiques doit être considérée avec prudence, tout comme le traitement de l’expérience de ce même chercheur.
L’expérience professionnelle ne suffit pas, nous l’avons dit, à rendre compte d’une réalité vécue. Elle peut même occulter cette réalité vécue, voire s’y opposer. Aucun énoncé n’est en mesure de transposer le vécu d’un corps à un autre. Il peut, tout au mieux, tracer une analogie entre mon vécu et celui de l’autre. Mais cette analogie est fébrile, trop incertaine pour conditionner une décision éthique. Les expériences singulières restent irréductibles au savoir institutionnel. La considération et la rencontre avec les personnes concernées constituent indéniablement une expérience, une extension de nos représentations. Cette conceptualisation de l’expérience d’autrui, si approfondie soit-elle, est une expérience de l’altérité, mais remplace-t-elle le vécu subjectif ?
L’expérience vécue comme fissure dans l’expertise
Dans le champ de la médecine, du handicap et de la neurodiversité, la prégnance de l’expertise face au savoir profane est aujourd’hui déstabilisée par la prise de parole des personnes concernées. Depuis la fin du siècle dernier, les témoignages littéraires et vidéo, mais aussi les groupes de patients en ligne, constituent une nouvelle source de données et contribuent à forger la compétence du patient-expert.
Jeanne, atteinte d’un syndrome d’Ehlers-Danlos1, estime avoir plus appris sur sa pathologie dans les groupes de patients et sur les forums qu’auprès des soignants. Ces derniers, pour certains, l’appellent ironiquement « docteure ». Progressivement, en s’affranchissant du normocentrisme – cette tendance à appréhender l’expérience par le prisme du normal (entendu comme situation de proximité moyenne avec les normes contextuelles) –, Jeanne a développé une connaissance approfondie du syndrome.
La reconnaissance de ce nouveau savoir s’est imposée ces dernières décennies avec l’émergence des patients-experts. Ce changement de paradigme destitue l’hégémonie médicale, le prestige de celui qui « côtoie », qui croit savoir, mais ne ressent pas et ne fait pas l’expérience de. Cette primauté (ou du moins, cette complémentarité) de l’expérience vécue sur le regard professionnel s’est aussi affirmée avec l’émergence du modèle social du handicap. Le « rien sur nous sans nous » se légitime par l’impossibilité de transposer un vécu d’une sensibilité à une autre : « La recherche sur le handicap ne doit pas être considérée comme un ensemble de procédures techniques objectives mises en œuvre par des “experts”, mais comme une partie de la lutte des personnes handicapées contre l’oppression qu’elles connaissent actuellement dans leur vie » (Oliver et Mike, 1992, p. 102).
La déconstruction d’un modèle social oppresseur ne peut évidemment pas être opérée par les démarches d’experts conditionnés par leurs propres normes professionnelles. Il y a une unicité dans l’expérience singulière. Notre expérience première du corps est totalité : toutes les parties sont liées les unes aux autres. Aussi, je ressens mon corps propre comme une unité indivisible et inquantifiable. Il ne peut faire l’objet de vérités épistémologiques : « Le corps propre nous enseigne un mode d’unité qui n’est pas la subsomption sous une loi », écrivait le philosophe Maurice Merleau-Ponty (1979 [1945], p. 175). Aussi, une part conséquente du vécu du sujet échappe à mon entendement, à ma subjectivité.
Si je supporte, voire apprécie, d’être frôlé par une personne de mon entourage, comment admettre que, pour autrui, cela puisse être douloureux ? Comment appréhender la nature de ce malaise, de cette douleur, puisque c’est non pas avec le corps d’autrui, mais avec mon corps que j’appréhende ce ressenti ? Les incapacités évidentes me sont accessibles par un cheminement qui varie selon ma connaissance de l’altérité, mais la fatigabilité, la sensibilité, la douleur même d’autrui reste nimbée de mystère voire de doute : l’autre a-t-il vraiment mal ? Souffre-t-il vrai- ment de ce geste, de cette situation ? Comment accepter « les choix opposés aux nôtres » et les « demandes que nous ne comprenons pas » en dehors d’une « démarche éthique des valeurs et de son propre ressenti » interroge Pierre Ancet (2014, p. 7) ? Cette expérience autre qui se donne à ma subjectivité est la remise en question de mes certitudes, de mes représentations concernant le corps vécu, mais cette remise en question est insuffisante.
Nous pouvons étayer cette réflexion avec l’exemple de l’autisme, singularité cognitive, vaste dans ses manifestations et encore incomprise. Dans le cas de l’autisme, la parole subjective, cette « compréhension de soi » revendiquée par le militant Mel Baggs, a précisément pour rôle de briser un cadre de pensée restrictif. Elle est donc essentielle pour se rapprocher du juste et de l’équitable : « La recherche psychologique sur l’autisme suppose que les personnes autistes ne peuvent pas comprendre ou rapporter quoi que ce soit de pertinent sur elles- mêmes, à moins que cela ne coïncide avec ce qu’ils croient a priori à notre sujet, et que notre compréhension de nous-mêmes est une exception plutôt qu’une règle » (Baggs, 2016).
Comme le rappelle Mel Baggs (2016) : « La seule personne qui peut dire comment elle vit quelque chose est elle-même. » Ainsi, les tentatives d’objectivations des manifestations physiques et psychiques d’un être sont vaines (a fortiori lorsque leurs modalités d’expression s’éloignent du langage ordinaire) et ne prennent leur sens que dans une mise en cohérence de l’expérience vécue et de la recherche.
Contrairement à ce que les détracteurs de modèles professionnels orientés vers le sujet (pédagogies alternatives, modèle social du handicap, co-expertise) peuvent croire, l’expérience vécue ne s’oppose pas à l’universel, mais celle-ci travaille ce dernier, l’incorpore. Elle le rend également envisageable dans une dynamique toujours plus juste et éthique. L’empowerment des concernés réhabilite une éthique en cohérence avec leur vécu subjectif et travaille le réel pour y insérer cette part d’humanité plus rare, mais de même valeur, que traduit leur vécu : « Par exemple, si vous pensez en images (ce que font également certaines personnes autistes et de nombreuses personnes non autistes), vous le savez parce que vous voyez les images dans votre esprit. Dans ce cas, personne d’autre ne peut venir dire : “Tu es juste dans l’illusion, tu ne vois pas vraiment d’images dans ta tête.” Parce que c’est une expérience purement subjective : seule la personne qui la rapporte peut en percevoir la réalité, la fréquence et la modalité de cette réalité » (Baggs, 2016). Cette nouvelle expérience introduit dans nos représentations « d’autres dimensions habituellement occultées » (Ancet, 2014, p. 7), elle nous invite, à l’échelle collective, à étendre l’universel.
Patient-expert ou patient-chercheur ?
Nonobstant le rôle crucial du sujet dans cette recherche réactive et insatisfaite, notre critique du statut d’expert comme figure mythologique nous contraint à relativiser la superbe du statut de patient-expert. L’expérience de soi peut-elle être érigée au statut de connaissance objective ? Cela reviendrait également à essentialiser l’altérité et à se livrer non plus à un normocentrisme, mais à un égocentrisme au sens littéral : c’est le risque que prennent les patients-experts et les témoins lorsqu’ils formulent à leur tour des préconisations généralisées.
Il serait préjudiciable à l’humain de concevoir la vulnérabilité, la maladie, la souffrance et le handicap comme des affaires de catégories. Ils concernent l’humanité tout entière. Aussi, des expériences de souffrances, de situations de handicap, de vulnérabilités peuvent se révéler très proches par le biais de l’intersubjectivité, mais de natures totalement différentes. De la même manière, la souffrance liée à un vécu n’est pas équivalente à ce qu’en projette l’opinion commune. Tout comme le fait que Marcel Nuss (2015), en situation de handicap, affirme être heureux – alors que d’autres lui expliquent préférer la mort que de vivre sa vie – désoriente, le suicide d’un jeune homme de 15 ans suite à une rupture amoureuse rompt avec l’opinion commune de son vécu.
Temple Grandin, zootechnicienne américaine autiste, a inventé « la machine à câlin » afin de soulager son anxiété. Néanmoins, elle concède que « la machine à serrer n’est pas la panacée pour tous les enfants autistes » (Grandin, 2003[1994], p. 141) affirmant explicitement que les différences entre enfants autistes sont comparables aux différences entre enfants considérés comme normaux (Grandin, 2003[1994], p. 35). Le phénomène du monde, comme l’expérience de soi, demeure insubsti- tuable. Aussi, le sujet (l’élève ou le patient) peut se constituer chercheur, mais la perspective d’une expertise devrait rester soumise à une analyse plurielle.
L’expertise comme convocation plurielle et dynamique de l’expérience
L’expertise en tant qu’évaluation éthique et réflexive d’un phénomène ne peut être autre qu’une recherche plurielle, nécessairement insatisfaite, intrinsèquement dynamique. Sitôt que l’expérience est scellée sous l’analyse de l’expert, elle ne se révèle que partiellement, ou sous une réalité conforme aux représentations de l’observateur, lui-même conditionné par un ensemble de normes ou d’habitudes. L’expérience vécue est la pierre d’achoppement de l’expertise institutionnelle : elle en révèle l’insuffisance et la vanité. Elle révèle l’impuissance de l’expert institutionnel face à l’exigence éthique qui surgit dans l’expérience.
Une décision éthique ne saurait se fonder sur une image abstraite de l’homme, elle convoque nécessairement la singularité. Lorsque le professionnel se constitue en sujet éthique, il substitue à la certitude du savoir académique une recherche qui inclut le savoir profane et l’expérience vécue du sujet qui lui fait face. Il n’est plus expert, il est chercheur.
L’expert est ainsi une figure mythologique à laquelle la parole des personnes concernées (inégale au sein des professions du care : dans le domaine de l’éducation, le vécu subjectif ne suscite, à ce jour, que peu d’intérêt) oppose l’alternative d’une expertise plurielle et réflexive : il s’agit de l’expertise comme convocation plurielle dynamique de l’expérience. En revanche, l’expérience et le savoir du chercheur professionnel ne s’opposent pas à l’émancipation du sujet. Leurs savoirs sont complémentaires, mais la liberté du sujet devient la nouvelle toile de fond de la concertation.
L’expertise réalisée par les chercheurs, académiques et profanes, concernés et accompagnants, est alors nécessairement normative. Elle travaille le réel, tâtonne, confronte les perspectives et appelle, en premier lieu, l’émancipation du sujet concerné selon sa propre subjectivité.
Notes de bas de page
1 Le syndrome d’Ehlers Danlos constitue un groupe hétérogène de maladies génétiques liées à une anomalie du tissu conjonctif.
Bibliographie
Ancet, P. (2014). Introduction. Dans P. Ancet, Le corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée (p. 7). Dunod.
Baggs, M. (2016, 1er mai). How to dismiss everything autistic people have to say about ourselves… Ballastexistenz.
Canguilhem, G. (1983). Études d’histoire et de philosophie des sciences. Vrin.
Canguilhem, G. (2010 [1966]). Le normal et le pathologique. Presses universitaires de France.
Huisman, D. et Malfray, M.-A. (2000). Les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale (p. 473-474). Perrin.
Husserl, E. (2000). Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie. Vrin.
Grandin, T. (2003). Ma vie d’autiste (traduit par Schaefer). Odile Jacob.
Le Blanc, G. (2008). Canguilhem et les normes. Presses universitaires de France.
Merleau-Ponty, M. (1979[1945]). Phénoménologie de la perception (p. 175-177). Gallimard.
Nuss, M. (2021, 20 sept.). Le bonheur handicapé ?.
Marcel Nuss – Au fils des mots qui pansent.
Oliver, M. (1992). Changing the social relations of research production?. Disability, Handicap and Society, 7(2), 101-14.
Ricœur, P. (1992). La souffrance n’est pas la douleur. Psychiatrie française.